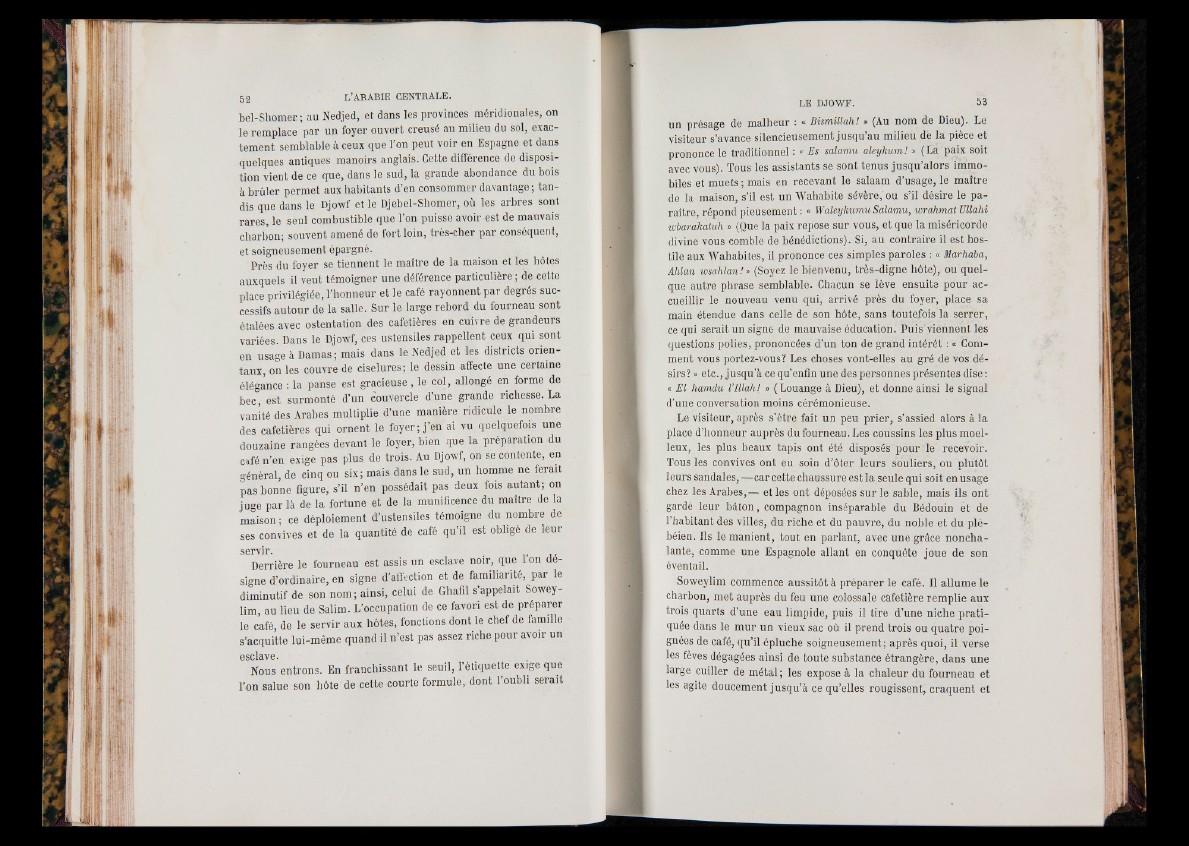
bel-Shomer.; au Nedjed, et dans les provinces méridionales, on
le remplace par u n foyer ouvert creusé au milieu du sol, exactement
semblable à ceux que l’on peut voir en Espagne et dans
quelques antiques manoirs anglais. Cette différence de disposition
vient de ce que, dans le sud, la grande abondance du bois
à b rû le r permet aux habitants d’en consommer davantage; tandis
que dans le Djowf et le Djebel-Shomer, où les arbres sont
ra re s, le seul combustible que l’on puisse avoir est de mauvais
charbon; souvent amené de fort loin, très-cher p a r conséquent,
et soigneusement épargné.
Près du foyer se tiennent le maître de la maison et les hôtes
auxquels il veut témoigner u n e déférence particulière ; de cette
place privilégiée, l’honneur et le café rayonnent par degrés successifs
au to u r de la salle. Sur le large rebord du fourneau sont
étalées avec ostentation des cafetières en cuivre de grandeurs
variées. Dans le Djowf, ces ustensiles rappellent ceux qui sont
en usage à Damas; mais dans le Nedjed et les districts o rien ta
u x , on les couvre de ciselures; le dessin affecte une certaine
élégance : la panse est g ra c ieu se , le col, allongé en forme de
bec, est surmonté d’u n couvercle d’une grande richesse. La
vanité des Arabes multiplie d’une manière ridicule le nombre
des cafetières qui ornent le foyer; j ’en ai vu quelquefois une
douzaine rangées devant le foyer, bien que la préparation du
café n’en exige pas plus de tro is. Au Djowf, on se contente, en
général, de cinq ou six; mais dans le sud, u n homme ne ferait
pas bonne figure, s’il n ’en possédait pas deux fois a u ta n t; on
juge par là de la fortune et de la munificence du maître de la
maison ; ce déploiement d’ustensiles témoigne du nombre de
ses convives et de la quantité de café q u ’il est obligé de leur
servir. , -
Derrière le fourneau est assis un esclave noir, que 1 on désigne
d’ordinaire, en signe d’affection et de familiarité, par le
diminutif de son nom; ainsi, celui de Ghafil s’appelait Sowey-
lim , au lieu de Salim. L’occupation de ce favori est de p rép a re r
le café, de le servir aux hôtes, fonctions dont le chef de famille
s’acquitte lui-même quand il n ’est pas assez riche pour avoir un
esclâVG.
Nous entrons. En franchissant le seuil, l’étiquette exige que
l’on salue son hôte de cette courte formule, dont l’oubli se ra it
un présage de malheur • oe IlisfiiiHah! » (Au nom de Dieu). Le
visiteur s’avance silencieusement ju sq u ’au milieu dë la pièce et
prononce le traditionnel : « Es salamu aleykum! » (Là paix soit
avec vous). Tous les assistants se sont tenus ju sq u ’alors immobiles
et muets; mais en recevant le salaam d’usage, le maître
de la maison, s’il est un Wahabite sévère,'ou s’il désire le p a raître,
répond pieusement : « WaleykumuSalamu, wrahmat Ullahi
wbarakatuh » (Que la paix repose su r vous, et que la miséricorde
divine vous comble de bénédictions). Si, au contraire il est hostile
aux Wahabites, il prononce ces simples paroles : « Marhaba,
Ahlan wsahlan!» (Soyez le bienvenu, très-digne hôte), ou quelque
autre phrase semblable. Chacun se lève ensuite p o u r accueillir
le nouveau venu qui, arrivé près du foyer, place sa
main étendue dans celle de son hôte, sans toutefois la se rre r,
ce qui serait un signe de mauvaise éducation. Puis viennent les
questions polies, prononcées d’un ton de grand in té rê t : « Comment
vous portez-vous? Les choses vont-elles au gré de vos désirs?
» etc., ju sq u ’à ce qu’enfin une des personnes présentes dise :
« El hamdu l’IUah! » ( Louange à Dieu), et donne ainsi le signal
d’une conversation moins cérémonieuse.
Le visiteur, après s’être fait un peu p rie r, s’assied alors à la
place d’honneur auprès du fourneau. Les coussins les plus m oelleux,
les plus beaux tapis ont été disposés p o u r le recevoir.
Tous les convives ont eu soin d’ôter leurs souliers, ou plutôt
leurs sandales, —car cette chaussure est la seule qui soit en usage
chez les Arabes,— et les ont déposées su r le sable, mais ils ont
gardé leur b â to n , compagnon inséparable du Bédouin et de
l’habitant des villes, du riche et du pauvre, du noble e t du plébéien.
Us le manient, tout en parlant, avec un e grâce n o n ch a lante,
comme une Espagnole allant en conquête joue de son
éventail.
Soweylim commence aussitôt à prép a re r le café. Il allume le
charbon, met auprès du feu une colossale càfetière remplie aux
trois quarts d’une eau limpide, puis il tire d’une niche p r a tiquée
dans le m u r u n vieux sac où il prend tro is ou q u atre poignées
de café, qu’il épluche soigneusement; aprè s quoi, il verse
les fèves dégagées ainsi de toute substance é tran g ère, dans une
large cuiller de métal ; les expose à la cha leur du fourneau et
les agite doucement ju sq u ’à ce qu’elles rougissent, craq u en t et