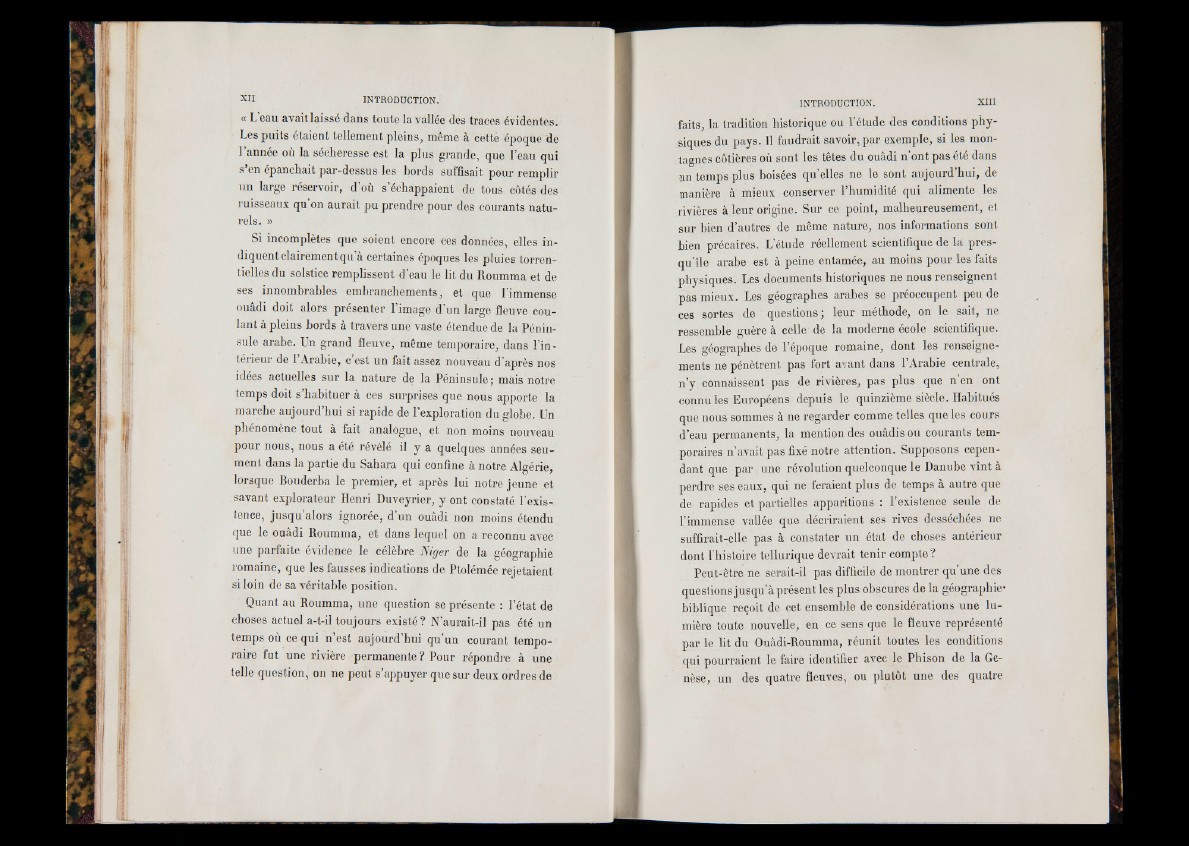
« L eau avait laisse dans toute la vallée des traces évidentes.
Les puits étaient tellement pleins, même à cette époque de
1 année où la sécheresse est la plus grande, que l’eau qui
s en épanchait par-dessus les bords suffisait pour remplir
un large réservoir, d’où s’échappaient de tous côtés des
ruisseaux qu on aurait pu prendre pour des courants naturels.
»
Si incomplètes que soient encore ces données, elles indiquent
clairementqu’à certaines époques les pluies torrentielles
du solstice remplissent d’eau le lit du Roumma et de
ses innombrables embranchements, et que l’immense
ouâdi doit alors présenter l’image d’un large fleuve coulant
à pleins bords à travers une vaste étendue de la Péninsule
arabe. Un grand fleuve, même temporaire, dans l’in térieur
de l’Arabie, c’est un fait assez nouveau d’après nos
idées actuelles sur la nature de la Péninsule; mais notre
temps doit s’habituer à ces surprises que nous apporte la
marche aujourd’hui si rapide de l’exploration du globe. Un
phénomène tout a fait analogue, et non moins nouveau
pour nous, nous a été révélé il y a quelques années seu-
ment dans la partie du Sahara qui confine à notre Algérie,
lorsque Bouderba le premier, et après lui notre jeune et
savant explorateur Henri Duveyrier, y ont constaté l’existence,
jusqu alors ignorée, d un ouâdi non moins étendu
que le ouâdi Roumma, et dans lequel on a reconnu avec
une parfaite évidence le célèbre Niger de la géographie
romaine, que les fausses indications de Ptolémée rejetaient
si loin de sa véritable position.
Quant au Roumma, une question se présente : l’état de
choses actuel a-t-il toujours existé? N’aurait-il pas été un
temps où ce qui n’est aujourd’hui qu’un courant temporaire
fut une rivière permanente ? Pour répondre à une
telle question, on ne peut s’appuyer que sur deux ordres de
faits, la tradition historique ou l’étude des conditions physiques
du pays. 11 faudrait savoir, par exemple, si les montagnes
côtières où sont les têtes du ouâdi n’ont pas été dans
an temps plus boisées qu’elles ne le sont aujourd’hui, de
manière à mieux conserver l’humidité qui alimente les
rivières à leur origine. Sur ce point, malheureusement, et
sur bien d’autres de même nature, nos informations sont
bien précaires. L’étude réellement scientifique de la presqu’île
arabe est à peine entamée, au moins pour les faits
physiques. Les documents historiques ne nous renseignent
pas mieux. Les géographes arabes se préoccupent peu de
ces sortes de questions ; leur méthode, on le sait, ne
ressemble guère à celle de la moderne école scientifique.
Les géographes de l’époque romaine, dont les renseignements
ne pénètrent pas fort avant dans l’Arabie centrale,
n’y connaissent pas de rivières, pas plus que n ’en ont
connu les Européens depuis le quinzième siècle. Habitués
que nous sommes à ne regarder comme telles que les cours
d’eau permanents, la mention des ouâdis ou courants temporaires
n’avait pas fixé notre attention. Supposons cependant
que par une révolution quelconque le Danube vint à
perdre ses eaux, qui ne feraient plus de temps à autre que
de rapides et partielles apparitions : l’existence seule de
l’immense vallée que décriraient ses rives desséchées ne
suffirait-elle pas à constater un état de choses antérieur
dont l’histoire tellurique devrait tenir compte ?
Peut-être ne serait-il pas difficile de montrer qu une des
questions jusqu’à présent les plus obscures de la géographie1
biblique reçoit de cet ensemble de considérations une lumière
toute nouvelle, en ce sens que le fleuve représenté
par le lit du Ouâdi-Roumma, réunit toutes les conditions
qui pourraient le faire identifier avec le Phison de la Genèse,
un des quatre fleuves, ou plutôt une des quatre