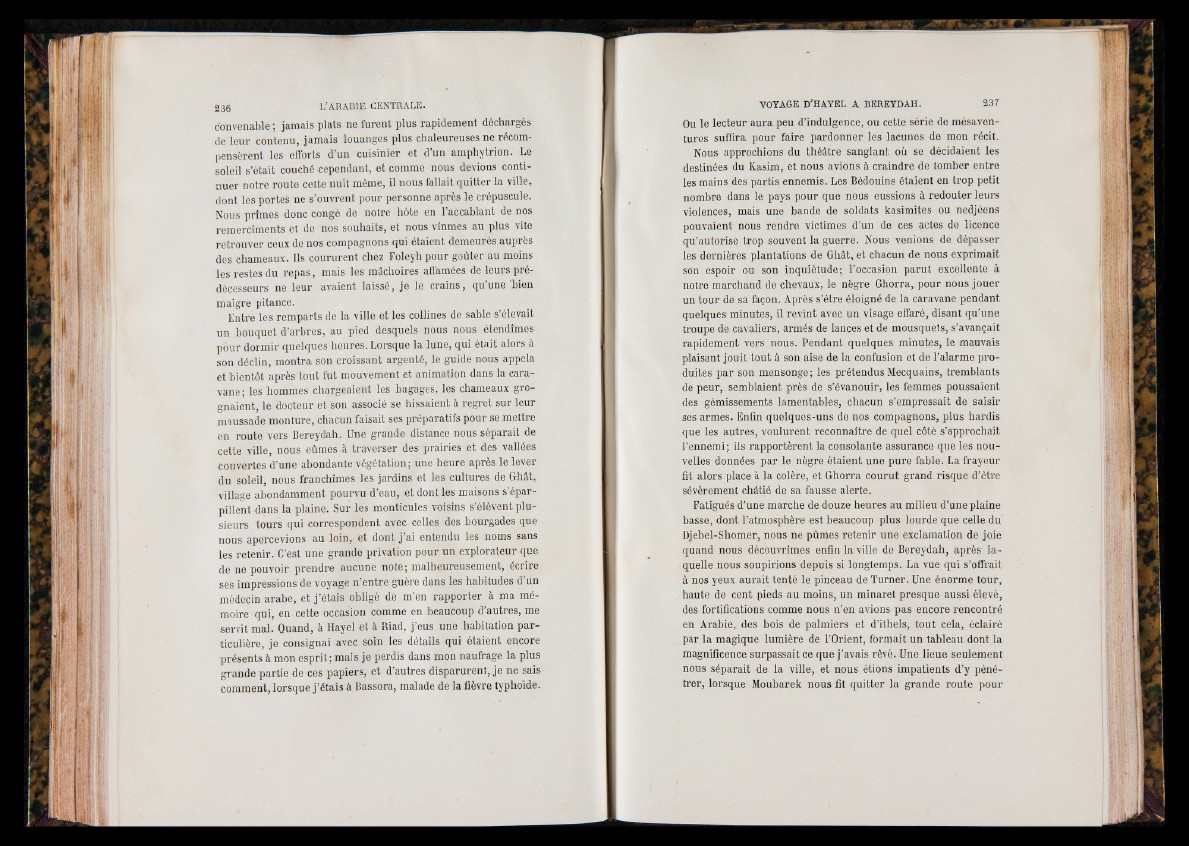
convenable ; jamais plats ne furent plus rapidement déchargés
de leur contenu, jamais louanges plus chaleureuses ne récompensèrent
les efforts d’un cuisinier et d’un amphytrion. Le
soleil s’était couché cependant, et comme nous devions continuer
notre route cette nuit même, il nous fallait quitter la ville,
dont les portes ne s’ouvrent pour personne après le crépuscule.
Nous prîmes donc congé de notre hôte en l’accablant de nos
remercîments et de nos souhaits, et nous vînmes au plus vite
retrouver ceux de nos compagnons qui étaient demeurés auprès
des chameaux. Us coururent chez Foleyh pour goûter au moins
les restes du repas, mais les mâchoires affamées de leurs prédécesseurs
ne leur avaient laissé, je le crains, qu’une'bien
maigre pitance.
Entre les remparts de la ville et les collines de sable s’élevait
un bouquet d’arbres, au pied desquels nous nous étendîmes
pour dormir quelques heures. Lorsque la lune, qui était alors a
son déclin, montra son croissant argenté, le guide nous appela
et bientôt après tout fut mouvement et animation dans la caravane;
les hommes chargeaient les bagages, les chameaux grognaient,
le docteur et son associé se hissaient à regret sur leur
maussade monture, chacun faisait ses préparatifs pour se mettre
en route vers Bereydah. Une grande distance nous séparait de
cette ville, nous eûmes à traverser des prairies et des vallées
couvertes d’une abondante végétation; une heure après le lever
du soleil, nous franchîmes les jardins et les cultures de Ghât,
village abondamment pourvu d’eau, et dont les maisons s’éparpillent
dans la plaine. Sur les monticules voisins s’élèvent plusieurs
tours qui correspondent avec celles des bourgades que
nous apercevions au loin, et dont j ’ai entendu les noms sans
les retenir. C’est une grande privation pour un explorateur que
de ne pouvoir prendre aucune note; malheureusement, écrire
ses impressions de voyage n’entre guère dans les habitudes d’un
médecin arabe, et j ’étais obligé de m’en rapporter à ma mémoire
qui, en cette occasion comme en beaucoup d’autres, me
servit mal. Quand, à Hayel et à Riad, j’eus une habitation p articulière,
je consignai avec soin les détails qui étaient encore
présents à mon esprit; mais je perdis dans mon naufrage la plus
grande partie de ces papiers, et d’autres disparurent, je ne sais
comment, lorsque j ’étais à Bassora, malade de la fièvre typhoïde.
Ou le lecteur aura peu d’indulgence, ou cette série de mésaventures
suffira pour faire pardonner les lacunes de mon récit.
Nous approchions du théâtre sanglant où se décidaient les
destinées du Kasim, et nous avions à craindre de tomber entre
les mains des partis ennemis. Les Bédouins étaient en trop petit
nombre dans le pays pour que nous eussions à redouter leurs
violences, mais une bande de soldats kasimites ou nedjéens
pouvaient nous rendre victimes d’un de ces actes de licence
qu’autorise trop souvent la guerre. Nous venions de dépasser
les dernières plantations de Ghât, et chacun de nous exprimait
son espoir ou son inquiétude; l’occasion parut excellente à
notre marchand de chevaux, le nègre Ghorra, pour nous jouer
un tour de sa façon. Après s’être éloigné de la caravane pendant
quelques minutes, il revint avec un visage effaré, disant qu’une
troupe de cavaliers, armés de lances et de mousquets, s’avançait
rapidement vers nous. Pendant quelques minutes, le mauvais
plaisant jouit tout à son aise de la confusion et de l’alarme produites
par son mensonge ; les prétendus Mecquains, tremblants
de peur, semblaient près de s’évanouir, les femmes poussaient
des gémissements lamentables, chacun s’empressait de saisir
ses armes. Enfin quelques-uns de nos compagnons, plus hardis
que les autres, voulurent reconnaître de quel côté s’approchait
l’ennemi; ils rapportèrent la consolante assurance que les nouvelles
données par le nègre étaient une pure fable. La frayeur
fit alors place à la colère, et Ghorra courut grand risque d’être
sévèrement châtié de sa fausse alerte.
Fatigués d’une marche de douze heures au milieu d’une plaine
basse, dont l’atmosphère est beaucoup plus lourde que celle du
Djebel-Shomer, nous ne pûmes retenir une exclamation de joie
quand nous découvrîmes enfin la ville de Bereydah, après la quelle
nous soupirions depuis si longtemps. La vue qui s’offrait
à nos yeux aurait tenté le pinceau de Turner. Une énorme tour,
haute de cent pieds au moins, un minaret presque aussi élevé,
des fortifications comme nous n’en avions pas encore rencontré
en Arabie, des bois de palmiers et d’ithels, tout cela, éclairé
par la magique lumière de l’Orient, formait un tableau dont la
magnificence surpassait ce que j ’avais rêvé. Une lieue seulement
nous séparait de la ville, et nous étions impatients d’y pénétrer,
lorsque Moubarek nous fit quitter la grande route pour