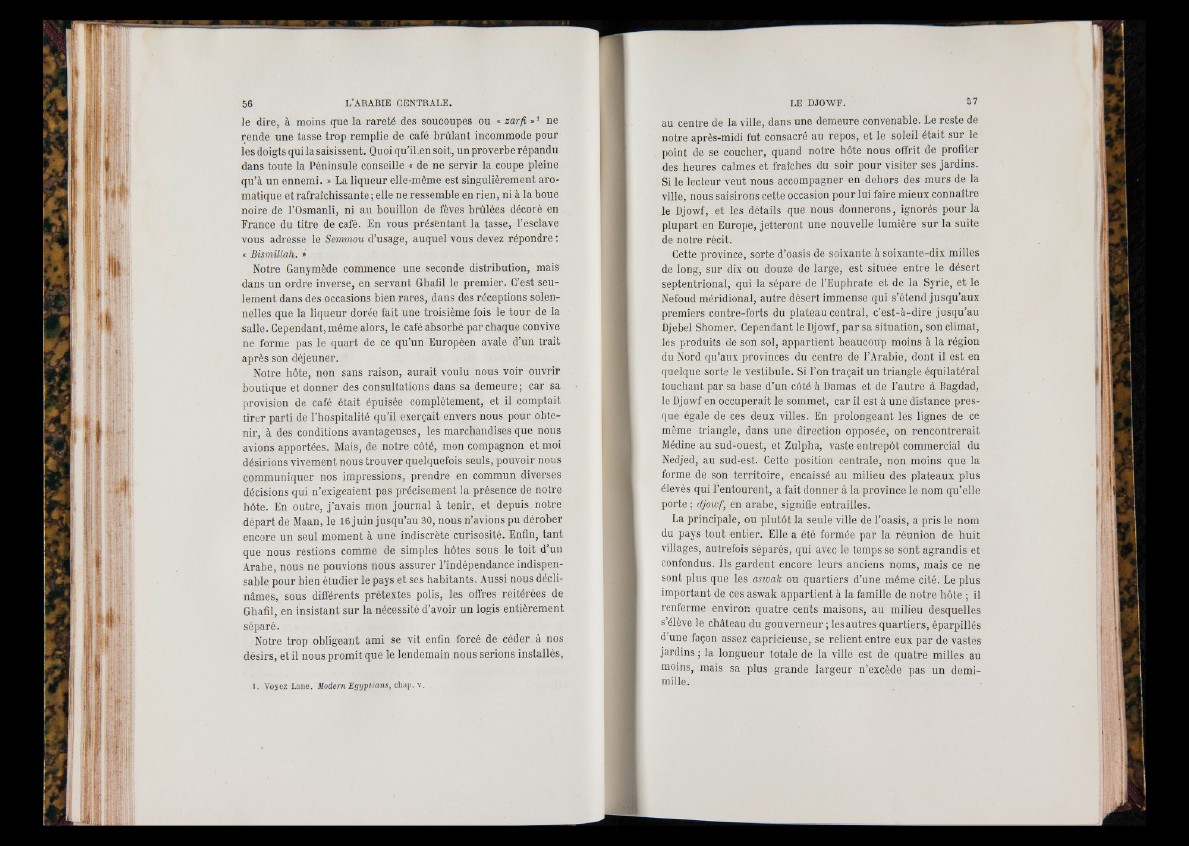
le dire, à moins que la rareté des soucoupes ou * zarfi »* ne
rende une tasse trop remplie de café brûlant incommode pour
les doigts qui la saisissent. Quoi qu’il .en soit, un proverbe répandu
dans toute la Péninsule conseille « de ne servir la coupe pleine
qu’à un ennemi. » La liqueur elle-même est singulièrement a ro matique
et rafraîchissante ; elle ne ressemble en rien, ni à la boue
noire de l ’Osmanli, ni au bouillon de fèves brûlées décoré en
France du titre de café. En vous présentant la tasse, l’esclave
vous adresse le Semmou d’usage, auquel vous devez répondre :
« Bismïllah. »
Notre Ganymède commence une seconde distribution, mais
dans u n ordre inverse, en servant Ghafil le premier. C’est seulement
dans des occasions bien ra re s, dans des réceptions solennelles
que la liqueur dorée fait une troisième fois le to u r de la
salle. Cependant, même alors, le café absorbé par chaque convive
ne forme pas le q uart de ce qu’un Européen avale d’un trait
après son déjeuner.
Notre hôte, non sans raison, au ra it voulu nous voir ouvrir
boutique et donner des consultations dans sa demeure ; car sa
provision de café était épuisée complètement, et il comptait
tire r parti de l’hospitalité qu’il exerçait envers nous pour obtenir,
à des conditions avantageuses, les marchandises que nous
avions apportées. Mais, de notre côté, mon compagnon et moi
désirions vivement nous trouver quelquefois seuls, pouvoir nous
communiquer nos impressions, prendre en commun diverses
décisions qui n ’exigeaient pas précisément la présence de notre
hôte. En outre, j ’avais mon jo u rn a l à ten ir, e t depuis notre
départ de Maan, le 16 ju in jusqu’au 30, nous n’avions pu dérober
encore u n seul moment à une indiscrète curisosité. Enfin, ta n t
que nous restions comme de simples hôtes sous le toit d’un
Arabe, nous ne pouvions nous assurer l ’indépendance indispensable
pour bien étudier le pays et ses habitants. Aussi nous déclinâmes,
sous différents prétextes polis, les offres reitérées de
Ghafil, en insistant su r la nécessité d’avoir un logis entièrement
séparé.
Notre trop obligeant ami se vit enfin forcé de céder à nos
désirs, e t il nous p romit que le lendemain nous serions installés,
1. Voyez Lane. Modern Egyptians, chap. v.
au centre de la ville, dans une demeure convenable. Le reste de
notre après-midi fut consacré au repos, et le soleil était sur le
point de se coucher, quand notre hôte nous offrit de profiter
des heures calmes et fraîches du soir pour visiter ses jardins.
Si le lecteur veut nous accompagner en dehors des murs de la
ville, nous saisirons cette occasion pour lui faire m ieux connaître
le Djowf, et les détails que nous donnerons, ignorés pour la
plupart en Europe, je tteront une nouvelle lumière su r la suite
de notre récit.
Cette province, sorte d’oasis de soixante à soixante-dix milles
de long, sur dix ou douze de large, est située entre le désert
septentrional, qui la sépare de l’Euphrate et de la Syrie, e t le
Nefoud méridional, autre désert immense qui s’étend ju sq u ’aux
premiers contre-forts du plateau central, c’e s t-à -d ire jusqu’au
Djebel Shomer. Cependant le Djowf, p a r sa situation, son climat,
les produits de son sol, appartient beaucoup moins à la région
du Nord qu’aux provinces du centre de l’Arabie, dont il est en
quelque sorte le vestibule. Si l’on traç ait un triangle équilatéral
touchant par sa base d’un côté à Damas e t de l’au tre à Bagdad,
le Djowf en occuperait le sommet, car il est à une distance presque
égale de ces deux villes. En prolongeant les lignes de ce
môme triangle, dans une direction opposée, on ren co n tre ra it
Médine au sud-ouest, et Zulpha, vaste entrepôt commercial du
Nedjed, au sud-est. Cette position centrale, non moins que la
forme de son te rrito ire , encaissé au milieu des plateaux plus
élevés qui l’entourent, a fait donner à la province le nom qu’elle
porte ; djowf, en arabe, signifie entrailles.
La principale, ou plutôt la seule ville de l’oasis, a pris le nom
du pays to u t entier. Elle a été formée p ar la réunion de h u it
villages, autrefois séparés, qui avec le temps se sont agrandis et
confondus. Ils gardent encore leurs anciens noms, mais ce ne
sont plus que les aswak ou quartiers d’une même cité. Le plus
important de ces aswak appa rtient à la famille de n otre hôte ; il
renferme environ quatre cents maisons, au milieu desquelles
s’élève le château du gouverneur ; les autres q u artiers, éparpillés
d’une façon assez capricieuse, se relient entre eux p ar de vastes
jardins ; la longueur totale de la ville est de q u atre milles au
moins, mais sa plus grande largeur n ’excède pas un demi-
mille.