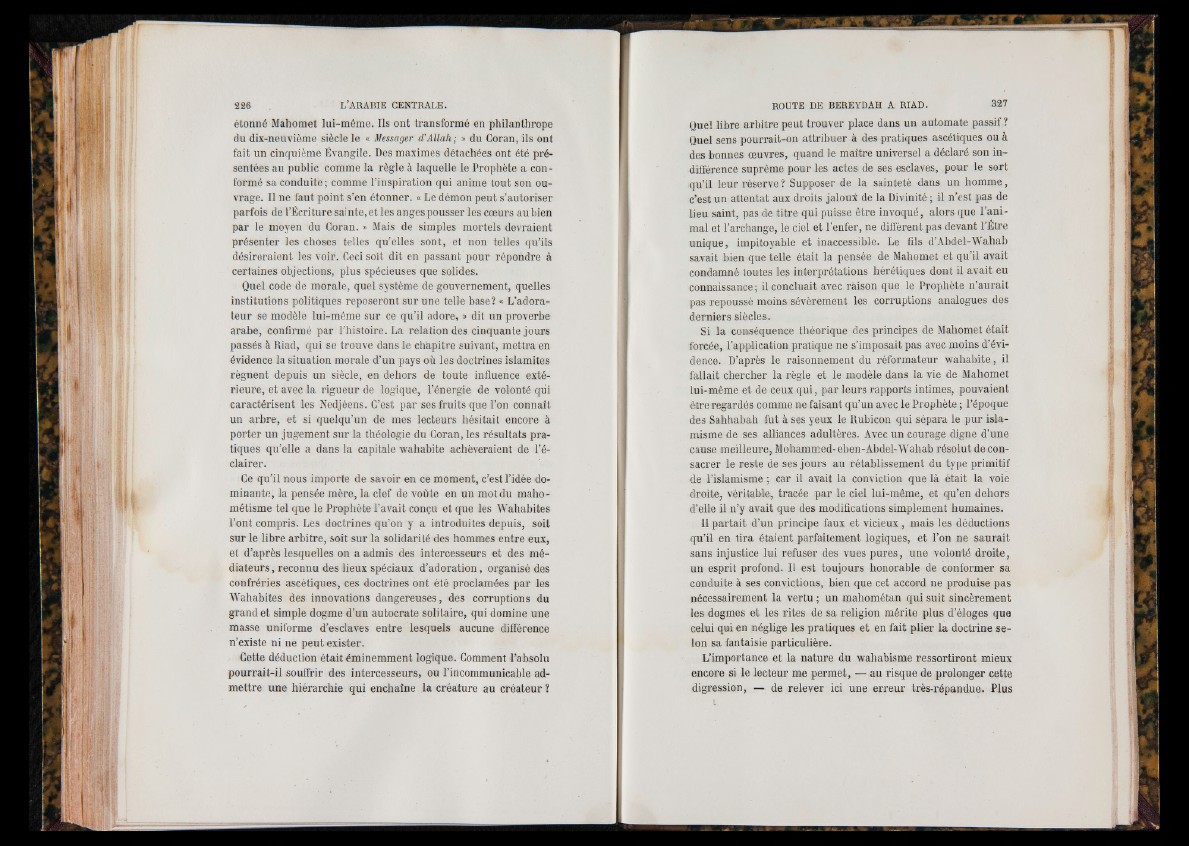
étonné Mahomet lui-même. Ils ont transformé en philanthrope
du dix-neuvième siècle le « Messager d’Allah; » du Coran, ils ont
fait un cinquième Évangile. Des maximes détachées ont été présentées
au public comme la règle à laquelle le Prophète a conformé
sa conduite ; comme l’inspiration qui anime tout son ouvrage.
Il ne faut point s’en étonner. « Le démon p eut s’autoriser
parfois de l’Écriture sainte, et les anges pousser les coeurs au bien
p ar le moyen du Coran. » Mais de simples mortels devraient
présenter les choses telles qu’elles sont, et non telles qu’ils
désireraient les voir. Ceci soit dit en passant pour répondre à
certaines objections, plus spécieuses que solides.
Quel code de morale, quel système de gouvernement, quelles
institutions politiques reposeront su r une telle base? « L’adorate
u r se modèle lui-même sur ce qu’il adore, » dit un proverbe
arabe, confirmé par l’histoire. La relation des cinquante jo u rs
passés à Riad, qui se trouve dans le chapitre suivant, mettra en
évidence la situation morale d’un pays où les doctrines islamites
régnent depuis un siècle, en dehors de toute influence extérieu
re , et avec la rigueur de logique, l ’énergie de volonté qui
caractérisent les Nedjéens. C’est p a r ses fruits que l ’on connaît
un a rb re , et si quelqu’un de mes lecteurs hésitait encore à
p o rte r un jugement su r la théologie du Coran, les résultats pratiques
qu’elle a dans la capitale wahabite achèveraient de l’é-
clairer.
Ce qu’il nous importe de savoir en ce moment, c’est l’idée dominante,
la pensée mère, la clef de voûte en un mot du mahométisme
te l que le Prophète l’avait conçu et que les Wahabites
l ’ont compris. Les doctrines qu’on y a introduites depuis, soit
su r le libre arbitre, soit sur la solidarité des hommes entre eux,
et d’après lesquelles on a admis des intercesseurs et des médiateurs
, reconnu des lieux spéciaux d’a d o ra tio n , organisé des
confréries ascétiques, ces doctrines ont été proclamées p a r les
Wahabites des innovations dangereuses, des corruptions du
grand et simple dogme d’un autocrate solitaire, qui domine une
masse uniforme d’esclaves entre lesquels aucune différence
n’existe ni ne peut exister.
Cette déduction était éminemment logique. Comment l’absolu
p o u rra it-il souffrir des intercesseurs, ou l’incommunicable admettre
une hiérarchie qui enchaîne la créature au créateur ?
Quel libre arbitre peut trouver place dans un automate passif.?
Quel sens pourrait-on attribuer à des pratiques ascétiques ou à
des bonnes oeuvres, quand le maître universel a déclaré son in différence
suprême pour les actes de ses esclaves, pour le sort
qu’il leur réserve ? Supposer de la sainteté dans un h om m e ,
c’est un attentat aux droits jaloux de la Divinité ; il n’est pas de
h eu saint, pas de titre qui puisse être invoqué, alors que l ’a n i mal
et l’archange, le ciel et l ’enfer, ne diffèrent pas devant l’Être
unique, impitoyable e t inaccessible. Le fils d’Abdel-Wahab
savait bien que telle était la pensée de Mahomet e t qu’il avait
condamné toutes les interprétations hérétiques dont il ava it eu
connaissance ; il concluait avec raison que le Prophète n ’aura it
pas repoussé moins sévèrement les corruptions analogues des
derniers siècles.
Si la conséquence théorique des principes de Mahomet était
forcée, l ’application pratique ne s’imposait pas avec moins d’évidence.
D’après le raisonnement du réformateur w ah ab ite , il
fallait chercher la règle e t le modèle dans la vie de Mahomet
lui-même et de ceux q u i, p a r leurs rapports intimes, pouvaient
être regardés comme ne faisant qu’un avec le Prophète ; l’époque
des Sahhabah fut à ses yeux le Rubicon qui sépara le p u r islamisme
de ses alliances adultères. Avec un courage digne d’une
cause meilleure, Mohammed-eben-Abdel-Wahab résolut de consacrer
le reste de ses jo u rs au rétablissement du type primitif
de l ’islamisme ; car il avait la conviction que là était la voie
droite, véritable, tracée p a r le ciel lui-même, et qu’en dehors
d’elle il n ’y avait que des modifications simplement humaines.
11 p a rta it d’un principe faux e t vicieux, mais les déductions
qu’il en tira étaient parfaitement logiques, et l’on ne sa u ra it
sans injustice lui refuser des vues p u re s , une volonté droite,
un esprit profond. Il est toujours honorable de conformer sa
conduite à ses convictions, bien que cet accord ne produise pas
nécessairement la vertu ; un mahométan qui suit sincèrement
les dogmes et les rite s de sa religion mérite plus d’éloges que
celui qui en néglige les pratiques e t en fait plier la doctrine selon
sa fantaisie particulière.
L’importance et la nature du wahabisme resso rtiro n t mieux
encore si le lecteur me permet, — au risque de prolonger cette
digression, — de relever ici une e rre u r très-répandue. Plus