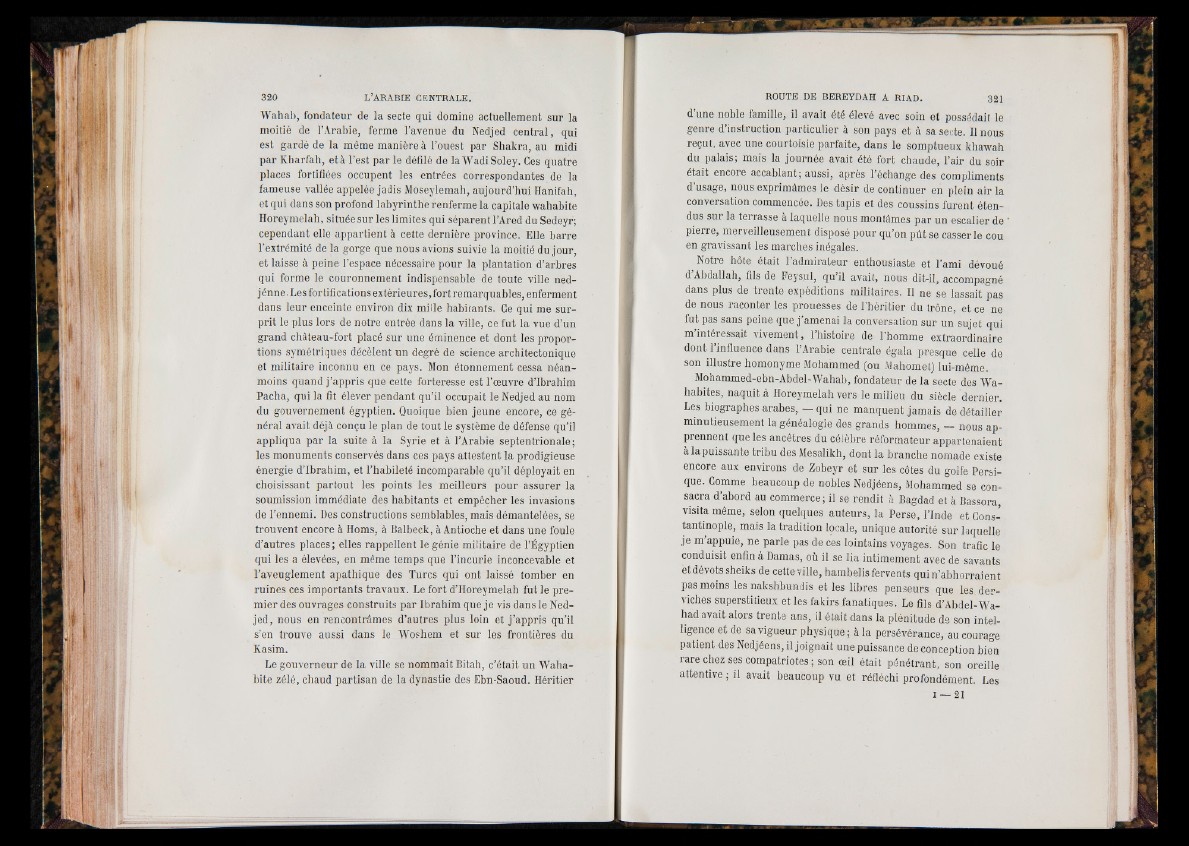
Wahab, fondateur de la secte qui domine actuellement su r la
moitié de l’Arabie, ferme l’avenue du Nedjed c e n tra l, qui
est gardé de la même manière à l’ouest par Shakra, au midi
p a r Kharfah, e tà l’est p ar le défilé de la WadiSoley. Ces quatre
places fortifiées occupent les entrées correspondantes de la
fameuse vallée appelée jadis Moseylemah, aujourd’hui Hanifah,
et qui dans son profond labyrinthe renferme la capitale w ahabite
Horeymelah, située sur les limites qui séparent l ’Ared du Sedeyr;
cependant elle appartient à cette dernière province. Elle barre
l’extrémité de la gorge que nous avions suivie la moitié du jour,
et laisse à peine l ’espace nécessaire pour la plantation d’arbres
qui forme le couronnement indispensable de toute ville ned-
jénne. Les fortifications extérieures, fort remarquables, enferment
dans leur enceinte environ dix mille habitants. Ce qui me surp
rit le plus lors de notre entrée dans la ville, ce fut la vue d’un
grand château-fort placé su r une éminence et dont les proportions
symétriques décèlent u n degré de science architectonique
et militaire inconnu en ce pays. Mon étonnement cessa néanmoins
quand j ’appris que cette forteresse est l ’oeuvre d’Ibrahim
Pacha, qui la fit élever pendant qu’il occupait le Nedjed au nom
du gouvernement égyptien. Quoique bien jeune encore, ce général
avait déjà conçu le plan de tout le système de défense qu’il
appliqua p ar la suite à la Syrie et à l’Arabie septentrionale;
les monuments conservés dans ces pays attestent la prodigieuse
énergie d’Ibrahim, et l’habileté incomparable qu’il déployait en
choisissant partout les points les meilleurs pour assurer la
soumission immédiate des habitants et empêcher les invasions
de l’ennemi. Des constructions semblables, mais démantelées, se
trouvent encore à Homs, à Balbeck, à Antioche e t dans une foule
d’autres places; elles rappellent le génie militaire de l’Égyptien
qui les a élevées, en même temps que l ’incurie inconcevable et
l ’aveuglement apathique des Turcs qui ont laissé tomber en
ruines ces importants travaux. Le fort d’Horeymelah fut le premie
r des ouvrages construits par Ibrahim que je vis dans le Nedjed
, nous en rencontrâmes d’autres plus loin et j ’appris qu’il
s’en trouve aussi dans le Woshem et sur les frontières du
Kasim.
Le gouverneur de la ville se nommait Bitah, c’était un Wahabite
zélé, chaud partisan de la dynastie des Ebn-Saoud. Héritier
d’une noble famille, il avait été élevé avec soin et possédait le
genre d’instruction particulier à son pays et à sa secte. Il nous
reçut, avec une courtoisie parfaite, dans le somptueux khawah
du palais; mais la journée avait été fort chaude, l’air du soir
était encore accablant; aussi, après l’échange des compliments
d usage, nous exprimâmes le désir de continuer en plein air la
conversation commencée. Des tapis et des coussins furent étendus
sur la terrasse à laquelle nous montâmes p a r un escalier de
pierre, merveilleusement disposé pour qu’on p û t se casser le cou
en gravissant les marches inégales.
Notre hôte était l ’admirateur enthousiaste et l’ami dévoué
d Abdallah, fils de Feys.ul, q u il avait, nous dit-il, accompagné
dans plus de tren te expéditions militaires. Il ne se lassait pas
de nous raconter les prouesses de l ’héritier du trône, et ce ne
fut pas sans peine que j ’amenai la conversation sur un sujet qui
m’intéressait vivement, l’histoire de l ’homme extraordinaire
dont l’influence dans l’Arabie centrale égala presque celle de
son illustre homonyme Mohammed (ou Mahomet) lui-même.
Mohammed-ebn-Abdel-Wahab, fondateur de la secte des Wa-
habites, naquit à Horeymelah vers le milieu du siècle dernier.
Les biographes arabes, — qui ne manquent jamais de détailler
minutieusement la généalogie des grands hommes, — nous a p prennent
que les ancêtres du célèbre réformateur appartenaient
à la puissante trib u des Mesalikh, dont la branche nomade existe
encore aux environs de Zobeyr et sur les côtes du golfe Persi-
que. Gomme beaucoup de nobles Nedjéens, Mohammed se consacra
d’abord au commerce; il se rendit à Bagdad et à Bassora,
visita même, selon quelques auteurs, la Perse, l’Inde et Cons-
tantinople, mais la tradition locale, unique autorité su r laquelle
je m appuie, ne parle pas de ces lointains voyages. Son trafic le
conduisit enfin à Damas, où il se lia intimement avec de savants
et dévots sheiks de cette ville, hambelis fervents qui n’abhorraient
pas moins les nakshbundis et les libres penseurs que les d e r viches
superstitieux et les fakirs fanatiques. Le fils d’Abdel-Wa-
had avait alors trente ans, il était dans la plénitude de son intelligence
et de sa vigueur physique ; à la persévérance, au courage
patient des Nedjéens, il joignait une puissance de conception bien
rare chez ses compatriotes ; son oeil était pénétrant, son oreille
attentive ; il avait beaucoup vu et réfléchi profondément. Les
1 — 21