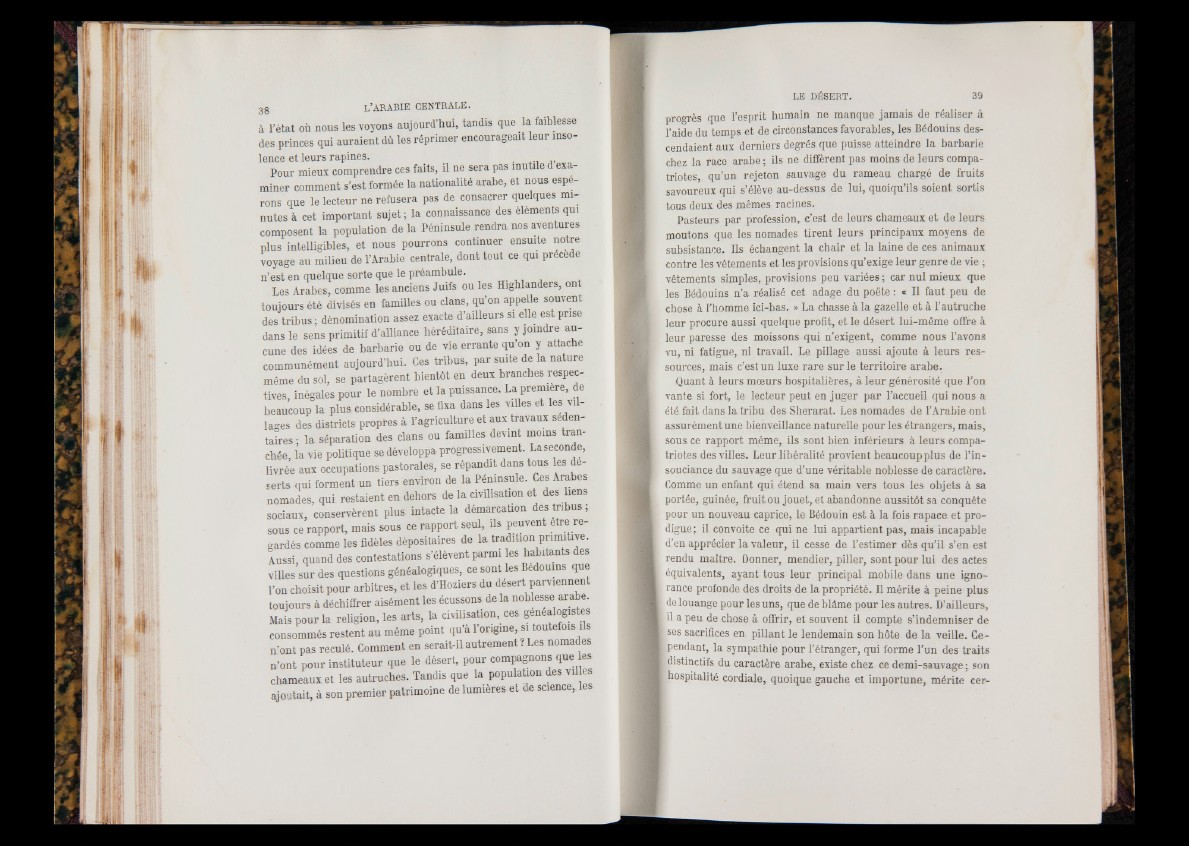
à l’état où nous les voyons aujourd’hui, tandis que la faiblesse
des princes qui auraient dû les réprimer encourageait leu r insolence
et leurs rapines. .
Pour mieux comprendre ces faits, il ne sera pas mutile d examiner
comment s’est formée la nationalité arabe, et nous espérons
que le lecteur ne refusera pas de consacrer quelques min
u te s à cet important su je t; la connaissance des elements qui
composent la population de la Péninsule rendra nos aventures
plus intelligibles, et nous pourrons continuer ensuite notre
voyage au milieu de l’Arabie centrale, dont to u t ce qui précédé
n’est en quelque sorte que le préambule.
Les Arabes, comme les anciens Juifs ou les Highlanders, ont
toujours été divisés en familles ou clans, qu’on appelle souvent
des trib u s ; dénomination assez exacte d’ailleurs si elle est prise
dans le sens primitif d'alliance héréditaire, sans y joindre au cune
des idées de b a rb a rie ou de vie e rran te qu’on y attache
communément aujourd’hui. Ces trib u s, p a r suite de la n atu re
même du sol, se p a rtag è ren t bientôt en deux branches respectives,
inégales pour le nombre et la puissance. La première, de
beaucoup la plus considérable, se fixa dans les villes e t les villages
des districts propres à l’agriculture e t aux travaux sédentaires
; la séparation des clans ou familles devint moins tran chée
la vie politique s e développa progressivement. Laseconde,
livrée aux occupations pastorales, se répandit dans tous les dése
rts qui forment un tiers environ de la Péninsule. Ces Arabes
nomades, qui restaient en dehors de la civilisation e t des liens
sociaux, conservèrent plus intacte la démarcation des tr ib u s ;
sous ce rapport, mais sous ce rapport seul, Us peuvent etre re gardés
comme les fidèles dépositaires de la tradition primitive.
Aussi, quand des contestations s’élèvent parmi les habitants des
villes su r des questions généalogiques, ce sont les Bédouins que
l ’on choisit pour arb itre s, e t les d’Hoziers du désert parviennent
toujours à déchiffrer aisément les écussons de la noblesse arabe.
Mais pour la religion, les arts, la civüisation, ces généalogistes
consommés re ste n t au même point qu’à l ’origme, si toutefois ils
n ’ont pas reculé. Comment en serait-il a u trem e n t. Les nomades
n’ont p o u r in stitu te u r que le désert, pour compagnons que es
chameaux et les autruches. Tandis que la population des vil es
ajoutait, à son p remier patrimoine de lumières e t de science, les
progrès que l’esprit humain ne manque jamais de réaliser à
l’aide du temps et de circonstances favorables, les Bédouins descendaient
aux derniers degrés que puisse atteindre la barbarie
chez la race arabe ; ils ne diffèrent pas moins de leu rs compatriotes,
qu’un rejeton sauvage du rameau chargé de fruits
savoureux qui s’élève au-dessus de lui, quoiqu’ils soient sortis
tous deux des mêmes racines.
Pasteurs par profession, c’est de leurs chameaux e t de leurs
moutons que les nomades tire n t leu rs principaux moyens de
subsistance. Ils échangent la chair e t la laine de ces animaux
contre les vêtements e t les provisions q u’exige leu r genre de vie ;
vêtements simples, provisions peu variées ; car nul mieux que
les Bédouins n ’a réalisé cet adage du poète : « Il faut peu de
chose à l’homme ici-bas. » La chasse à la gazelle et à l’autruche
leur procure aussi quelque profit, et le désert lui-même offre à
leur paresse des moissons qui n’exigent, comme nous l’avons
vu, ni fatigue, ni travail. Le pillage aussi ajoute à leurs re s sources,
mais c’est un luxe ra re su r le te rrito ire arabe.
Quant à leurs m oeurs hospitalières, à le u r générosité que l’on
vante si fort, le lecteur peut en ju g e r p a r l’accueil qui nous a
été fait dans la tribu des Sherarat. Les nomades de l’Arabie ont
assurément une bienveillance naturelle pour les étrangers, mais,
sous ce rapport même, ils sont bien inférieurs à leu rs compatriotes
des villes. Leur libéralité provient beaucoup plus de l’in souciance
du sauvage que d’une véritable noblesse de caractère.
Comme un enfant qui étend sa main vers to u s les objets à sa
portée, guinée, fru it ou jouet, et abandonne aussitôt sa conquête
pour u n nouveau caprice, le Bédouin est à la fois rapa ce et prodigue;
il convoite ce qui ne lui appartient pas, mais incapable
d’en apprécier la v aleur, il cesse de l’estimer dès qu’il s’en est
rendu maître. Donner, mendier, piller, sont p our lu i des actes
équivalents, ayant tous le u r principal mobile dans un e ignorance
profonde des droits de la propriété. Il mérite à peine plus
I de louange pour les uns, que de blâme pour les autres. D’ailleurs,
S il a peu de chose à offrir, e t souvent il compte s’indemniser de
I ses sacrifices en pillant le lendemain son hôte de la veille. Ce-
I pendant, la sympathie pour l’étranger, qui forme l’u n des tra its
Idistinctifs du caractère arabe, existe chez ce demi-sauvage; son
1 hospitalité cordiale, quoique gauche et importune, mérite cer