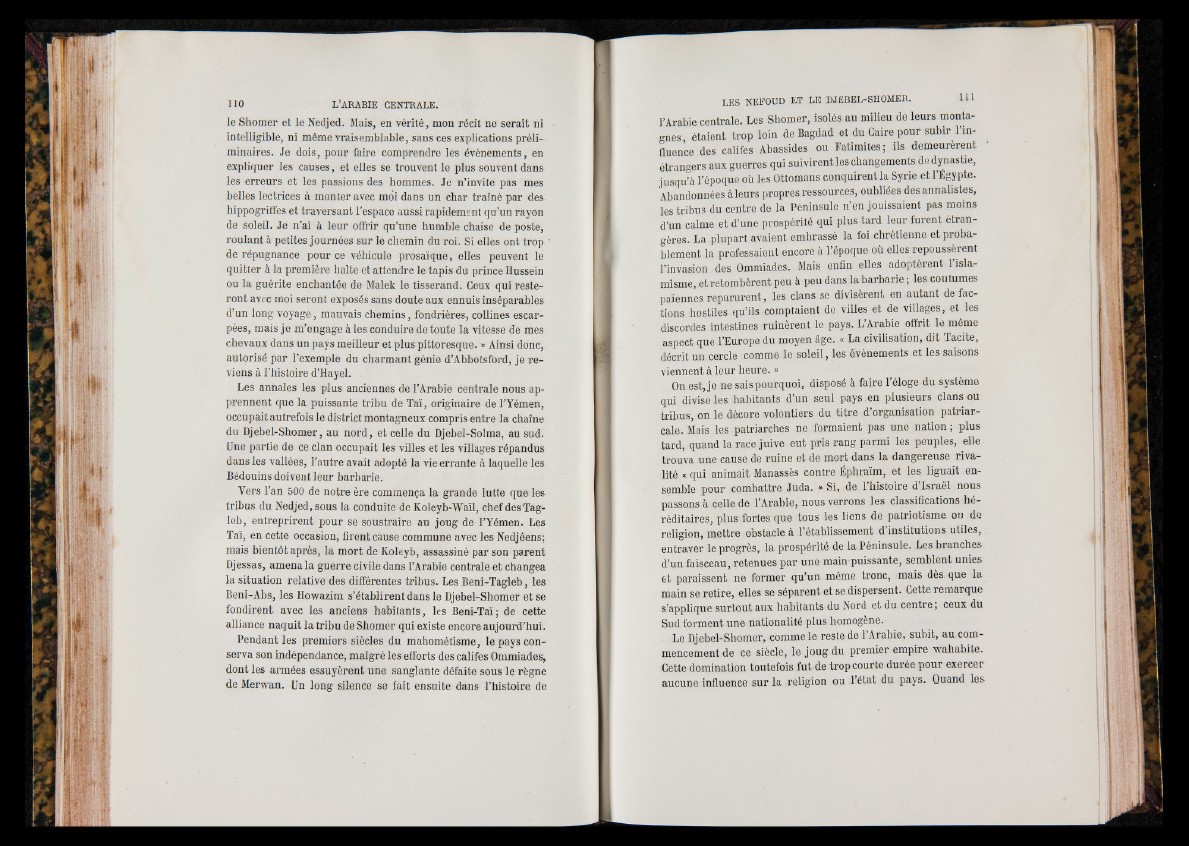
le Shomer et le Nedjed. Mais, en vérité, mon récit ne serait ni
intelligible, ni même vraisemblable, sans ces explications préliminaires.
Je dois, pour faire comprendre les événements, en
expliquer les causes, et elles se trouvent le plus souvent dans
les erreurs et les passions des hommes. Je n’invite pas mes
belles lectrices à monter avee moi dans un char traîné par des
hippogriffes et traversant l’espace aussi rapidement qu’un rayon
de soleil. Je n’ai à leur offrir qu’une humble chaise de poste,
roulant à petites journées sur le chemin du roi. Si elles ont trop
de répugnance pour ce véhicule prosaïque, elles peuvent le
q u itte r à la première halte et attendre le tapis du prince Hussein
ou la guérite enchantée de Malek le tisserand. Ceux qui restero
n t avec moi seront exposés sans doute aux ennuis inséparables
d’un long voyage, mauvais chemins, fondrières, collines escarpées,
mais je m’engage à les conduire de toute la vitesse de mes
chevaux dans un pays meilleur et plus pittoresque. * Ainsi donc,,
autorisé p ar l ’exemple du charmant génie d’Abbotsford, je re viens
à l ’histoire d’Hayel.
Les annales les plus anciennes de l’Arabie centrale nous apprennent
que la puissante trib u de Taï, originaire de l’Yémen,
occupait autrefois le district montagneux compris entre la chaîne
du Djebel-Shomer, au n o rd , et celle du Djebel-Solma, au sud.
Une partie de ce clan occupait les villes et les villages répandus
dans les vallées, l’autre avait adopté la vie errante à laquelle les
Bédouins doivent leur barbarie.
Vers l ’an 500 de notre ère commença la grande lutte que les
tribus du Nedjed, sous la conduite de Koleyb-Waïl, chef des Tag-
leb, en trep riren t pour se soustra ire au joug de l ’Yémen. Les
Taï, en cette occasion, firent cause commune avec les Nedjéens;
mais bientôt après, la mort de Koleyb, assassiné par son parent
Djessas, amena la g uerre civile dans l’Arabie centrale et changea
la situation relative des différentes tribus- Les Beni-Tagleb, les
Beni-Abs, les Howazim s’établirent dans le Djebel-Shomer et se
fondirent avec les anciens habitants, les Beni-Taï; de cette
alliance naq u it la trib u de Shomer qui existe encore aujourd’hui.
Pendant les premiers siècles du mahométisme, le pays conserva
son indépendance, m algré les efforts des califes Ommiades,
dont les armées essuyèrent une sanglante défaite sous le règne
de Merwan. Un long silence se fait ensuite dans l ’histoire de
l’Arabie centrale. Les Shomer, isolés au milieu de leurs montagnes,
étaient trop loin de Bagdad et du Caire pour subir l’influence
des califes Abassides ou Fatimites; ils demeurèrent
étrangers aux guerres qui suivirent les changements de dynastie,
jusqu’à l’époque où les Ottomans conquirent la Syrie et l'Egypte.
Abandonnées àleu rs propres ressources, oubliées dés annalistes,
les tribus du centre de la Péninsule n en jouissaient pas moins
d’un calme et d’une prospérité qui plus ta rd leur furent é tra n gères.
La plupart avaient embrassé la foi chrétienne et pro b ablement
la professaient encore à l’époque où elles repoussèrent
l’invasion des Ommiades. Mais enfin elles adoptèrent l’islamisme,
et retombèrent peu à peu dans la barbarie ; les coutumes
païennes rep a ru ren t, les clans se divisèrent en autant de factions
hostiles qu’ils comptaient de villes et de villages, et les
discordes intestines ru in èren t le pays. L’Arabie offrit le même
aspect que l ’Europe du moyen âge. «■ La civilisation, dit Tacite,
décrit un cercle comme le so le il, les événements et les saisons
viennent à leu r heure. »
On est, je ne sais pourquoi, disposé à faire l’éloge du système
qui divise les habitants, d’un seul pays en plusieurs clans ou
tribus, on le décore volontiers du titre d’organisation p a tria rcale.
Mais les patriarches ne formaient pas une n a tio n ; plus
ta rd, quand la race juive eut pris rang parmi les peuples, elle-
trouva une cause de ruine et de mort dans la dangereuse riv alité
« qui animait Manassès contre Éphraïm, et les liguait en semble
pour combattre Juda. » Si, de l ’histoire d’Isra ël nous
passons à celle de l’Arabie, nous verrons les classifications h é réditaires,
plus fortes que tous les liens de patriotisme ou de
religion, mettre obstacle à l’établissement d institutions utiles,
entraver le progrès, la prospérité de la P éninsule. Les branches
d’un faisceau, retenues p a r une main puissante, semblent unies
et paraissent ne former qu’u n même tronc, mais dès. que la
main se retire, elles se séparent et se dispersent. Cette rema rque
s’applique su rto u t aux habitants du Nord et du c e n tre , ceux du
Sud forment une nationalité plus homogène.
Le Djebel-Shomer, comme le reste de l ’Arabie, subit, au commencement
de ce siècle, le jo u g du premier empire wahabite.
Cette domination toutefois fu t de trop courte durée p o u r exercer
aucune influence su r la religion ou l’é ta t du pays. Quand les