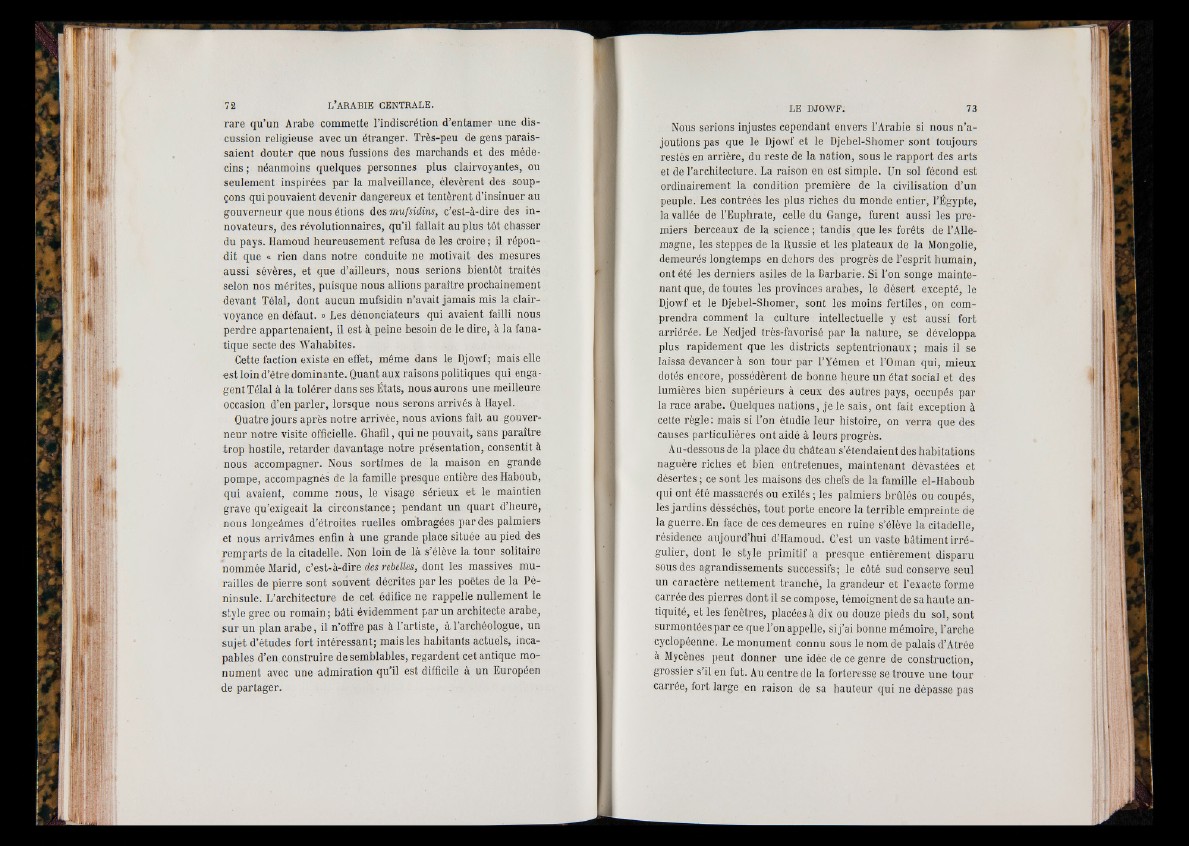
ra re qu’un Arabe commette l’indiscrétion d’entamer une discussion
religieuse avec un étranger. Très-peu de gens paraissaient
douter que nous fussions des marchands et des médecins
; néanmoins quelques personnes plus clairvoyantes, ou
seulement inspirées par la malveillance, élevèrent des soupçons
qui pouvaient devenir dangereux et tentèrent d’insinuer au
gouverneur que nous étions des mufsidins, c’est-à-dire des in novateurs,
des révolutionnaires, qu’il fallait au plus tôt chasser
du pays. Hamoud heureusement refusa de les croire ; il répond
it que « rien dans notre conduite ne motivait des mesures
aussi sévères, et que d’ailleurs, nous serions bientôt traités
selon nos mérites, puisque nous allions p araître prochainement
devant Télal, dont aucun mufsidin n’avait jamais mis la clairvoyance
en défaut. » Les dénonciateurs qui avaient failli nous
perdre appartenaient, il est à peine besoin de le dire, à la fanatique
secte des Wahabites.
Cette faction existe en effet, même dans le Djowf; mais elle
e s t loin d’être dominante. Quant aux raisons politiques qui engagent
Télal à la to lé rer dans ses États, nous aurons une meilleure
occasion d’en p a rle r, lorsque nous serons arrivés à Hayel.
Quatre jours après notre arrivée, nous avions fait au gouvern
eu r notre visite officielle. Ghafil, qui ne pouvait, sans paraître
trop hostile, re ta rd e r davantage notre présentation, consentit à
nous accompagner. Nous sortîmes de la maison en grande
pompe, accompagnés de la famille presque entière des Haboub,
qui avaient, comme nous, le visage sérieux et le maintien
grave qu’exigeait la circonstance ; pendant u n q u a rt d’heure,
nous longeâmes d’étroites ruelles ombragées p a r des palmiers
et nous arrivâmes enfin à une grande place située au pied des
remparts de la citadelle. Non loin de là s’élève la to u r solitaire
nommée Marid, c’est-à-dire des rebelles, dont les massives murailles
de pierre sont souvent décrites par les poètes de la Péninsule.
L’architecture de cet édifice ne rappelle nullement le
style grec ou romain; bâti évidemment par un architecte arabe,
s u r un plan arab e , il n’offre pas à l’artiste, à l ’archéologue, un
su je t d’études fort inté ressant; mais les habitants actuels, incapables
d’en construire de semblables, regardent cet antique mon
ument avec une admiration qu’il est difficile à un Européen
de partager.
Nous serions injustes cependant envers l’Arabie si nous n ’a joutions
pas que le Djowf e t le Djebel-Shomer sont toujours
restés en arrière, du reste de la nation, sous le rapport des arts
et de l’architecture. La raison en est simple. Un sol fécond est
ordinairement la condition première de la civilisation d’un
peuple. Les contrées les plus riches du monde entier, l’Ëgypte,
la vallée de l’Euphrate, celle du Gange, furent aussi les p re miers
berceaux de la science ; tandis que les forêts de l’Allemagne,
les steppes de la Russie et les plateaux de la Mongolie,
demeurés longtemps en dehors des progrès de l’esprit humain,
ont été les derniers asiles de la Barbarie. Si l ’on songe maintenant
que, de toutes les provinces arabes, le désert excepté, le
Djowf et le Djebel-Shomer, sont les moins fertiles, on comprendra
comment la culture intellectuelle y est aussi fort
arriérée. Le Nedjed très-favorisé p a r la nature, se développa
plus rapidement que les districts septentrionaux ; mais il se
laissa devancer à son tour par l ’Yémen et l’Oman qui, mieux
dotés encore, possédèrent de bonne heure un état social et des
lumières bien supérieurs à ceux des autres pays, occupés par
la race arabe. Quelques nations, je le sais, ont fait exception à
cette règle: mais si l’on étudie leur histoire, on verra que des
causes particulières ont aidé à leurs progrès.
Au-dessous de la place du château s’étendaient des habitations
naguère riches et bien entretenues, maintenant dévastées et
désertes ; ce sont les maisons des chefs de la famille el-Haboub
qui ont été massacrés ou exilés ; les palmiers brûlés ou coupés,
lès jardins désséchés, to u t porte encore la terrible empreinte de
la guerre.En face de ces demeures en ruine s'élève la citadelle,
résidence aujourd’hui d-Hamoud. C’est un vaste bâtiment irré gulier,
dont le style primitif a presque entièrement disparu
sous des agrandissements successifs ; le côté sud conserve seul
un caractère nettement tranché, la grandeur et l’exacte forme
carrée des pierres dont il se compose, témoignent de sa haute a n tiquité,
et les fenêtres, placéesà dix ou douze pieds du sol, sont
surmontées par ce que l’on appelle, si j’ai bonne mémoire, l’arche
cyclopéenne. Le monument connu sous le nom de palais d’Atrée
à Mycènes peut donner une idée de ce genre de construction,
grossier s’il en fut. Au centre de la forteresse se trouve une to u r
carrée, fort large en raison de sa hauteur qui ne dépasse pas