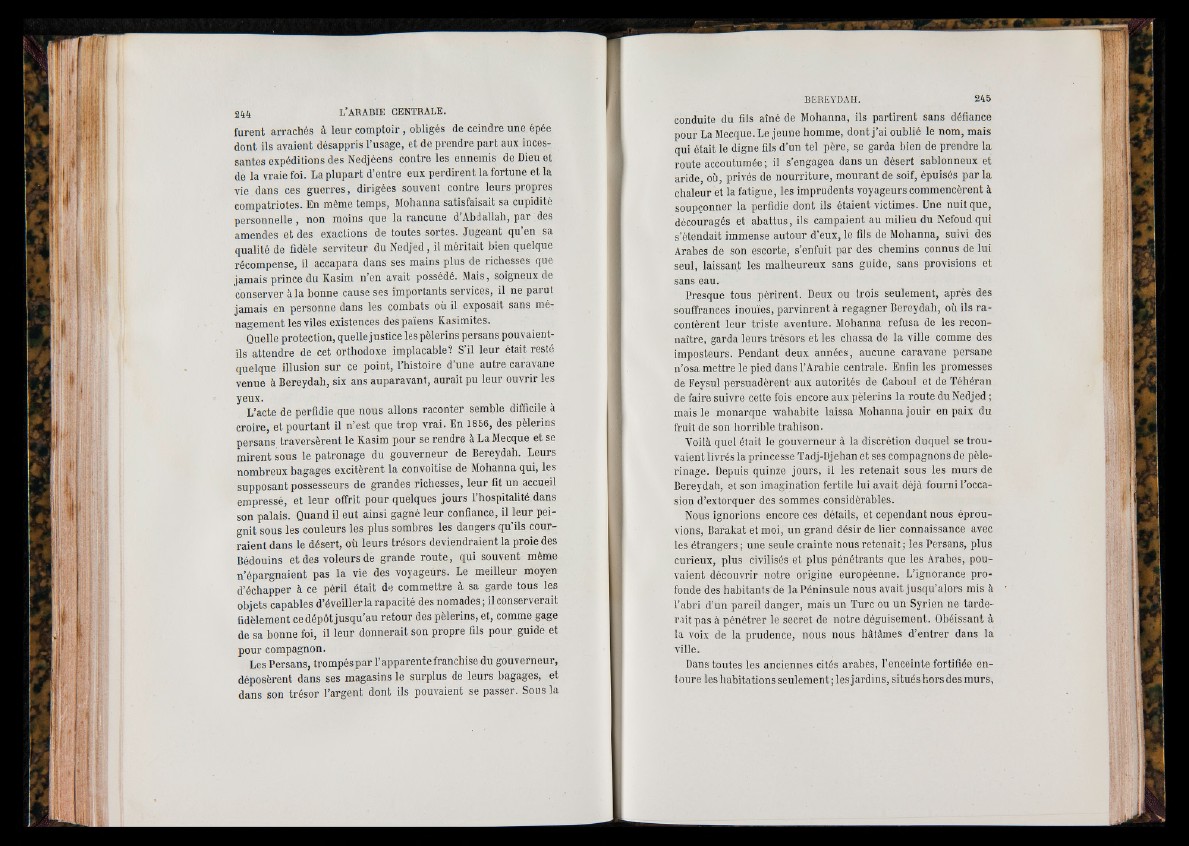
furent arrachés à leu r com ptoir, obligés de ceindre une épée
dont ils avaient désappris l’usage, et de prendre p a rt aux incessantes
expéditions des Nedjéens contre les ennemis de Dieu et
de la vraie foi. La p lu p a rt d’entre eux perdirent la fortune e t la
vie dans ces g u e rre s , dirigées souvent contre leurs propres
compatriotes. En même temps, Mohanna satisfaisait sa cupidité
p erso n n e lle , non moins que la rancune d’Abdallah, par des
amendes e t des exactions de toutes sortes. Jugeant qu’en sa
qualité de fidèle serviteur du Nedjed, il méritait bien quelque
récompense, il accapara dans ses mains plus de richesses que
jamais prince du Kasim n ’en avait possédé. Mais, soigneux de
conserver à la bonne cause ses importants services, il ne p arut
jamais en personne dans les combats où il exposait sans ménagement
les viles existences des païens Kasimites.
Quelle protection, quelle justice les pèlerins persans pouvaient-
ils attendre de cet orthodoxe implacable? S’il leur était resté
quelque illusion sur ce point, l’histoire d’une autre caravane
venue à Bereydah, six ans auparavant, aurait pu leu r ouvrir les
yeux.
L’acte de perfidie que nous allons raconter semble difficile à
croire, et p o u rtan t il n’est que trop vrai. En 1856, des pèlerins
persans trave rsèrent le Kasim pour se rendre à La Mecque et se
m iren t sous le patronage du gouverneur de Bereydah. Leurs
nombreux bagages excitèrent la convoitise de Mohanna qui, les
supposant possesseurs de grandes richesses, le u r fit un accueil
empressé, et leu r offrit pour quelques jo u rs l’hospitalité dans
son palais. Quand il eut ainsi gagné leur confiance, il leu r peignit
sous les couleurs les plus sombres les dangers qu’ils courra
ien t dans le désert, où leu rs trésors deviendraient la proie des
Bédouins e t des voleurs de grande ro u te , qui souvent même
n’épargnaient pas la vie des voyageurs. Le meilleur moyen
d’échapper à ce péril était de commettre à sa garde tous les
objets capables d’éveiller la rapacité des nomades ; il conserverait
fidèlement ce dépôt jusqu’au re to u r des pèlerins, et, comme gage
de sa bonne foi, il leu r donnerait son propre fils pour guide et
pour compagnon.
Les Persans, trompéspar l’apparente franchise du gouverneur,
déposèrent dans ses magasins le surplus de leurs bagages, et
dans son tréso r l ’argent dont ils pouvaient se passer. Sous la
conduite du fils aîné de Mohanna, ils p a rtiren t sans défiance
pour La Mecque. Le jeune homme, dont j ’ai oublié le nom, mais
qui était le digne fils d’un tel père, se garda bien de prendre la
route accoutumée ; il s’engagea dans un désert sablonneux et
aride, où, privés de n o u rritu re , mourant de soif, épuisés p a r la
chaleur et la fatigue, les imprudents voyageurs commencèrent à
soupçonner la perfidie dont ils étaient victimes. Une nuit que,
découragés et aba ttus, ils campaient au milieu du Nefoud qui
s’étendait immense autour d’eux, le fils de Mohanna, suivi des
Arabes de son escorte, s’enfuit par des chemins connus de lui
seul, laissant les malheureux sans guide, sans provisions et
sans eau.
Presque tous périrent. Deux ou trois seulement, après des
souffrances inouïes, parvinrent à regagner Bereydah, où ils r a contèrent
leur tris te aventure. Mohanna refusa de les reconnaître,
garda leurs trésors et les chassa de la ville comme des
imposteurs. Pendant deux années, aucune caravane persane
n ’osa mettre le pied dans l’Arabie centrale. Enfin les promesses
de Feysul persuadèrent- aux autorités de Caboul et de Téhéran
de faire suivre cette fois encore aux pèlerins la route du Nedjed ;
mais le monarque wababite laissa Mohanna jo u ir en paix du
fruit de son horrible trahison.
Voilà quel était le gouverneur à la discrétion duquel se tro u vaient
livrés la princesse Tadj-Djehan e t ses compagnons de pèlerinage.
Depuis quinze jours, il les re ten a it sous les murs de
Bereydah, et son imagination fertile lui ava it déjà fourni l’occasion
d’extorquer des sommes considérables.
Nous ignorions encore ces détails, et cependant nous éprouvions,
Barakat et moi, un grand désir de lie r connaissance avec
les étrangers ; une seule crainte nous retenait ; les Persans, plus
curieux, plus civilisés et plus pénétrants que les Arabes, pouvaient
découvrir notre origine européenne. L’ignorance profonde
des habitants dé la Péninsule nous avait ju sq u ’alors mis à
l’abri d’un pareil danger, mais u n Turc ou un Syrien ne ta rderait
pas à p én é trer le secret de notre déguisement. Obéissant à
la voix de la prudence, nous nous hâtâmes d’en tre r dans la
ville.
Dans toutes les anciennes cités arabes, l’enceinte fortifiée entoure
les habitations seulement ; les j ardins, situés hors des murs,