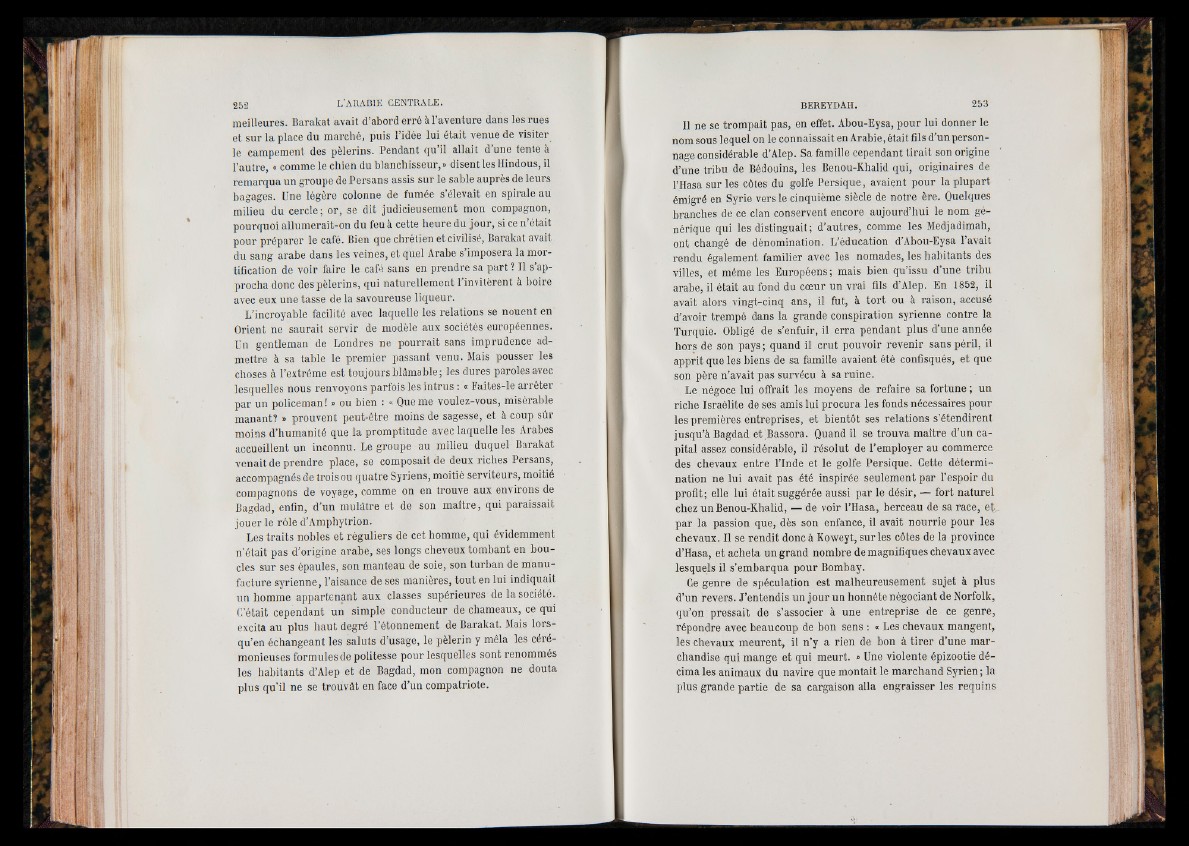
meilleures. Barakat avait d’abord erré à l’aventure dans les rues
e t su r la place du marché, puis l ’idée lui était venue de visiter
le campement des pèlerins. Pendant q u ’il allait d’une tente à
l’autre, « comme le chien du blanchisseur,» disent les Hindous, il
remarqua un groupe de Persans assis su r le sable auprès de leurs
bagages. Une légère colonne de fumée s’élevait en spirale au
milieu du cercle; or, se dit judicieusement mon compagnon,
pourquoi allumerait-on du feu à cette heure du jo u r, si ce n ’était
pour préparer le café. Bien que chrétien et civilisé, Barakat avait
du sang arabe dans les veines, et quel Arabe s’imposera la m ortification
de voir faire le café sans en prendre sa p art ? Il s’approcha
donc des pèlerins, qui naturellement l’invitèrent à boire
avec eux une tasse de la savoureuse liqueur.
L’incroyable facilité avec laquelle les relations se nouent en'
Orient ne saurait servir de modèle aux sociétés européennes.
Un gentleman de Londres ne p o u rra it sans imprudence admettre
à sa table le premier passant venu. Mais pousser les
choses à l’extrême est toujours blâmable; les dures paroles avec
lesquelles nous renvoyons parfois les in tru s : « Faites-le a rrê te r
par u n policeman! » ou bien : « Que me voulez-vous, misérable
manant? » prouvent peut-être moins de sagesse, et à coup sûr
moins d’humanité que la promptitude avec laquelle les Arabes
accueillent un inconnu. Le groupe au milieu duquel Barakat
venait de prendre place, se composait de deux riches Persans,
accompagnés de trois ou quatre Syriens, moitié serviteurs, moitié
compagnons de voyage, comme on en trouve aux environs de
Bagdad, enfin, d’un mulâtre et de son m a ître , qui paraissait
joue r le rôle d’Amphytrion.
Les tra its nobles e t réguliers de cet homme, qui évidemment
n ’était pas d’origine arabe, ses longs cheveux tombant en boucles
su r ses épaules, son manteau de soie, son tu rb an de man u facture
syrienne, l’aisance de ses manières, to u t en lui indiquait
un homme appartenant aux classes supérieures de la société.
C'était cependant u n simple conducteur de chameaux, ce qui
excita au plus h au t degré l ’étonnement de Barakat. Mais lors-
qu’en échangeant les saluts d’usage, le pèlerin y mêla les cérémonieuses
formules de politesse pour lesquelles sont renommés
les habitants d’Alep et de Bagdad, mon compagnon ne douta
plus qu’il ne se trouvât en face d’un compatriote.
Il ne se trompait pas, en effet. Abou-Eysa, pour lui donner le
nom sous lequel on le connaissait en Arabie, était fils d’un personnage
considérable d’Alep. Sa famille cependant tira it son origine
d’une tribu de Bédouins, les Benou-Khalid qui, originaires de
l’Hasa sur les côtes du golfe Persique, avaient pour la plupart
émigré en Syrie vers le cinquième siècle de notre ère. Quelques
branches de ce clan conservent encore aujourd’hui le nom générique
qui lès distinguait ; d’autres, comme les Medjadimah,
ont changé de dénomination. L’éducation d’Abou-Eysa l’avait
rendu également familier avec les nomades, les habitants des
villes, et même les Européens; mais bien qu’issu du ne trib u
arabe, il était au fond du coeur un vrai fils d’Alep. En 1852, il
avait alors vingt-cinq ans, il fut, à to r t ou à raison, accusé
d’avoir trempé dans la grande conspiration syrienne contre la
Turquie. Obligé de s’enfuir, il e rra pendant plus d’une année
hors de son pays ; quand il crut pouvoir revenir sans péril, il
apprit que les biens de sa famille avaient été confisqués, et que
son père n’avait pas survécu à sa ruine.
Le négoce lui offrait les moyens de refaire sa fortune ; un
riche Israélite de ses amis lui procura les fonds nécessaires pour
les premières entreprises, et bientôt ses relations s’étendirent
jusqu’à Bagdad et;Bassora. Quand il se trouva maître d’un capital
assez considérable, il résolut de l ’employer au commerce
des chevaux entre l’Inde et le golfe Persique. Cette détermination
ne lui avait pas été inspirée seulement par l’espoir du
profit; elle lui était suggérée aussi par le désir, — fort naturel
chez un Benou-Khalid, — de voir l ’Hasa, berceau de sa race, e i .
p a r la passion que, dès son enfance, il avait nourrie pour les
chevaux. Il se ren d it donc à Koweyt, sur les côtes de la province
d’Hasa, e t acheta un grand nombre de magnifiques chevaux avec
lesquels il s’embarqua p o u r Bombay.
Ce genre de spéculation est malheureusement sujet à plus
d’un revers. J ’entendis un jo u r un honnête négociant de Norfolk,
qu’on pressait de s’associer à une entreprise de ce genre,
répondre avec beaucoup de bon sens : « Les chevaux mangent,
les chevaux meurent, il n ’y a rien de bon à tir e r d’une ma rchandise
qui mange e t qui meurt. » Une violente épizootie décima
les animaux du navire que montait le marchand Syrien ; la
plus grande partie de sa cargaison alla engraisser les requins