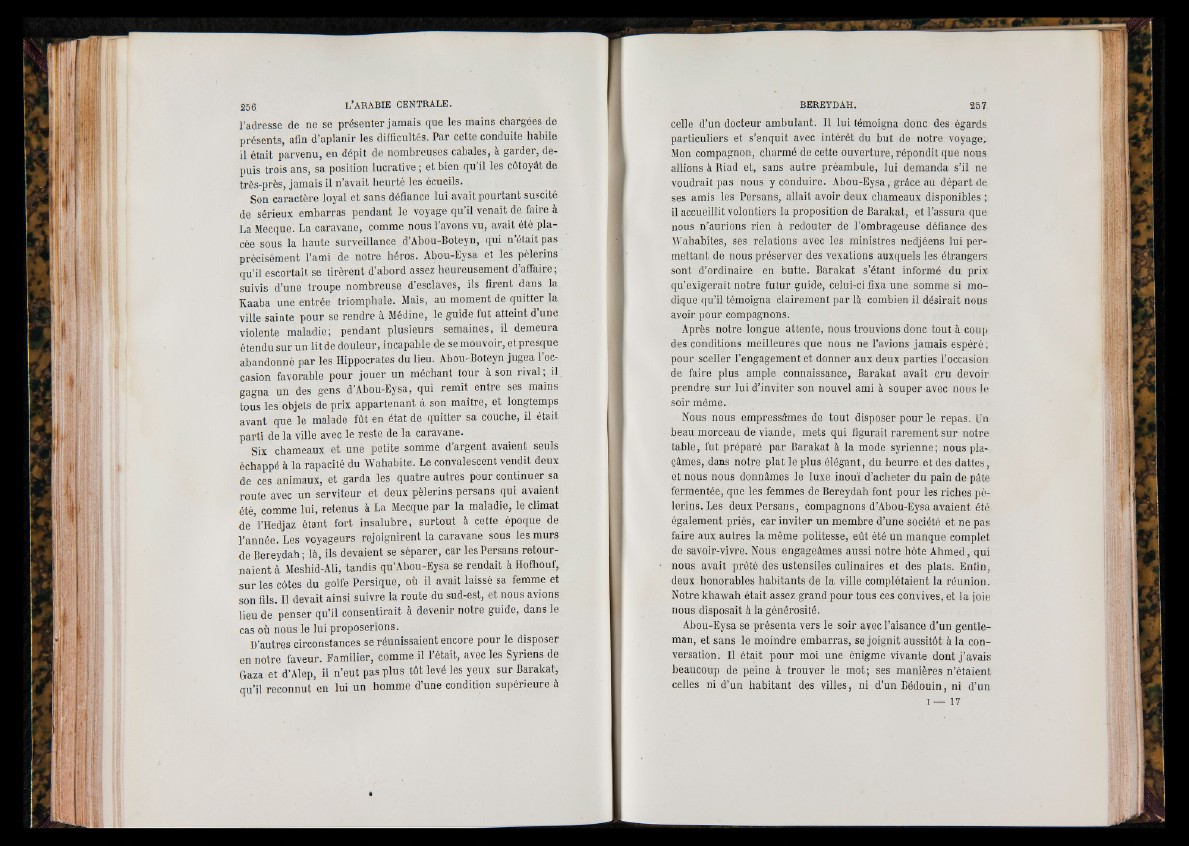
l’adresse d.6 n6 S6 prés6nt6r jcunfiis c[ug I g s moins ch o r^G G s de
présents, afin d’aplanir les difficultés. Par cette conduite habile
il était parvenu, en dépit de nombreuses cabales, à garder, depuis
trois ans, sa position lucrative ; e t bien qu’il les côtoyât de
très-près, jamais il n’avait heurté les écueils.
Son caractère loyal et sans défiance lui avait pourtant suscité
de sérieux embarras pendant le voyage qu’il venait de faire à
La Mecque. La caravane, comme nous l’avons vu, avait été placée
sous la haute surveillance d’Abou-Boteyn, qui n ’était pas
précisément l’ami de notre héros. Abou-Eysa et les pèlerins
qu’il escortait se tirè rent d’abord assez heureusement d’affaire;
suivis d’une troupe nombreuse d’esclaves, ils firent dans la
Kaaba une entrée triomphale. Mais, au moment de quitter la
ville sainte p o u r se rendre à Médine, le guide fut atteint d une
violente maladie; pendant plusieurs semaines, il demeura
étendu su r u n lit de douleur, incapable de se mouvoir, et presque
abandonné p a r les Hippocrates du lieu. Abou-Boteyn jugea l’occasion
favorable pour jo u e r un méchant tour à son riv a l; il,
gagna un des gens d'Abou-Eysa, qui remit entre ses mains
tous les objets de prix appartenant à son maître, et longtemps
avant que le malade fût en état de quitter sa couche, il était
p a rti de la ville avec le reste de la caravane.
Six chameaux e t une petite somme d’argent avaient seuls
échappé à la rapacité du Wahabite. Le convalescent vendit deux
de ces animaux, et garda les quatre autres pour continuer sa
route avec un serviteur e t deux pèlerins persans qui avaient
été, comme lui, retenus à La Mecque p a r la maladie, le climat
de "l’Hedjaz étant fort in sa lu b re , surtout à cette époque de
l’année. Les voyageurs rejoignirent la caravane sous les murs
de Bereydah ; là, ils devaient se séparer, car les Persans re to u rn
a ien t à Meshid-Ali, tandis qu’Abou-Eysa se rendait à Hofhouf,
su r les côtes du golfe Persique, où il avait laissé sa femme et
son fils. Il devait ainsi suivre la route du sud-est, et nous avions
lieu de penser qu’il consentirait à devenir notre guide, dans le
cas où nous le lui proposerions.
D’autres circonstances se réunissaient encore pour le disposer
en notre faveur. Familier, comme il l’était, avec les Syriens de
Gaza et d’Alep, il n ’eut pas p lu s tôt levé les yeux sur Barakat,
qu’il reconnut en lui un homme d’une condition supérieure à
celle d’un docteur ambulant. Il lui témoigna donc des égards
particuliers et s’enquit avec intérêt du but de notre voyage.
Mon compagnon, charmé de cette ouverture, répondit que nous
allions à Riad et, sans autre préambule, lui demanda s’il ne
voudrait pas nous y conduire. Abou-Eysa, grâce au départ de
ses amis les Persans, allait avoir deux chameaux disponibles ;
il accueillit volontiers la proposition de Barakat, et l ’assura que
nous n’aurions rien à redouter de l ’ombrageuse défiance des
Wahabites, ses relations avec les ministres nedjéens lui permettant
de nous préserver des vexations auxquels les étrangers
sont d’ordinaire en butte. Barakat s’étant informé du prix
qu’exigerait notre futur guide, celui-ci fixa une somme si modique
qu’il témoigna clairement p a r là combien il désirait nous
avoir pour compagnons.
Après notre longue attente, nous trouvions donc tout à coup
des conditions meilleures que nous ne l’avions jamais espéré ;
pour sceller l’engagement et donner aux deux parties l’occasion
de faire plus ample connaissance, Barakat avait cru devoir
prendre sur lui d’inviter son nouvel ami à souper avec nous le
soir même.
Nous nous empressâmes de to u t disposer pour le repas. Un
beau morceau de viande, mets qui figurait ra rem en t su r notre
table, fut préparé p a r Barakat à la mode syrienne; nous plaçâmes,
dans notre plat le plus élégant, du b eu rre .e t des d attes,
et nous nous donnâmes le luxe inouï d’acheter du pain de pâte
fermentée, que les femmes de Bereydah font pour les riches pèlerins.
Les deux Persans, compagnons d’Abou-Eysa avaient été
également priés, car inviter un membre d’une société e t ne pas
faire aux autres la même politesse, eût été un manque complet
de savoir-vivre. Nous engageâmes aussi nôtre hôte Ahmed, qui
nous avait prêté des ustensiles culinaires et des plats. Enfin,
deux honorables habitants de la ville complétaient la réunion.
Notre khawah était assez grand pour tous ces convives, e t la joie
nous disposait à la générosité.
Abou-Eysa se présenta vers le soir avec l’aisance d’un gentleman,
e t sans le moindre embarras, se joignit aussitôt à la conversation.
Il était p o u r moi une énigme vivante dont j ’avais
beaucoup de peine à trouver le mot; ses manières n ’étaient
celles ni d’un habitant des villes, ni d’un Bédouin, ni d’un
i — 17