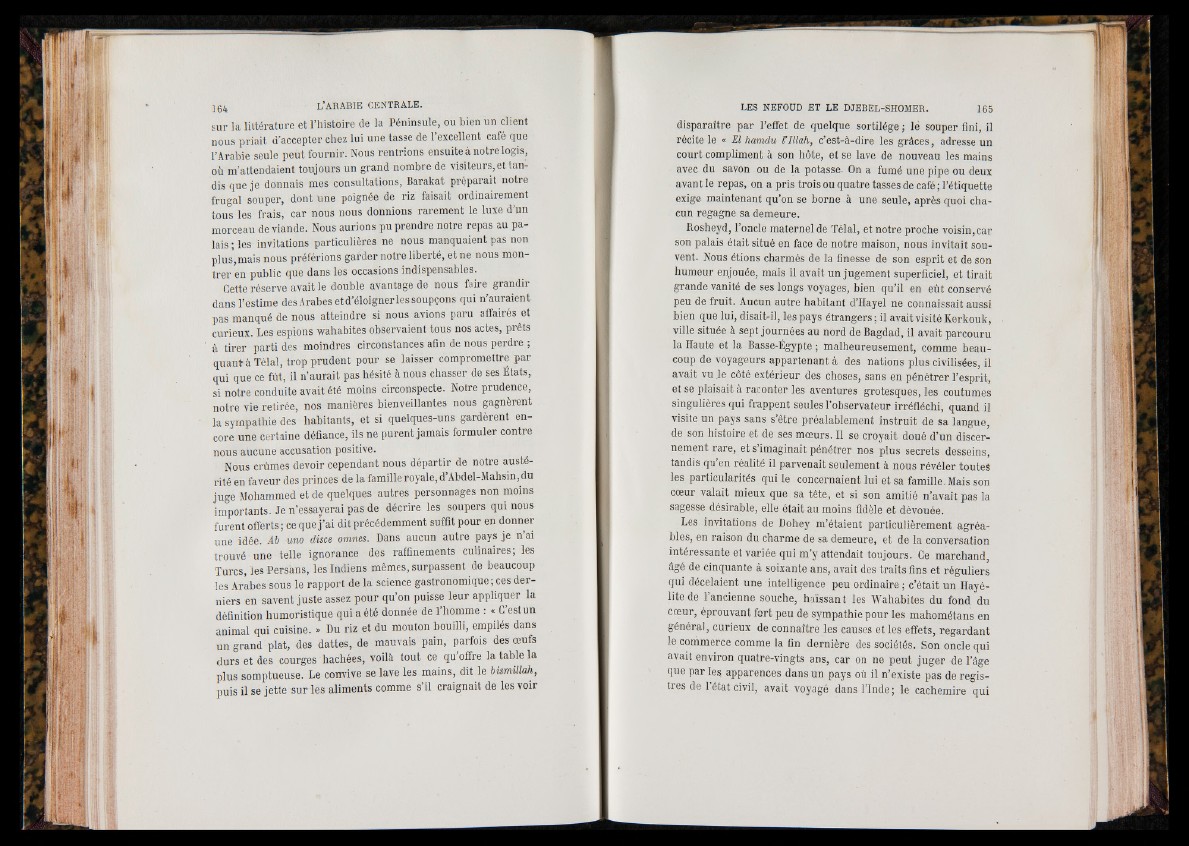
sur la littérature et l’histoire de la Péninsule, ou bien un client
nous p ria it d’accepter chez lui une tasse de l’excellent café que
l ’Arabie seule peut fournir. Nous rentrions ensuite à notre logis,
où m’attendaient toujours un grand nombre de visiteurs, et tandis
que je donnais mes consultations, Barakat préparait notre
frugal souper, dont une poignée de riz faisait ordinairement
tous les frais, car nous nous donnions rarement le luxe d’un
morceau de viande. Nous aurions pu prendre notre repas au p alais
; les invitations particulières ne nous manquaient pas non
plus, mais nous préférions garder notre liberté, et ne nous montre
r en public que dans les occasions indispensables.
Cette réserve avait le double avantage de nous faire grandir
dans l’estime desArabes et d’éloigner les soupçons qui n’auraient
pas manqué de nous atteindre si nous avions paru affairés et
curieux. Les espions wahabites observaient tous nos actes, prêts
à tire r parti des moindres circonstances afin de nous perdre ;
quant à Télal, trop prudent pour se laisser compromettre par
qui que ce fût, il n’au ra it pas hésité à nous chasser de ses États,
si notre conduite avait été moins circonspecte. Notre prudence,
notre vie retirée, nos manières bienveillantes nous gagnèrent
la sympathie des habitants, et si quelques-uns gardèrent encore
une certaine défiance, ils ne purent jamais formuler contre
nous aucune accusation positive.
Nous crûmes devoir cependant nous départir de notre austérité
en faveur des princes de la famille royale, d’Abdel-Mahsin,du
juge Mohammed et de quelques autres personnages non moins
importants. Je n ’essayerai pas de décrire les soupers qui nous
furent offerts ; ce que j ’ai dit précédemment suffit pour en donner
une idée. Ab uno disce omnes. Dans aucun au tre pays je n ai
trouvé une telle ignorance des raffinements culinaires; les
Turcs, les Persans, les Indiens mêmes, surpassent de beaucoup
les Arabes sous le rapport de la science gastronomique ; ces d e rniers
en savent ju ste assez pour qu’on puisse leur appliquer la
définition humoristique qui a été donnée de l’homme : « C’est un
animal qui cuisine. » Du riz et du mouton bouilli, empilés dans
u n grand plat, des d attes, de mauvais pain, parfois des oeufs
d u rs et des courges hachées, voilà to u t ce qu offre la table la
plus somptueuse. Le convive se lave les mains, dit le bismillah,
puis il se je tte su r les aliments comme s’il craignait de les voir
disparaître p ar l’effet de quelque sortilège ; le souper fini, il
récite le « El hamdu Vlllah, c’est-à-dire les grâces, adresse un
court compliment à son hôte, et se lave de nouveau les mains
avec du savon ou de la potasse- On a fumé une pipe ou deux
avant le repas, on a pris trois ou quatre tasses de café ; l ’étiquette
exige maintenant qu’on se borne à une seule, après quoi chacun
regagne sa demeure.
Rosheyd, l’oncle maternel de Télal, et notre proche voisin, car
son palais était situé en face de notre maison, nous invitait souvent.
Nous étions charmés de la finesse de son esprit et de son
humeur enjouée, mais il avait un jugement superficiel, et tira it
grande vanité de ses longs voyages, bien qu’il en eût conservé
peu de fruit. Aucun autre habitant d’Hayel ne connaissait aussi
bien que lui, disait-il, les pays étrangers ; il avait visité Kerkouk,
ville située à sept journées au nord de Bagdad, il avait parcouru
la Haute et la Basse-Égypte ; malheureusement, comme beaucoup
de voyageurs appartenant à des nations plus civilisées, il
avait vu le côté extérieur des choses, sans en p én é trer l’esprit,
et se plaisait a raconter les aventures grotesques, les coutumes
singulières qui frappent seules l’observateur irréfléchi, quand il
visite un pays sans s’être préalablement in stru it de sa langue,
de son histoire et de ses moeurs. Il se croyait doué d’un discernement
rare, et s’imaginait pénétrer nos plus secrets desseins,
tandis qu en réalité il parvenait seulement à nous révéler toutes
les particularités qui le concernaient lui et sa famille.Mais son
coeur valait mieux que sa tête, et si son amitié n’avait pas la
sagesse désirable, elle était au moins fidèle et dévouée.
Les invitations de Dohey m’étaient particulièrement ag ré a bles,
en raison du charme de sa demeure, et de la conversation
intéressante et variée qui m ’y attendait toujours. Ce marchand,
âgé de cinquante à soixante ans, avait des traits fins et réguliers
qui décelaient une intelligence peu ordinaire ; c’éta it u n Hayé-
lite d e l’ancienne souche, h a ïssan t les Wahabites du fond du
coeur, éprouvant fort p eu de sympathie pour les mahométans en
général, curieux de connaître les causes et les effets, reg a rd an t
le commerce comme la fin dernière des sociétés. Son oncle qui
avait environ quatre-vingts ans, car on ne p eu t ju g e r de l’âge
que par le$ apparences dans un pays où il n’existe pas de registres
de l’état civil, avait voyagé dans l’Inde ; le cachemire qui