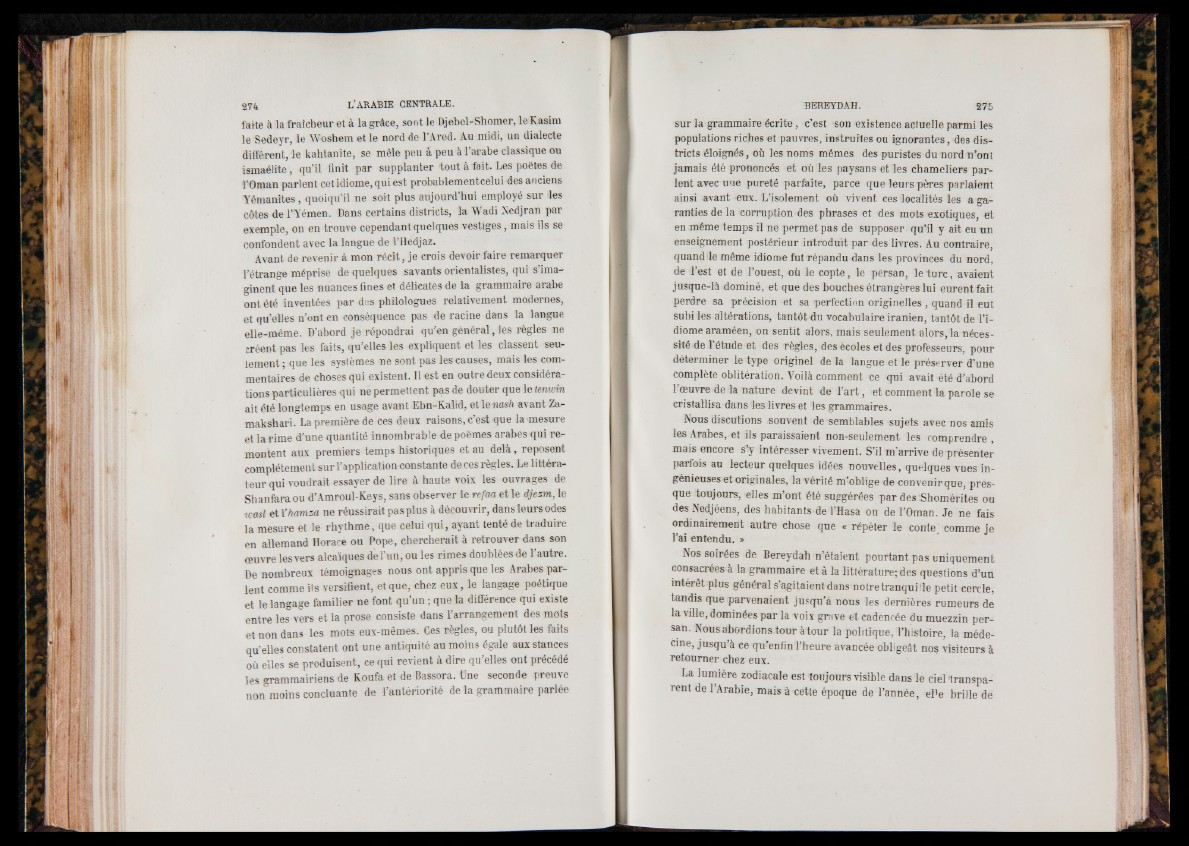
faite à la fraîcheur et à la grâce, sont le Djebel-Shomer, le Kasim
le Sedeyr, le Woshem et le nord de l ’Ared. Au midi, un dialeete
différent, le kahtanite, se mêle peu â peu à l’arabe classique ou
ism aé lite, qu’il finit par supplanter to u t à fait. Les poètes de
l’Oman p arlent cet idiome, qui est probablementcelui des anciens
Yémanites, quoiqu’il ne soit plus aujourd’hui employé su r les
côtes de l’Yémen. Dans certains districts, la Wadi Nedjran par
exemple, on en trouve cependant quelques vestiges, mais ils se
confondent avec la langue de l’Hedjaz.
Avant de revenir à mon r é c it, je crois devoir faire remarquer
l’étrange méprise de quelques savants orientalistes, qui s’imaginent
que les nuances fines et délicates de la grammaire arabe
o n t été inventées p a r des philologues relativement modernes,
et qu’elles n’ont en conséquence pas de racine dans la langue
elle-même. D’abord je répondrai qu’en g én é ra l, les règles ne
créent pas les faits, qu’elles les expliquent e t les classent seulement
; que les systèmes ne sont pas les causes, mais les commentaires
de choses qui existent. Il est en outre deux considérations
particulières qui ne permettent pas de douter que le tenwin
ait été longtemps en usage avant Ebn-Kalid, et le nash avant Za-
makshari. La p remière de ces deux raisons, c’est que la mesure
et la rime d’une quantité innombrable de poèmes arabes qui re montent
aux premiers temps historiques et au d e là , reposent
complètement su r l’application constante de ces règles. Le litté ra te
u r qui voudrait essayer de lire à haute voix les ouvrages de
S hanfara ou d’Amroul-Keys, sans observer le refaa et le djezm, le
wasl e t Yhmnza ne réussirait pas plus à découvrir, dans leu rs odes
la mesure et le rh y thm e , que celui q u i, ayant tenté de traduire
en allemand Horace ou Pope, chercherait à retrouver dans son
oeuvre lesvers alcaïques de l’u n , ou les rimes doublées de l’autre.
De nombreux témoignages nous ont appris que les Arabes parlent
comme ils versifient, et que, chez e u x , le langage poétique
et le langage familier ne font qu’un ; que la différence qui existe
e n tre les vers et la prose consiste dans l’arrangement des mots
e t non dans les mots eux-mêmes. Ces règles, ou plutôt les faits
qu’elles constatent ont un e antiquité au moins égale aux stances
où elles se produisent, ce qui revient à dire qu’elles ont précédé
les grammairiens de Koufa et de Bassora. One seconde preuve
non moins concluante de l’antériorité de la grammaire parlée
su r la grammaire é c rite , c’est son existence actuelle parmi les
populations riches et pauvres, instruites ou ignorantes, des districts
éloignés, où les noms mêmes des puristes du nord n ’ont
jamais été prononcés et où les paysans et les chameliers p a rlent
avec une pureté parfaite, parce que leurs pères parlaient
ainsi avant eux. L’isolement où vivent ces localités les a garanties
de la corruption des phrases et des mots exotiques, et
en même temps il ne permet pas de supposer qu’il y ait eu n n
enseignement postérieur introduit par des livres. Au contraire
quand le même idiome fut répandu dans les provinces du nord,
de l ’est et de l ’ouest, où le copte, le persan, le tu r c , avaient
jusque-là dominé, et que des bouches étrangères lui eu re n t fait
perdre sa précision et sa perfection o rig in e lle s, quand il eut
subi les altérations, ta n tô t du vocabulaire iranien, tantôt de l’idiome
araméen, on sentit alors, mais seulement alors, la nécessité
de l’étude et des règles, des écoles e t des professeurs, pour
déterminer le type originel de la langue et le p rése rve r d’une
complète oblitération. Voilà comment ce qui avait été d’abord
l’oeuvre de la n a tu re devint de l’a r t , et comment la parole se
cristallisa dans les livres et les grammaires.
Nous discutions souvent de semblables sujets avec nos amis
les Arabes, et ils paraissaient non-seulement les comprendre ,
mais encore s'y intéresser vivement. S’il m’arrive de présenter
parfois au lecteur quelques idées nouvelles, quelques vues ingénieuses
e t originales, la vérité m’oblige de convenir que, presque
toujours, elles m’ont été suggérées p a r des Shomérites ou
des Nedjéens, des habitants de l’Hasa ou de l’Oman. Je ne fais
ordinairement au tre chose que * répéter le conte comme je
l’ai entendu. »
Nos soirées de Bereydah n ’étaient pourtant pas uniquement
consacrées à la grammaire e t à la littérature; des questions d’u n
inté rêt plus général s’agitaient dans notre tranqui de petit cercle,
tandis que parvenaient ju sq u ’à nous les dernières rum eu rs de
la ville, dominées p a r la voix grave et cadencée du muezzin p ersan.
Nous abordions to u r à to u r la politique, l’histoire, la méde-
cine, ju sq u ’à ce q u ’enfin l’heure avancée obligeât nos visiteurs à
re to u rn e r chez eux.
La lumière zodiacale est toujours visible dans le ciel tra n sp a ren
t de l ’Arabie, mais à cette époque de l ’an n é e, ePe brille dé