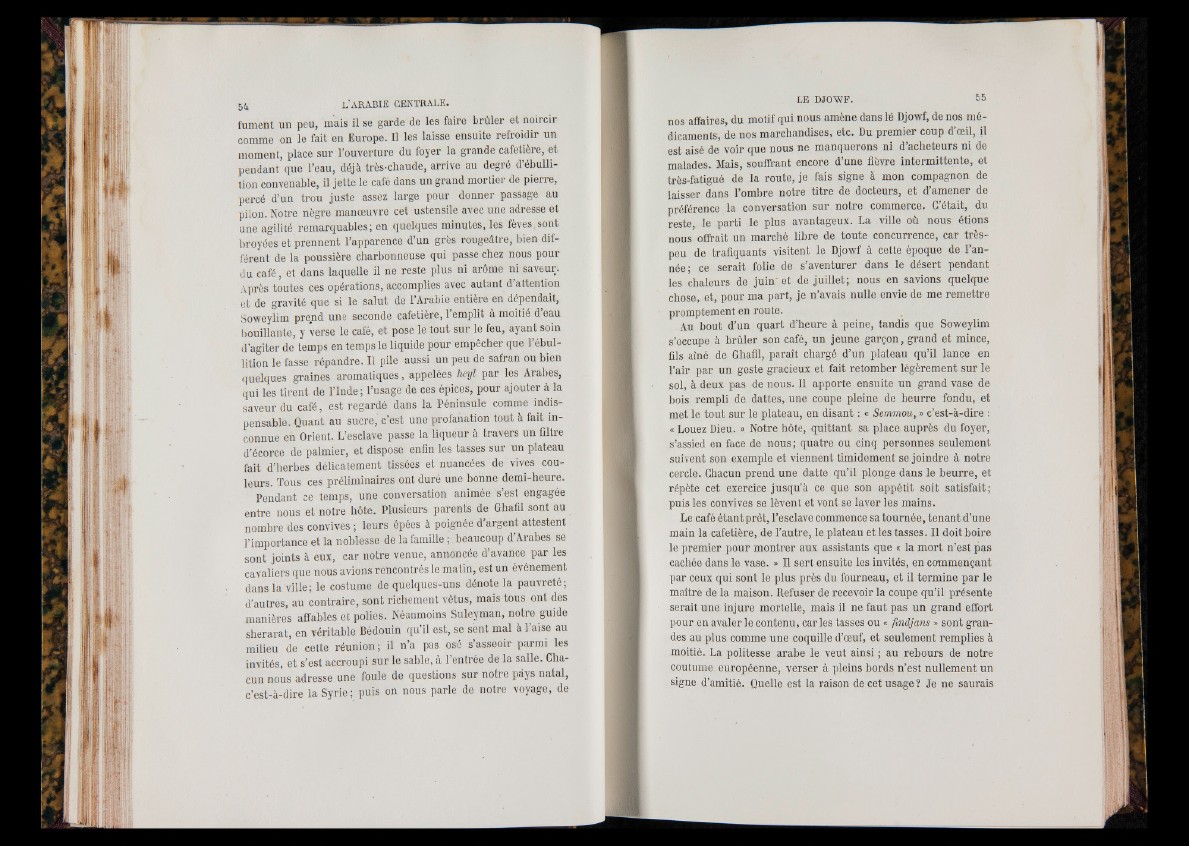
fument u n peu, mais il se garde de les faire brûler et noircir
comme on le fait en Europe. Il les laisse ensuite refroidir un
moment, place su r l’ouverture du foyer la grande cafetière, et
pendant que l’eau, déjà très-chaude, arrive au degré d’ébulli-
tion convenable, il je tte le café dans un g rand mortier de pierre,
percé d’u n tro u ju ste assez large pour donner passage au
pilon. Notre nègre manoeuvre cet ustensile avec une adresse et
une agilité remarquables; en quelques minutes, les fèves,sont
broyées e t prennent l’apparence d’un grès rougeâtre, bien différent
de la poussière charbonneuse qui passe chez nous pour
du café, et dans laquelle il ne reste plus ni arôme ni saveur.
Après toutes ces opérations, accomplies avec autant d’attention
et de gravité que si le salut de 1 A rabie entière en dépendait,
Soweylim prejid une seconde cafetière, 1 emplit à moitié d e a u
bouillante, y verse le café, e t pose le tout su r le feu, ayant soin
d’agiter de temps en temps le liquide pour empêcher que l’ébul-
lition le fasse répandre. Il pile aussi un peu de safran ou bien
quelques graines a rom a tiq u e s, appelées heyl p a r les Arabes,
qui les tire n t de l ’Inde; l’usage de ces épices, pour ajouter à la
saveur du café, est rega rdé dans la Péninsule comme indispensable.
Quant au sucre, c’est une profanation tout à fait in connue
eh Orient. L’esclave passe la liqueur à trave rs u n filtre
d’écorce de palmier, et dispose enfin les tasses su r u n plateau
fait d’herbes délicatement tissées et nuancées de vives couleurs.
Tous ces préliminaires ont duré une bonne demi-heure.
Pendant ce temps, une conversation animée s est engagée
entre nous et n otre hôte. Plusieurs p arents de Ghafil sont au
nombre des convives ; leu rs épées à poignée d’argent attestent
l’importance et la noblesse de la famille - beaucoup d’Arabes se
sont joints à eux, ca r notre venue, annoncée d’avance p a r les
cavaliers que nous avions rencontrés le matin, est u n événement
dans la ville; le costume de quelques-uns dénote la pauvreté;
d’autres, au contraire, sont richement vêtus, mais tous ont des
manières affables et polies. Néanmoins Suleyman, notre guide
sh e ra ra t, en véritable Bédouin qu’il est, se sent mal à l ’aise au
milieu de cette réu n io n ; il n ’a pas osé s’asseoir parmi les
invités, e t s’est accroupi su r le sable, à l’entrée de la salle. Chacun
nous adresse une foule de questions sur notre pays n a ta l,
c’est-à-dire la Syrie; puis on nous parle de notre voyage, de
nos affaires, du motif qui nous amène dans lé Djowf, de nos m é dicaments,
de nos marchandises, etc. Du premier coup d’oeil, il
est aisé de voir que nous ne manquerons ni d’acheteurs ni de
malades. Mais, souffrant encore d’une fièvre in te rm itten te , et
très-fatigué de la route, je fais signe à mon compagnon de
laisser dans l’ombre notre titre de docteurs, e t d’amener de
préférence la conversation su r n o tre commerce. C’était, du
reste, le parti le plus avantageux. La ville où nous étions
nous offrait un marché libre de to u te concurrence, car trè s-
peu de trafiquants visitent le Djowf à cette époque de l’année;
ce serait folie de s’aventurer dans le désert pendant
les chaleurs de ju in 'e t de ju ille t; nous en savions quelque
chose, et, pour ma p a rt, je n ’avais nulle envie de me remettre
promptement en route.
Au bout d’un q uart d’heure à peine, tandis que Soweylim
s ’occupe à b rû le r son café, u n jeune garçon, gran d e t mince,
fils aîné de Ghafil, paraît chargé d’u n plateau qu’il lance en
l’air p a r u n geste gracieux et fait retomber légèrement su r le
sol, à deux pas de nous. Il apporte ensuite u n grand vase de
bois rempli de dattes, une coupe pleine de b eu rre fondu, et
met le to u t su r le plateau, en disant : « Semmou, » c’est-à-dire :
* Louez Dieu. » Notre hôte, q u ittan t sa place auprès du foyer,
s’assied en face de nous; q u atre ou cinq personnes seulement
suivent son exemple e t viennent timidement se joindre à notre
cercle. Chacun prend une datte qu’il plonge dans le b e u rre , et
répète cet exercice ju sq u ’à ce que son appé tit soit satisfait;
puis les convives se lèvent et vont se laver les mains.
Le café é tan t prêt, l’esclave commence sa to u rn é e , te n an t d’une
main la cafetière, de l’autre, le plateau et les tasses. Il doit boire
le premier p o u r montre r aux assistants que « la m o rt n ’est pas
cachée dans le vase. » Il sert.ensuite les invités, en commençant
par ceux qui sont le plus près du fourneau, et il te rm ine p a r le
maître de la maison. Refuser de recevoir la coupe q u ’il présente
serait une injure mortelle, mais il ne fau t pas u n g ran d effort
pour en avaler le contenu, caries tasses ou « findjans » sont grandes
au plus comme une coquille d’oeuf, e t seulement remplies à
moitié. La politesse arabe le veut ainsi ; au rebours de notre
coutume européenne, verse r à pleins bords n ’est nullement un
signe d’amitié. Quelle est la raison de cet usage ? Je ne saurais