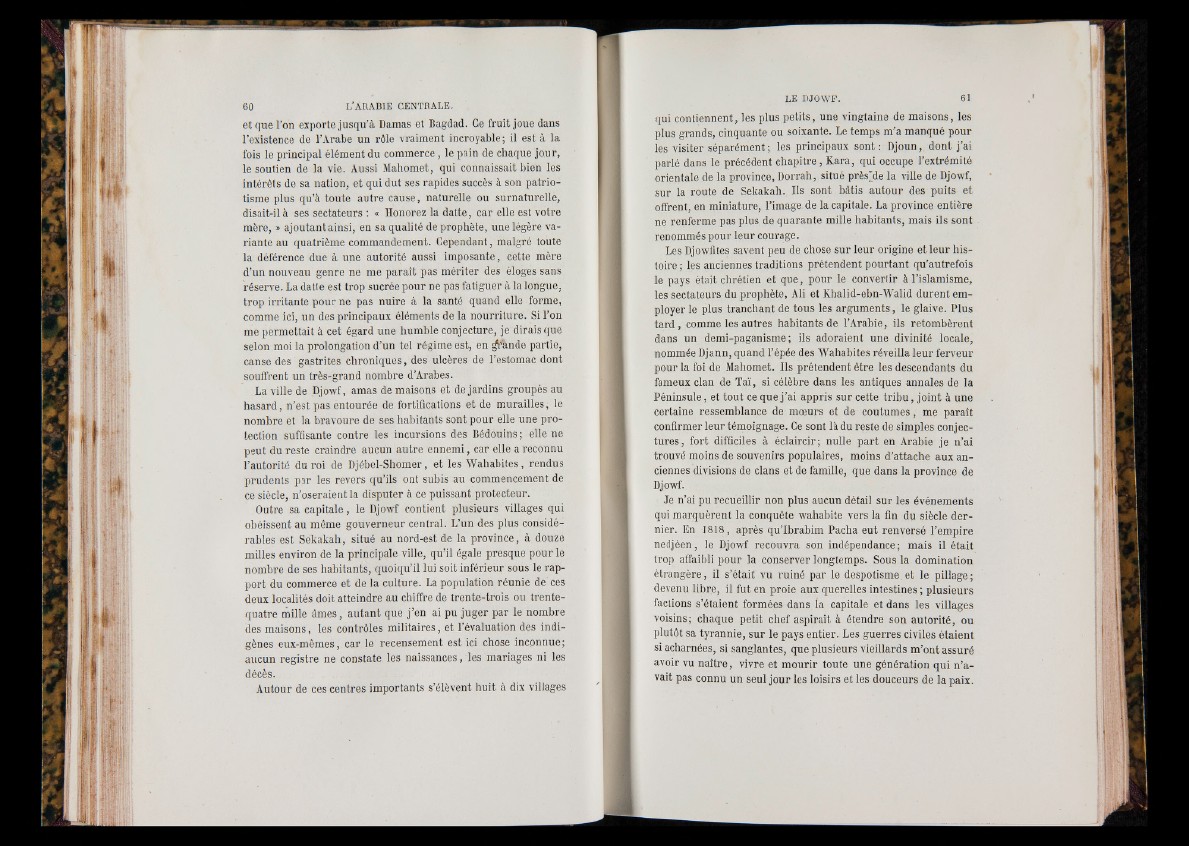
et que l’on exporte jusqu’à Damas et Bagdad. Ce fruit joue dans
l ’existence de l’Arabe un rôle vraiment incroyable; il est à la
fois le principal élément du commerce, le pain de chaque jo u r,
le soutien de la vie. Aussi Mahomet, qui connaissait bien les
intérêts de sa nation, e t qui dut ses rapides succès à son patriotisme
plus qu’à toute autre cause, naturelle ou surnaturelle,
disait-il à ses sectateurs : * Honorez la datte, car elle est votre
mère, * ajoutant ainsi, en sa qualité de prophète, une légère variante
au quatrième commandement. Cependant, malgré toute
la déférence due à une autorité aussi imposante, cette mère
d’un nouveau genre ne me p a ra ît pas mériter des éloges sans
réserve. La datte est trop sucrée pour ne pas fatiguer à la longue,
trop irritante pour ne pas nuire à la santé quand elle forme,
comme ici, un des principaux éléments de la n o u rritu re . Si l’on
me permettait à cet égard une humble conjecture, je dirais que
selon moi la prolongation d’un tel régime est, en tfî'hnde partie,
canse des gastrites chro n iq u e s, des ulcères de l’estomac dont
souffrent un très-grand nombre d’Arabes.
La ville de Djowf, amas de maisons e t de jardins groupés au
h a s a rd , n’est pas entourée de fortifications e t de murailles, le
nombre et la bravoure de ses habitants sont pour elle une protection
suffisante contre les incursions des Bédouins; elle ne
peut du reste craindre aucun au tre en n em i, car elle a reconnu
l’autorité du roi de Djébel-Shomer, et les W ahabites, rendus
prudents par les revers qu’ils ont subis au commencement de
ce siècle, n’oseraient la disputer à ce puissant protecteur.
Outre sa c a p ita le , le Djowf contient plusieurs villages qui
obéissent au même gouverneur central. L’u n des plus considérables
est Sekakah, situé au nord-est de la province, à douze
milles environ de la principale ville, qu’il égale presque pour le
nombre de ses habitants, quoiqu’il lui soit inférieur sous le rapp
o rt du commerce et de la culture. La population réunie de ces
deux localités doit atteindre au chiffre de tren te -tro is ou trente-
q uatre mille âmes, a u tan t que j ’en ai pu ju g e r par le nombre
des m a iso n s, les contrôles m ilita ire s, et l’évaluation des indigènes
eux-mêmes, car le recensement est ici chose inconnue;
aucun registre ne constate les naissances, les mariages ni les
décès.
Autour de ces centres importants s’élèvent hu it à dix villages
qui contiennent, les plus p e tits, une vingtaine de maisons, les
plus grands, cinquante ou soixante. Le temps m’a manqué pour
les visiter séparément; les principaux so n t: Djoun, dont j ’ai
parlé dans le précédent ch ap itre , Kara, qui occupe l’extrémité
orientale de la province, Dorrah, situé préside la ville de Djowf,
sur la route de Sekakah. Ils sont bâtis au to u r des puits e t
offrent, en miniature, l’image, de la capitale. La province entière
ne renferme pas plus de quarante mille habitants, mais ils sont
renommés pour leu r courage.
Les Djowfites savent peu de chose su r leu r origine et leu r histoire
; les anciennes traditions prétendent pourtant qu’autrefois
le pays était chrétien e t q u e , pour le convertir à l ’islamisme,
les sectateurs du prophète, Ali et Khalid-ebn-Walid durent employer
le plus tranchant de tous les a rg um e n ts , le glaive. Plus
ta r d , comme les autres habitants de l’Arabie, ils retombèrent
dans un demi-paganisme; ils adoraient une divinité locale,
nommée D jann, quand l’épée des Wahabites réveilla le u r ferveur
pour la foi de Mahomet. Ils prétendent être les descendants du
fameux clan de Taï, si célèbre dans les antiques annales de la
Péninsule, et tout ce que j ’ai appris sur cette tr ib u , jo in t à une
certaine ressemblance de moeurs et de co u tum es, me paraît
confirmer leur témoignage. Ce sont là du reste de simples conjectu
re s , fort difficiles à éclaircir; nulle p a rt en Arabie je n ’ai
trouvé moins de souvenirs populaires, moins d’attache aux anciennes
divisions de clans et de famille, que dans la province de
Djowf.
Je n’ai pu recueillir non plus aucun détail sur les événements
qui marquèrent la conquête wahabite vers la fin du siècle d e rnier.
En 1818, après qu’Ibrabim Pacha eut renversé l’empire
nerljéen, le Djowf recouvra son indépendance; mais il était
trop affaibli pour la conserver longtemps. Sous la domination
étrangère, il s’était vu ruiné par le despotisme.et le pillage;
devenu libre, il fut en proie aux querelles intestines ; plusieurs
factions s’étaient formées dans la capitale et dans les villages
voisins; chaque petit chef aspirait à étendre son au to rité, ou
plutôt sa tyrannie, su r le pays entier. Les guerres civiles étaient
si acharnées, si sanglantes, que plusieurs vieillards m ’ont assuré
avoir vu n a ître , vivre et mou rir toute une génération qui n ’a vait
pas connu un seul jo u r les loisirs et les douceurs de la paix.