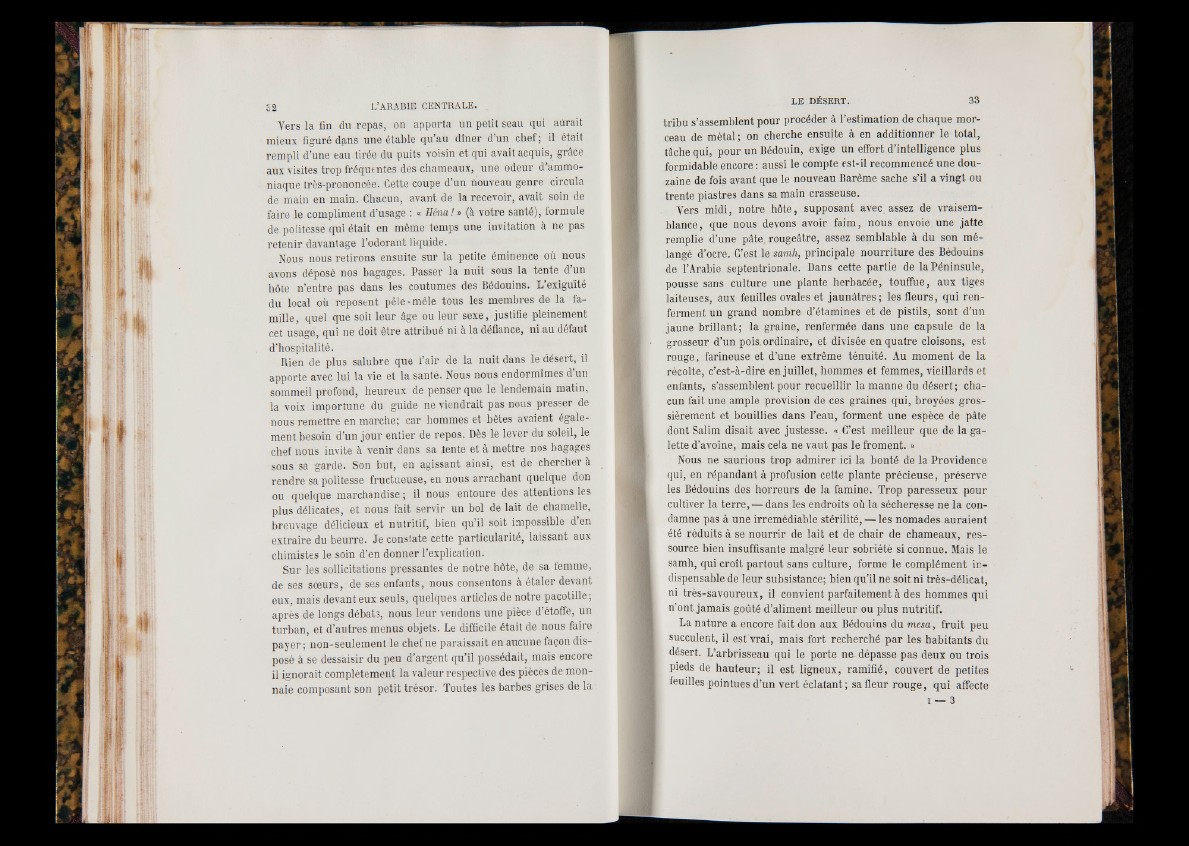
Vers la fin du repas, on apporta un petit seau qui aurait
mieux figuré dans une étable qu’au dîner d’un chef; il était
rempli d’une eau tirée du puits voisin et qui avait acquis, grâce
aux visites trop fréquentes des chameaux, une odeur d’ammoniaque
très-prononcée. Cette coupe d’un nouveau genre circula
de main en main. Chacun, avant de la recevoir, avait soin de
faire le compliment d’usage : « Héna! » (à votre santé), formule
de politesse qui était en même temps une invitation à ne pas
re te n ir davantage l ’odorant liquide.
Nous nous retirons ensuite sur la petite éminence où nous
avons déposé nos bagages. Passer la nu it sous la tente d’un
hôte n ’entre pas dans les coutumes des Bédouins. L’exiguïté
du local où reposent pêle-mêle tous les membres de la famille
, quel que soit leur âge ou leur sexe, justifie pleinement
cet usage, qui ne doit être attribué ni à la défiance, ni au défaut
d’hospitalité.
Rien de plus salubre que l’air de la n u it dans le désert, il
apporte avec lui la vie et la santé. Nous nous endormîmes d’un
sommeil profond, heureux de penser que le lendemain matin,
la voix importune du guide ne viendrait pas nous presser de
nous remettre en marche; car hommes et bêtes avaient également
besoin d’un jo u r entier de repos. Dès le lever du soleil, le
chef nous invite à venir dans sa .tente et a mettre nos bagages
sous sa garde. Son but, en agissant ainsi, est de chercher à
rendre sa politesse fructueuse, en nous arrachant quelque don
ou quelque marchandise ; il nous entoure des attentions les
plus délicates, et nous fait servir u n bol de la it de chamelle,
breuvage délicieux et nutritif, bien qu’il soit impossible d’en
extraire du beurre. Je constate cette particularité, laissant aux
chimistes le soin d’en donner l’explication.
Sur les sollicitations pressantes de n otre hôte, , de sa femme,
de ses soe u rs, de ses enfants, nous consentons à étale r devant
eux, mais devant eux seuls, quelques articles de notre pacotille;
après de longs débats, nous le u r vendons une pièce d’étoffe, un
tu rb an , et d’au tre s menus objets. Le difficile était de nous faire
payer ; non-seulement le chef ne paraissait en aucune façon disposé
à se dessaisir du peu d’argent qu’il possédait, mais encore
il ignorait complètement la valeur respective des pièces de monnaie
composant son p e tit trésor. Toutes les barbes grises de la
trib u s’assemblent pour procéder à l’estimation de chaque morceau
de métal; on cherche ensuite à en additionner le total,
tâche qui, pour un Bédouin, exige un effort d’intelligence plus
formidable encore : aussi le compte est-il recommencé une douzaine
de fois avant que le nouveau Barême sache s’il a vingt ou
trente piastres dans sa main crasseuse.
Vers midi, notre hôte, supposant avec, assez de vraisemblance,
que nous devons avoir faim, nous envoie une ja tte
remplie d’une pâte, rougeâtre, assez semblable à du son mélangé
d’ocre. C’est le samh, principale n o u rritu re des Bédouins
de l’Arabie septentrionale. Dans cette partie de la Péninsule,
pousse sans culture une plante herbacée, touffue, aux tiges
laiteuses, aux feuilles ovales e t ja u n â tre s ; les fleurs, qui ren ferment
un grand nombre d’étamines et de pistils, sont d’un
jaune b rilla n t; la graine, renfermée dans une capsule de la
i • grosseur d’un pois.ordinaire, et divisée en quatre cloisons, est
rouge, farineuse et d’une extrême ténuité. Au moment de la
récolte, c’est-à-dire en juillet, hommes et femmes, vieillards et
enfants, s’assemblent pour recueillir la manne du désert; chacun
fait une ample provision de ces graines qui, broyées grossièrement
et bouillies dans l’eau, forment une espèce de pâte
dont Salim disait avec justesse. « C’est meilleur que de la galette
d’avoine, mais cela ne v aut pas le froment. »
Nous ne saurions trop admirer ici la bonté de la Providence
qui, en répandant à profusion cette p lan te précieuse, préserve
les Bédouins des horreurs de la famine. Trop paresseux pour
cultiver la te rre , --- dans les endroits où la sécheresse ne la condamne
pas à une irrémédiable stérilité, — les nomades au ra ien t
I été réduits à se n o u rrir de la it et de chair de chameaux, re s - source bien insuffisante malgré leu r sobriété si connue. Mais le
samh, qui croît partout sans culture, forme le complément indispensable
de leur subsistance; bien qu’il ne soit ni très-délicat,
ni très-savoureux, il convient parfaitement à des hommes qui I n’ont jamais goûté d’aliment meilleur ou plus nutritif.
La nature a encore fait don aux Bédouins du mesa, fru it peu
i succulent, il est vrai, mais fort recherché p a r les habitants du
| désert. L’arbrisse au qui le porte ne dépasse pas deux ou trois
pieds de h au teu r; il est ligneux, ramifié, couvert de petites
feuilles pointues d’un v e rt éc latant; sa fleur ro u g e , qui affecte