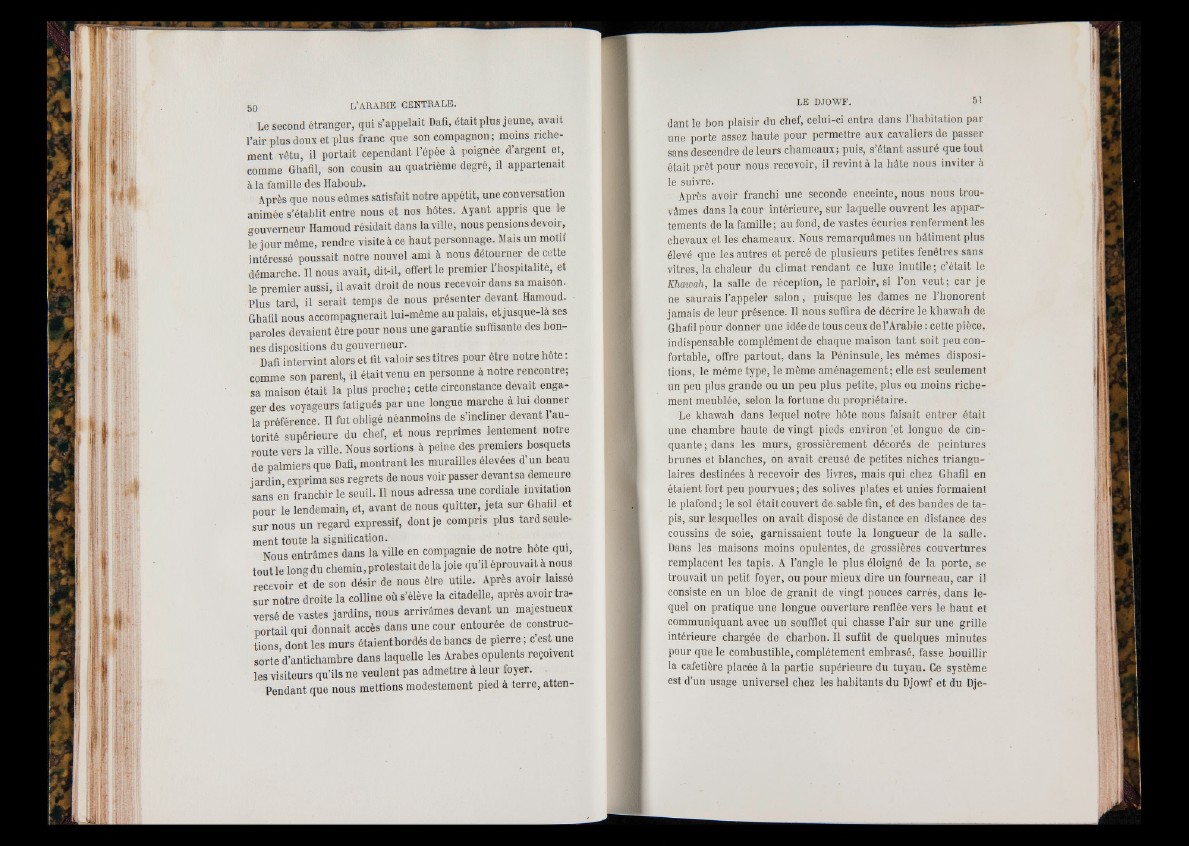
Le second étranger, qui s’appelait Dafi, était plus jeune, avait
l ’a i r p lu s doux et plus franc que son compagnon; moins richement
vêtu, il po rtait cependant l ’épée à poignée d argent et,
comme Ghafil, son cousin au quatrième degré, il appartenait
à la famille des Haboub.
Après que nous eûmes satisfait notre appétit, une conversation
animée s’établit entre nous e t nos hôtes. Ayant appris que le
gouverneur Hamoud résidait dans la ville, nous pensions devoir,
le jo u r même, rendre visite à ce h au t personnage. Mais un motif
intéressé poussait notre nouvel ami à nous détourner de cette
démarche. Il nous avait, dit-il, offert le premier l’hospitalité, et
le premier aussi, il avait droit de nous recevoir dans sa maison.
Plus tard, il serait temps de nous présenter devant Hamoud.
Ghafil nous accompagnerait lui-même au palais, et jusque-là ses
paroles devaient être pour nous une garantie suffisante des bonnes
dispositions du gouverneur. _
Dafi intervint alors e t fit valoir ses titre s pour être notre hôte :
comme son parent, il était venu en personne à notre rencontre;
sa maison était la plus proche; cette circonstance devait engager
des voyageurs fatigués p a r une longue marche à lui donner
la préférence. II fut obligé néanmoins de s’incliner devant l’auto
rité supérieure du chef, e t nous reprîmes lentement notre
route vers la ville. Nous sortions à peine des premiers bosquets
de palmiers que Dafi, m o n tran t les murailles élevées d’u n beau
jardin exprima ses regrets de nous voir passer devant sa demeure
sans en franchir le seuil. Il nous adressa une cordiale invitation
pour le lendemain, et, avant de nous q u itte r, je ta su r Ghafil et
su r nous u n regard expressif, dont je compris plus ta rd seulement
toute la signification.
Nous entrâmes dans la ville en compagnie de notre hote qui,
to u t le long du chemin, protestait de la j oie qu’il éprouvait à nous
recevoir et de son désir de nous être utile. Après avoir laisse
sur nôtre droite la colline où s’élève la citadelle, après avoir traversé
de vastes jardins, nous arrivâmes devant u n majestueux
portail qui donnait accès dans une cour entourée de constructions
dont les murs étaientbordés de bancs de pie rre ; c’est une
sorte d’antichambre dans laquelle les Arabes opulents reçoivent
les visiteurs qu’ils n e veulent pas admettre à leu r foyer.
Pendant que nous mettions modestement pied à te rre , atten dant
le bon plaisir du chef, celui-ci entra dans l ’habitation p ar
une porte assez haute pour permettre aux cavaliers de passer
sans descendre de leurs chameaux; puis, s’étan t assuré que tout
était p rêt pour nous recevoir, il revint à la hâte nous inviter à
le suivre.
Après avoir franchi une seconde enceinte, nous nous tro u vâmes
dans la cour intérieure, su r laquelle ouvrent les ap p a rtements
de la famille; au fond, de vastes écuries renferment les
chevaux et les chameaux. Nous remarquâmes un bâtiment plus
élevé que les autres et percé de plusieurs petites fenêtres sans
vitres, la chaleur du climat rendant ce luxe in u tile; c’était le
Khawah, la salle de réception, le parloir, si l’on v eu t; c a r je
ne saurais l’appeler sa lo n , puisque les dames ne l’honorent
jamais de leur présence. Il nous suffira de décrire le khawah de
Ghafil pour donner une idée de tous ceux de l’Arabie : cette pièce,
indispensable complément de chaque maison ta n t soit peu confortable,
offre partout, dans la Péninsule, les mêmes dispositions,
le même type, le même aménagement; elle est seulement
un peu plus grande ou un peu plus petite, plus ou moins rich e ment
meublée, selon la fortune du propriétaire.
Le khawah dans lequel notre hôte nous faisait en tre r était
une chambre haute de vingt pieds environ ."et longue de cinquante
; dans les murs, grossièrement décorés de peintures
brunes et blanches, on avait creusé de petites niches trian g u laires
destinées à recevoir des livres, mais qui chez Ghafil en
étaient fort peu pourvues; des solives plates et unies formaient
le plafond; le sol était couvert de.sable fin, et des bandes de ta pis,
sur lesquelles on avait disposé de distance en distance des
coussins de soie, garnissaient toute la longueur de la salle.
Dans les maisons moins opulentes, de grossières couvertures
remplacent les tapis. A l’angle le plus éloigné de la porte, se
trouvait un petit foyer, ou pour mieux dire un fourneau, ca r il
consiste en un bloc de granit de vingt pouces carrés, dans lequel
on pratique une longue ouverture renflée vers le h a u t et
communiquant avec un soufflet qui chasse l’a ir su r une grille
intérieure chargée de charbon. Il suffit de quelques minutes
pour que le combustible, complètement embrasé, fasse bouillir
la cafetière placée à la partie supérieure du tuyau. Ce système
est d’un usage universel chez les habitants du Djowf et du Dje