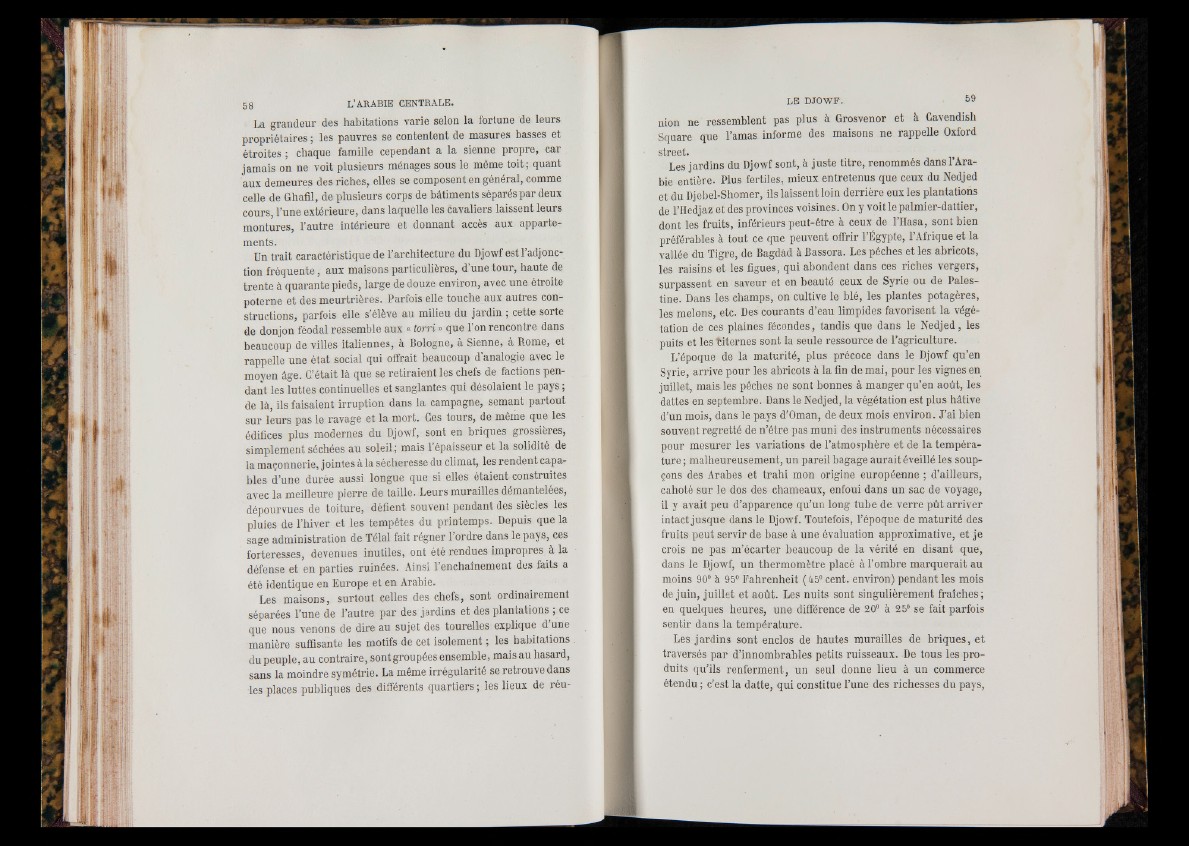
La grandeur des habitations varie selon la fortune de leurs
propriétaires ; les pauvres se contentent de masures basses et
étroites ; chaque famille cependant a la sienne propre, car
jamais on ne voit plusieurs ménages sous le même to it; quant
aux demeures des riches, elles se composent en général, comme
celle de Ghafil, de plusieurs corps de bâtiments séparés par deux
cours, l’une extérieure, dans laquelle les cavaliers laissent leurs
montures, l’au tre intérieure et donnant accès aux appartements.
Un trait caractéristique de l’architecture du Djowf est l’adjonction
fré q u en te , aux maisons particulières, d’une to u r, haute de
tren te à quarante pieds, large de douze environ, avec une étroite
poterne e t des meurtrières. Parfois elle touche aux autres constructions,
parfois elle s’élève au milieu du jardin ; cette sorte
de donjon féodal ressemble aux « torri » que l’on rencontre dans
beaucoup de villes italiennes, à Bologne, à Sienne, à Rome, et
rappelle une état social qui offrait beaucoup d'analogie avec le
moyen âge. C’éta it là que se re tira ien t les chefs de factions pendant
les luttes continuelles et sanglantes qui désolaient le pays ;
de là, ils faisaient irruption dans la campagne, semant partout
su r leurs pas le ravage et la mort. Ces tours, de même que les
édifices plus modernes du Djowf, sont en briques grossières,
simplement séchées au soleil; mais l’épaisseur et la solidité de
la maçonnerie, jointes à la sécheresse du climat, les rendent capables
d ’une durée aussi longue que si elles étaient construites
avec la meilleure pierre de taille. Leurs m urailles démantelées,
dépourvues de toiture , défient souvent pendant des siècles les
pluies de l’hiver e t les tempêtes du printemps. Depuis que la
sage administration de Télal fait régner l’ordre dans le pays, ces
forteresses, devenues inutiles, ont été rendues impropres à la
défense et en parties ruinées. Ainsi l’enchaînement des faits a
été identique en Europe et en Arabie.
Les maisons, su rto u t celles des chefs, sont ordinairement
séparées l’une de l ’autre p a r des jardins et des plantations ; ce
que nous venons de dire au sujet des tourelles explique d une
manière suffisante les motifs de cet isolement ; les habitations
du peuple, au contraire, sont groupées ensemble, mais au hasard,
sans la moindre symétrie. La même irrégularité se retrouve dans
■les places publiques des différents quartiers ; les lieux de ré u nion
ne ressemblent pas plus à Grosvenor e t à Gavendish
Square que l’amas informe des maisons ne rappelle Oxford
street.
Les ja rd in s du Djowf sont, à ju ste titre , renommés dans l’Arabie
entière. Plus fertiles, mieux entretenus que ceux du Nedjed
et du Djebel-Shomer, ils laissent loin derrière eux les plantations
de l’Hedjaz et des provinces voisines. On y voit le palmier-dattier,
dont les fruits, inférieurs peut-être à ceux de l ’Hasa, sont bien
préférables à tout ce que peuvent offrir l’Ëgypte, l’Afrique et la
vallée du Tigre, de Bagdad à Bassora. Les pêches et les abricots,
les raisins et les figues, qui abondent dans ces riches vergers,
surpassent en saveur et en beauté ceux de Syrie ou de Palestine.
Dans les champs, on cultive le blé, les plantes potagères,
les melons, etc. Des courants d’eau limpides favorisent la végétation
de ces plaines fécondes, tandis que dans le Nedjed, les
puits et les tite rn e s sont la seule ressource de l’agriculture.
L’époque de la maturité, plus précoce dans le Djowf qu’en
Syrie, arrive pour les abricots à la fin de mai, pour les vignes en
juillet, mais les pêches ne sont bonnes à manger qu’en août, les
dattes en septembre. Dans le Nedjed, la végétation est plus hâtive
d’un mois, dans le pays d’Oman, de deux mois environ. J’ai bien
souvent regretté de n ’être pas muni des instruments nécessaires
pour mesurer les variations de l’atmosphère e t de la température
; malheureusement, un pareil bagage au ra it éveillé les soupçons
des Arabes et tr a h i mon origine européenne ; d’ailleurs,
cahoté su r le dos des chameaux, enfoui dans u n sac de voyage,
il y avait peu d’apparence qu’un long tube de verre p û t a rriv e r
intact ju sq u e dans le Djowf. Toutefois, l’époque de m a tu rité des
fruits peut servir de base à une évaluation approximative, et je
crois ne pas m’é c a rte r beaucoup de la vérité en disant que,
dans le Djowf, u n thermomètre placé à l’ombre m a rq u e ra it au
moins 90° à 95° Fahrenhe it ( 45° cent, environ) pendant les mois
de ju in , ju ille t et août. Les nuits sont singulièrement fra îche s;
en quelques heures, une différence de 20° à 25° se fait parfois
sentir dans la température.
Les ja rd in s sont enclos de hautes murailles de b riq u e s , e t
traversés p a r d’innombrables petits ruisseaux. De tous les produits
qu’ils ren ferm en t, un seul donne lieu à u n commerce
étendu ; c’est la datte, qui constitue l’une des richesses du pays,