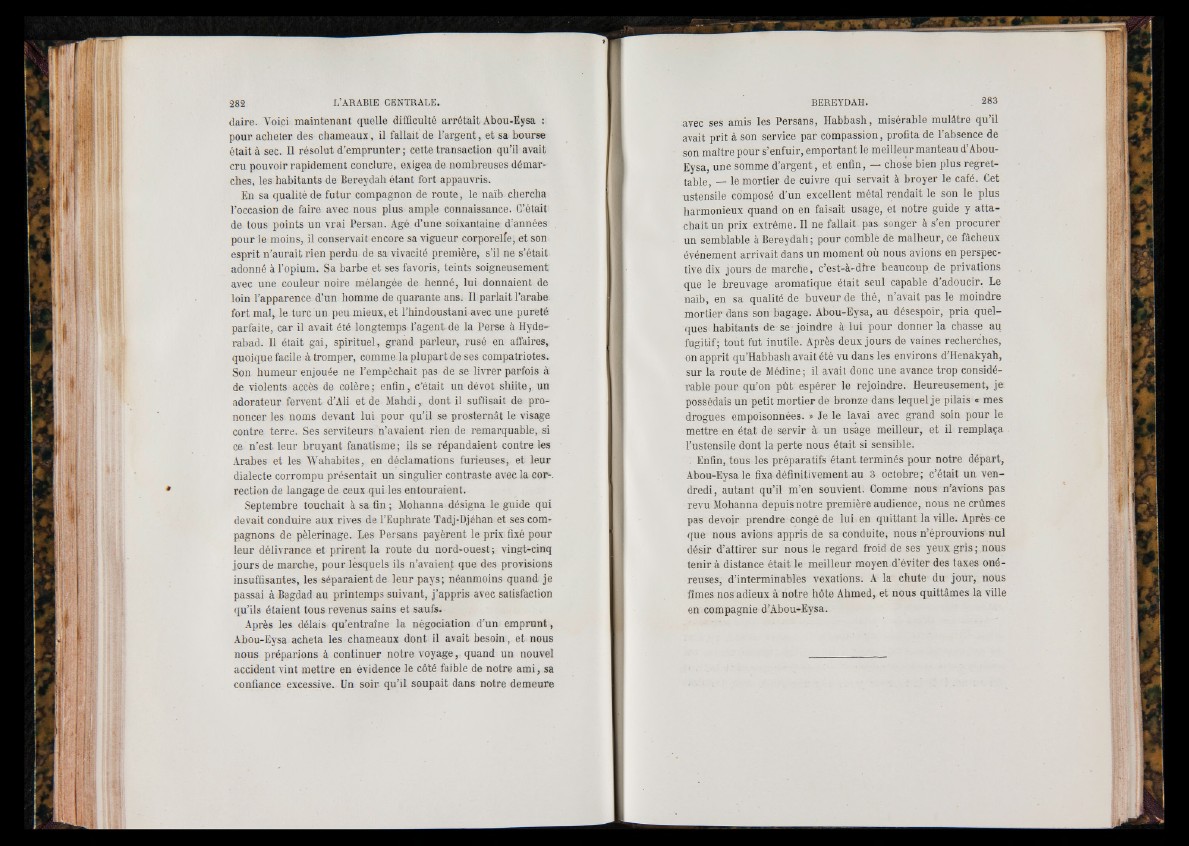
daire. Voici maintenant quelle difficulté a rrê ta it Abou-Eysa :
pour acheter des chameaux, il fallait de l’a rg e n t, et sa bourse
était à sec. Il résolut d’em prunter ; cette transaction qu’il avait
c ru pouvoir rapidement conclure, exigea de nombreuses démarches,
les habitants de Bereydah étant fort appauvris.
En sa qualité de fu tu r compagnon de ro u te , le naïb chercha
l’occasion de faire avec nous plus ample connaissance. C’était
de tous points un vrai Persan. Agé d’une soixantaine d’années
pour le moins, il conservait encore sa vigueur corporelle, et son
esprit n’aurait rien perdu de sa vivacité première, s’il ne s’était
adonné à l’opium. Sa barbe et ses favoris, teints soigneusement
avec une couleur noire mélangée de henné, lui donnaient de
loin l’apparence d’un homme de quarante ans. Il parlait l’arabe
fo rt mal, le turc un peu mieux, e t l’hindoustani avec une pureté
parfaite, car il avait été longtemps l’agent de la Perse à Hyde-
rabad. Il était gai, spirituel, grand parleur, rusé en affaires,
quoique facile à tromper, comme la plupa rt de ses compatriotes.
Son hum eu r enjouée ne l’empêchait pas de se livrer parfois à
de violents accès de colère ; enfin, c’était un dévot sh iite , un
adorateur fervent d’Ali e t de Mahdi, dont il suffisait de prononcer
les noms devant lu i pour qu’il se prosternât le visage
contre te rre. Ses serviteurs n’avaient rien de remarquable, si
ce n’est leur bruyant fanatisme; ils se répandaient contre les
Arabes e t les Wahabites, en déclamations furieuses, e t leur
dialecte corrompu présentait un singulier contraste avec la cor-,
rection de langage de ceux qui les entouraient.
Septembre touchait à sa fin ; Mohanna désigna le guide qui
devait conduire aux rives de l’Euphrate Tadj-Djéhan et ses compagnons
de pèlerinage. Les Persans payèrent le prix fixé pour
leur délivrance et p rire n t la route du nord-ouest; vingt-cinq
jo u rs de marche, pour lesquels ils n’avaient que des provisions
insuffisantes, les séparaient de le u r pays; néanmoins quand je
passai à Bagdad au printemps suivant, j ’appris avec satisfaction
qu’ils étaient tous revenus sains et saufs.
Après les délais qu’entraîne la négociation d’un em p ru n t,
Abou-Eysa acheta les chameaux dont il avait besoin, e t nous
nous préparions à continuer n otre voyage, quand un nouvel
accident vint mettre en évidence le côté faible de notre am i, sa
confiance excessive. Un soir qu’il soupait dans notre demeure
avec ses amis les Persans, Habbash, misérable mulâtre qu’il
avait p rit à son service par compassion, profita de l’absence de
son maître pour s’enfuir, emportant le meilleur manteau d’Abou-
Eysa, une somme d’a rg en t, e t enfin, — chose bien plus regrettable,
— le mortier de cuivre qui servait à broyer le café. Cet
ustensile composé d’un excellent métal rendait le son le plus
harmonieux quand on en faisait usage, et notre guide y a tta ch
a it un prix extrême. Il ne fallait pas songer à s’en procurer
un semblable à Bereydah; pour comble de malheur, ce fâcheux
événement arrivait dans un moment où nous avions en perspective
dix jours de marche, c'est-à-dire beaucoup de privations
que le breuvage aromatique était seul capable d’adoucir. Le
naïb, en sa qualité de buveur de thé, n avait pas le moindre
m o rtie r dans son bagage. Abou-Eysa, au désespoir, pria quelques
habitants de se joindre à lui pour donner la chasse au
fugitif; to u t fut inutile. Après deux jo u rs de vaines recherches,
on apprit qu’Habbash avait été vu dans les environs d’Henakyah,
sur la route de Médine; il avait donc une avance trop considérable
pour qu’on p û t espérer le rejoindre. Heureusement, je
possédais un petit mortier de bronze dans lequel je pilais * mes
drogues empoisonnées. » Je le lavai avec grand soin pour le
mettre en état de servir à u n usage meilleur, e t il remplaça
l’ustensile dont la perte nous était si sensible.
. Enfin, tous les préparatifs étant terminés pour notre départ,
Abou-Eysa le fixa définitivement au 3 octobre; c’était u n vendredi,
autant qu’il m’en souvient. Comme nous n’avions pas
revu Mohanna depuis notre première audience, nous ne crûmes
pas devoir prendre congé de lui en quittant la ville. Après-ce
que nous avions appris de sa conduite, nous n’éprouvions n u l
désir d’attirer sur nous le rega rd froid de ses yeux gris ; nous
tenir à distance était le meilleur moyen d’éviter des taxes onéreuses,
d’interminables vexations. A la chute du jo u r, nous
fîmes nos adieux à notre hôte Ahmed, et nous quittâmes la ville
en compagnie d’Àbou-Eysa.