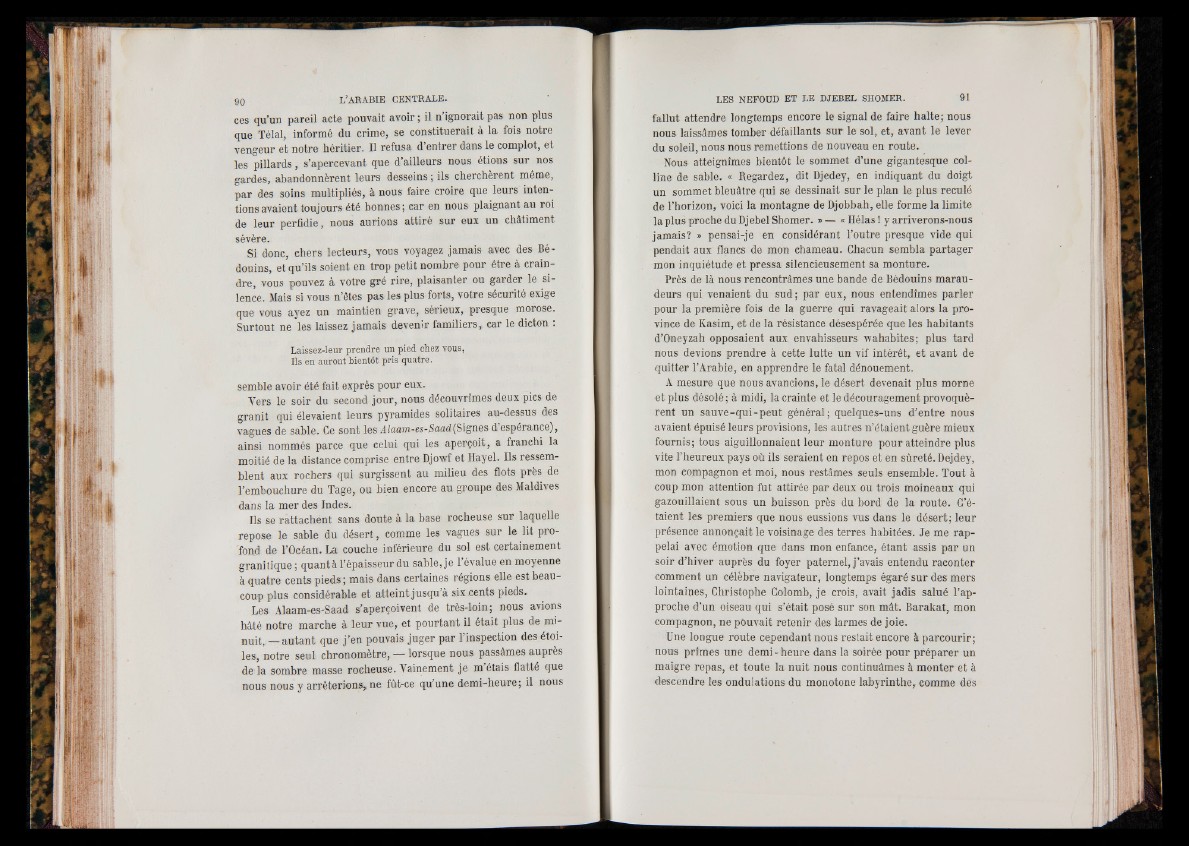
ces qu’un pareil acte pouvait avoir ; il n ignorait pas non plus
que Télal, informé du crime, se constituerait à la fois notre
vengeur e t notre héritier. Il refusa d’entre r dans le complot, et
les p illa rd s , s’apercevant que d’ailleurs nous étions sur nos
gardes, abandonnèrent leurs desseins ; ils cherchèrent même,
p a r des soins multipliés, à nous faire croire que leurs intentions
avaient toujours été bonnes; car en nous plaignant au roi
de le u r perfidie, nous aurions a ttiré su r eux un châtiment
sévère.
Si donc, chers lecteurs, vous voyagez jamais avec des Bédouins,
et qu’ils soient en trop petit nombre pour être à craindre,
vous pouvez à votre gré rire , plaisanter ou garder le silence.
Mais si vous n ’êtes pas les plus forts, votre sécurité exige
que vous ayez un maintien grave, sérieux, presque morose.
Surtout ne les laissez jamais devenir familiers, car le dicton :
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.
semble avoir été fait exprès pour eux.
Vers le soir du seeond jo u r, nous découvrîmes deux pics de
g ran it qui élevaient leurs pyramides solitaires au-dessus des
vagues de sable. Ce sont les Alaam-es-Sa,ad(Signes d espérance),
ainsi nommés parce que celui qui les aperçoit, a franchi la
moitié de la distance comprise entre Djowf et Hayel. Ils ressemble
n t aux rochers qui surgissent au milieu des flots près de
l’embouchure du Tage, ou bien encore au groupe des Maldives
dans la m e r des Indes.
Ils se ra tta ch e n t sans doute à la base rocheuse su r laquelle
repose le sable du d é s e r t, comme les vagues su r le lit p ro fond
de l’Océan. La couche inférieure du sol est certainement
granitique ; q u an tà l’épaisseur du sable, je 1 évalue en moyenne
à quatre cents pieds ; m a is dans certaines régions elle est beaucoup
plus considérable e t a tte in t ju sq u ’à six cents pieds.
Les Alaam-es-Saad s’aperçoivent de très-loin; nous avions
hâté n otre marche à le u r vue, et p o u rtan t il était plus de min
u i t ,— a u ta n t que j ’en pouvais ju g e r par 1 inspection des étoiles,
notre seul chronomètre, — lorsque nous passâmes auprès
de là sombre masse rocheuse. Vainement je m étais flatté que
nous nous y arrêterions, ne fût-ce qu’une demi-heure ; il nous
fallut attendre longtemps encore le signal de faire halte; nous
nous laissâmes tomber défaillants su r le sol, et, avant le lever
du soleil, nous nous remettions de nouveau en route.
Nous atteignîmes bientôt le sommet d’une gigantesque colline
de sable. « Regardez, dit Djedey, en indiquant du doigt
un sommet bleuâtre qui se dessinait su r le plan le plus reculé
de l’horizon, voici la montagne de Djobbah, elle forme la limite
la plus proche du Djebel Shomer. * — « Hélas ! y arriverons-nous
jamais? » pensai-je en considérant l’outre presque vide qui
pendait aux flancs de mon chameau. Chacun sembla partager
mon inquiétude et pressa silencieusement sa monture.
Près de là nous rencontrâmes une bande de Bédouins m a rau deurs
qui venaient du sud ; par eux, nous entendîmes parle r
pour la première fois de la guerre qui ravageait alors la province
de Kasim, et de la résistance désespérée que les habitants
d’Oneyzah opposaient aux envahisseurs wahabites; plus ta rd
nous devions prendre à cette lutte u n vif inté rêt, e t avant de
qu itter l’Arabie, en apprendre le fatal dénouement.
A mesure que nous avancions, le désert devenait plus morne
e t plus désolé; à midi, la crainte et le découragement provoquèren
t un s a u v e -q u i-p e u t général; quelques-uns d’en tre nous
avaient épuisé leurs provisions, les autres n’étaient guère mieux
fournis; tous aiguillonnaient leur monture p o u r atteindre plus
vite l’heureux pays où ils seraient en repos et en sûreté. Dejdey,
mon compagnon e t moi, nous restâmes seuls ensemble. Tout à
coup mon attention fut attirée p a r deux ou trois moineaux qui
gazouillaient sous un buisson près du bord de la ro u te . C’étaient
les premiers que nous eussions vus dans le désert; leu r
présence annonçait le voisinage des te rres habitées. Je me rap pelai
avec émotion que dans mon enfance, étant assis p a r un
soir d’hiver auprès du foyer paternel, j ’avais entendu raconter
comment un célèbre navigateur, longtemps égaré su r des mers
lointaines, Christophe Colomb, je crois, avait jadis salué l ’approche
d’un oiseau qui s’était posé sur son mât. Barakat, mon
compagnon, ne pouvait re te n ir des larmes de joie.
Une longue route cependant nous restait encore à p a rc o u rir;
nous prîmes une demi - h eure dans la soirée p o u r p ré p a re r un
maigre repas, et to u te la n u it nous continuâmes à monte r et à
descendre les ondulations du monotone labyrinthe, comme des