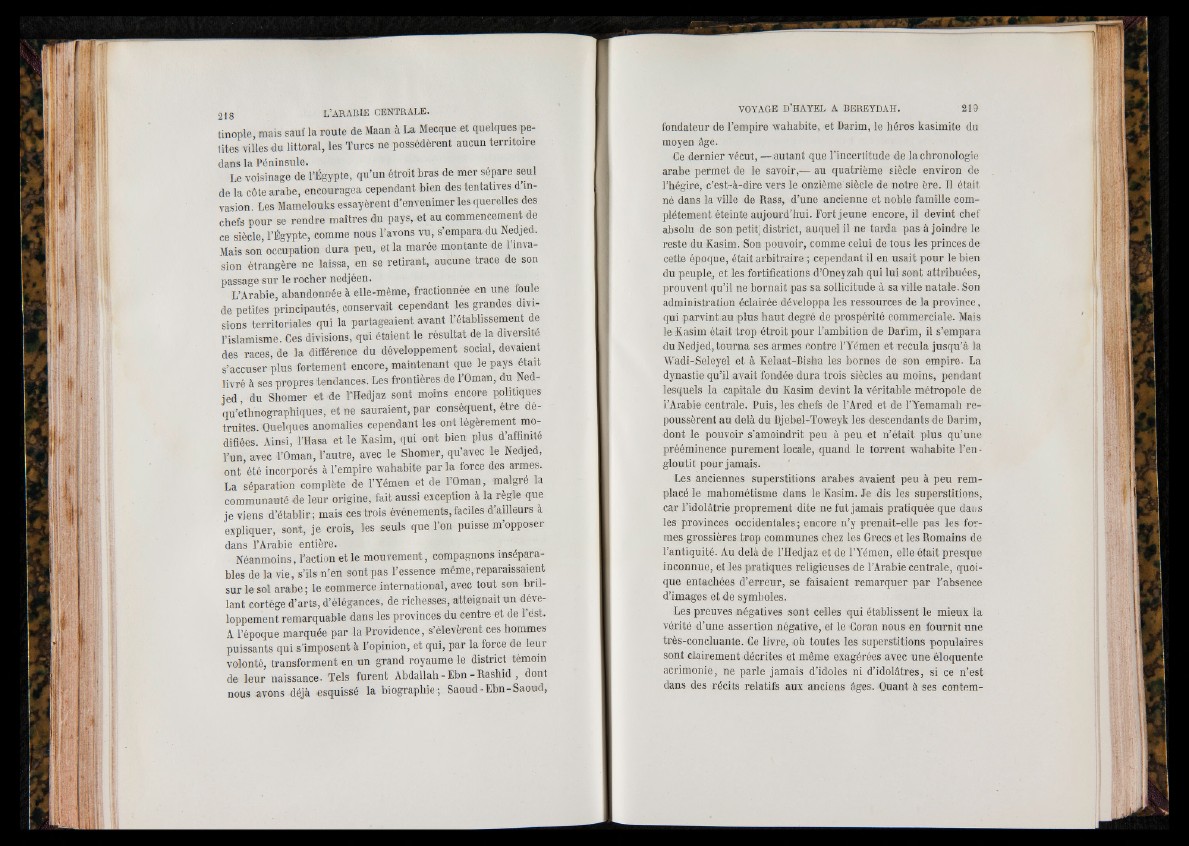
tinople, mais sauf la route de Maan à La Mecque et quelques petites
villes du littoral, les Turcs ne possédèrent aucun te rritoire
dans la P éninsule.
Le voisinage de l’Egypte, qu’un étroit bras de mer separe seul
de la côte arabe, encouragea cependant bien des tentatives d invasion.
Les Mamelouks essayèrent d’envenimer les querelles des
chefs pour se rendre maîtres du pays, et au commencement de
ce siècle, l’Ëgypte, comme nous l’avons vu, s’empara du Nedjed.
Mais son occupation d u ra peu, et la marée montante de l ’invasion
étrangère ne laissa, en se retirant, aucune trace de son
passage su r le rocher nedjéen.
L’Arabie, abandonnée à elle-même, fractionnée en une foule
de petites principautés, conservait cependant les grandes divisions
territoriales qui la partageaient avant l ’établissement de
l’islamisme. Ces divisions, qui étaient le résultat de la diversité
des races, de la différence du développement social, devaient
s’accuser plus fortement encore, maintenant que le pays était
livré à ses p ropres tendances. Les frontières de 1 Oman, du Nedje
d , du Shomer e t de l’Hedjaz sont moins encore politiques
qu’ethnographiques, et ne sauraient, p a r conséquent, être de-
truite s. Quelques anomalies cependant les ont légèrement modifiées.
Ainsi, l’Hasa et le Kasim, qui ont bien plus d’affinité
l’u n , avec l ’Oman, l’autre, avec le Shomer, qu’avec le Nedjed,
o n t été incorporés à l ’empire wahabite p a r la force des armes.
La séparation complète de l’Yémen et de l ’Oman, malgré la
communauté de leur origine, fait aussi exception à la règle que
je viens d’établir; mais ces trois événements, faciles d’ailleurs à
expliquer, sont, je crois, les seuls que l’on puisse m opposer
dans l’Arabie entière.
Néanmoins, l’action e t le mouvement, compagnons inséparables
de la vie, s’ils n ’en sont pas l’essence même, reparaissaient
sur le sol a ra b e ; le commerce international, avec tout son b rillant
cortège d’arts, d’élégances, de richesses, atteignait u n développement
remarquable dans les provinces du centre e t de l’est.
A l’époque marquée p a r la Providence, s’élevèrent ces hommes
puissants qui s ’imposent à l’opinion, et qui, p ar la force de leur
volonté, transforment en u n grand royaume le district témoin
de le u r naissance- Tels fu ren t Abdallah - Ebn - Rashid , dont
nous avons déjà esquissé la biographie ; Saoud-Ebn-S aoud,
fondateur de l’empire wahabite, et Darim, le héros kasimite du
moyen âge.
Ce dernier vécut, —autant que l’incertitude de la chronologie
arabe permet de le s a v o ir,^ au quatrième siècle environ de
l’hégirê, c’est-à-dire vers le onzième’siècle de n otre ère. Il était
né dans la ville de Rass, d’une ancienne et noble famille complètement
éteinte aujourd’hui. Fort jeune encore, il devint chef
absolu de son petit: district, auquel il ne ta rd a pas à joindre le
reste du Kasim. Son pouvoir, comme celui de tous les princes de
cette époque, était arbitraire ; cependant il en usait p o u r le bien
du peuple., et les fortifications d’Oneyzah qui lui sont attribuées,
prouvent qu’il ne bornait pas sa sollicitude à sa ville natale. Son
administration éclairée développa les ressources de la province,
qui parvint au plus h au t degré de prospérité commerciale. Mais
le Kasim était trop étroit pour l’ambition de Darim, il s’empara
du Nedjed, to u rn a ses armes contre l’Yémen e t recula jusqu’à la
Wadi-Seleyel et à Kelaat-Bisha les bornes de son empire. La
dynastie qu’il avait fondée dura trois siècles au moins, pendant
lesquels la capitale du Kasim devint la véritable métropole de
l’Arabie centrale. Puis, les chefs de l’Ared et de l’Yemamah re poussèrent
au delà du Djehel-Toweyk les descendants de Darim,
dont le pouvoir s’amoindrit peu à peu et n’était plus qu’une
prééminence purement locale, quand le torrent wahabite l’e n gloutit
pour jamais.
Les anciennes superstitions arabes avaient peu à peu rem placé
le mahométisme dans le Kasim. Je dis les superstitions,
car l ’idolâtrie proprement dite ne fut jamais pratiquée que dans
les provinces occidentales ; encore n ’y prenait-elle pas les formes
grossières trop communes chez les Grecs et les Romains de
l’antiquité. Au delà de l’Hedjaz et de l ’Yémen, elle était presque
inconnue, et les pratiques religieuses de l’Arabie centrale, quoique
entachées d’e rre u r, se faisaient remarquer p a r l’absence
d’images et de symboles.
Les preuves négatives sont celles qui établissent le mieux la
vérité d’une assertion négative, et le Coran nous en fournit une
très-concluante. Ce livre, où toutes les superstitions populaires
sont clairement décrites et même exagérées avec une éloquente
acrimoniè, ne parle jamais d’idoles ni d’idolâtres, si ce n ’est
dans des récits relatifs aux anciens âges. Quant à ses contem