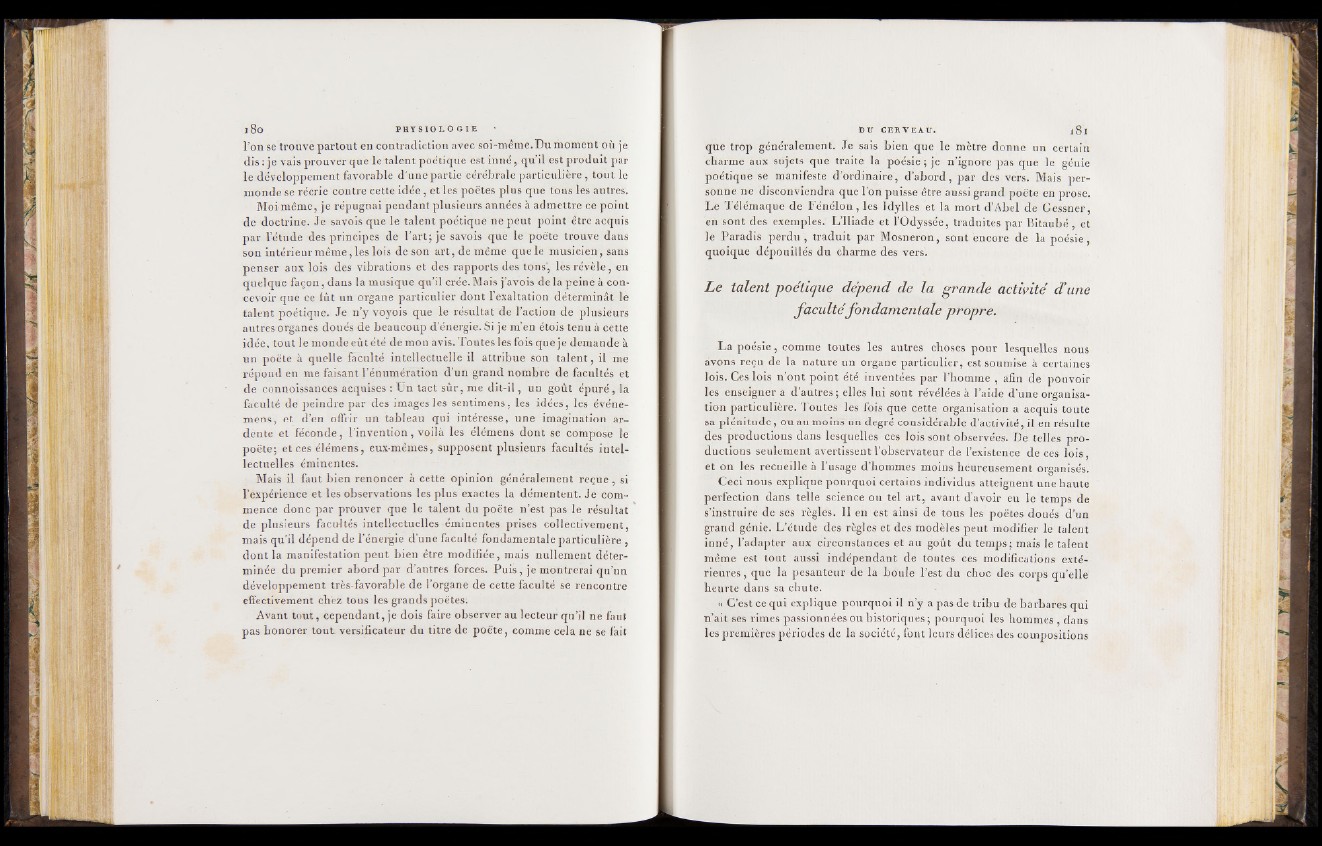
l’on se trouve partout en contradiction avec soi-même. Du moment où je
dis : je vais prouver que le talent poétique est inné, qu’il est produit par
le développement favorable d'une partie cérébrale particulière , tou t le
monde se récrie contre cette idée, et les poètes plus que tous les autres.
Moi même, je répugnai pendant plusieurs années à admettre ce point
de doctrine. Je savois que le talent poétique ne peut point être acquis
par l’étude des principes de l’art; je savois que le poète trouve dans
Son intérieur même, les lois de son art, de même quele musicien, sans
penser aux lois des vibrations et des rapports des tons', les révèle, en
quelque façon, dans la musique qu’il crée.Mais j’avois delà peine à concevoir
que ce fût un organe particulier dont l’exaltation déterminât le
talent poétique. Je n’y voyois que le résultat de l’action de plusieurs
autres organes doués de beaucoup d’énergie. Si je m’en étois tenu à cette
idée, tout le monde eût été de mon avis. Toutes les fois que je demande à
un poêle à quelle faculté intellectuelle il attribue son talent, il me
répond en me faisant l’énumération d’un grand nombre de facultés et
de connoissances acquises : Un tact sûr, me dit-il, un goût épuré, la
faculté de peindre par des images les sentimens, les idées, les événe-
mens, et d’en offrir un tableau qui intéresse, une imagination ardente
et féconde, l’invention, voilà les élémens dont se compose le
poète; et ces élémens, eux-mêmes, supposent plusieurs facultés intellectuelles
éminentes.
Mais il faut bien renoncer à cette opinion généralement reçue, si
l’expérience et les observations les plus exactes la démentent. Je commence
donc par prouver que le talent du poète n’est pas le résultat
de plusieurs facultés intellectuelles éminentes prises collectivement,
mais qu’il dépend de l’énergie d’une faculté fondamentale particulière ,
dont la manifestation peut bien être modifiée, mais nullement déterminée
du premier abord par d’autres forces. Puis, je montrerai qu’un
développement très-favorable de l’organe de cette faculté se rencontre
effectivement chez tous les grands poètes.
Avant tout, cependant, je dois faire observer au lecteur qu’il ne faut
pas honorer tout, versificateur du titre de poète, comme cela ne se fait
que trop généralement. Je sais bien que le mètre donne un certain
charme aux sujets que traite la poésie; je n’ignore pas que le génie
poétique se manifeste d’ordinaire, d’abord, par des vers. Mais personne
ne disconviendra que l'on puisse être aussi grand poète en prose.
Le Télémaque de Fénélon , les Idylles et la mort d’Abel de Gessner,
en sont des exemples. L’Iliade et l’Odyssée, traduites par Bitaubé , et
le Paradis perdu, traduit par Mosneron, sont encore de la poésie,
quoique dépouillés du charme des vers.
Le talent poétique dépend de la grande activité d’une
faculté fondamentale propre.
La poésie, comme toutes les autres choses pour lesquelles nous
avons reçu de la nature un organe particulier, est soumise à certaines
lois. Ces lois n’ont point été inventées par l ’homme , afin de pouvoir
les enseigner à d’autres; elles lui sont révélées à l ’aide d’une organisation
particulière. Toutes les fois que cette organisation a acquis toute
sa plénitude, ou au moins un degré considérable d’activité, il en résulte
des productions dans lesquelles ces lois sont observées. De telles productions
seulement avertissent l’observateur de l’existence de ces lois,
et on les recueille à l’usage d’hommes moins heureusement organisés.
Ceci nous explique pourquoi certains individus atteignent une haute
perfection dans telle science ou tel art, avant d’avoir eu le temps de
s’instruire de ses règles. 11 eu est ainsi de tous les poètes doués d’un
grand génie. L ’étude des règles et des modèles peut modifier le talent
inné, l’adapter aux circonstances et au goût du temps; mais le talent
même est tout aussi indépendant de toutes ces modifications extérieures
, que la pesanteur de la boule l ’est du choc des corps qu’elle
heurte dans sa chute.
« C’est ce qui explique pourquoi il n’y a pas de tribu de barbares qui
n’ait ses rimes passionnées ou historiques; pourquoi les hommes , dans
les premières périodes de la société, font leurs délices des compositions