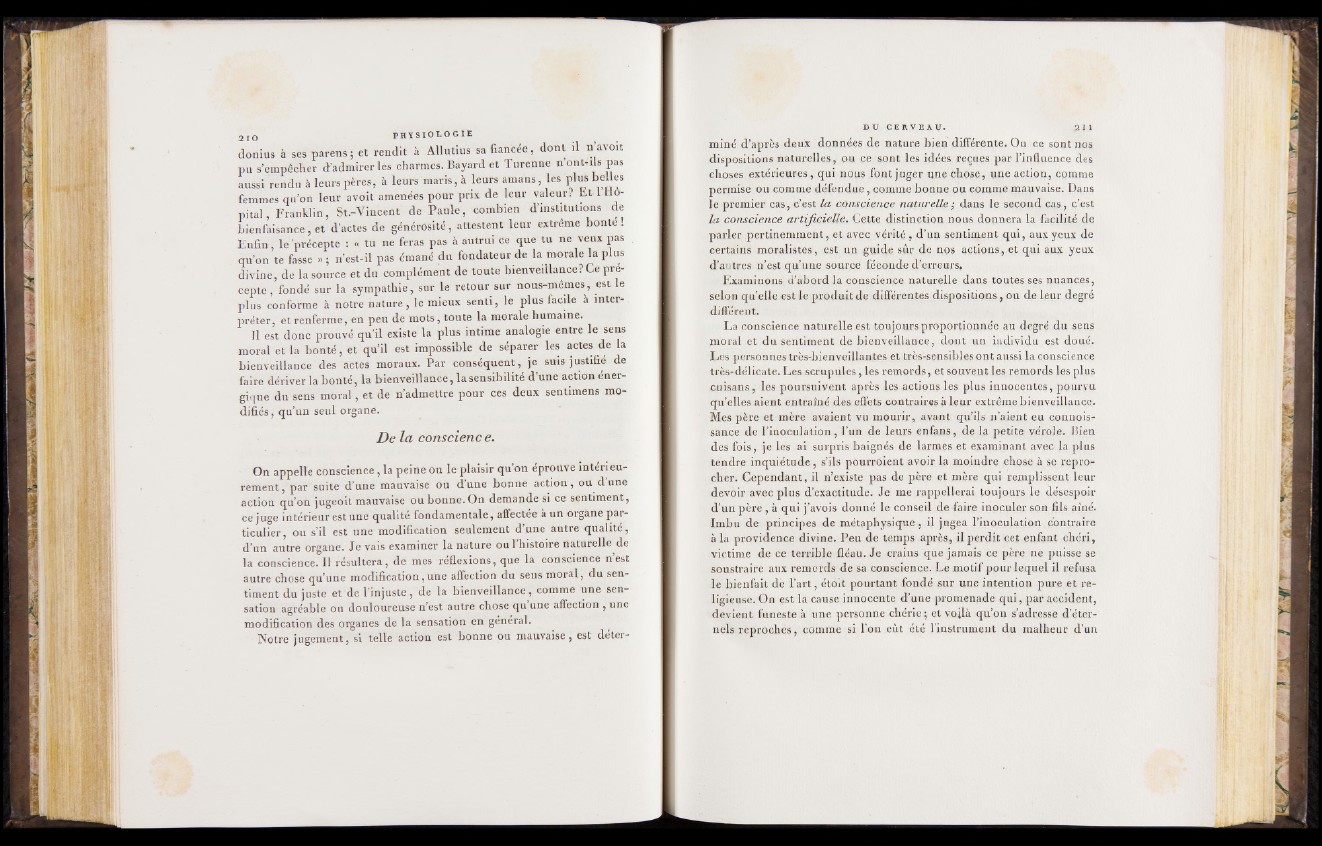
2I0 ph y s io l o g i e
donius à ses parens ; et rendit à Allutius sa fiancée, dont il n avoit
pu s’empêcher d'admirer les charmes. Bayard et Turenne n’ont+ds pas
aussi rendu à leurs pères, à leurs maris, à leurs amans, les plus belles
femmes qu’on leur a voit amenées pour prix de leur valeur: ht 1 Hôpital,
Franklin, St.-Vincent de Paule, combien d’institutions de
bienfaisance, et d’actes de générosité, attestent leur extreme bonte !
Enfin, le ’précepte : « tu ne feras pas à autrui Ce que tu ne veux pas
qu’on te fasse » ; n’est-il pas émané du fondateur de la morale la plus
divine, de la source et du complément de toute bienveillance?Ce précepte
, fondé sur la sympathie, sur le retour sur nous-mêmes, est le
plus conforme à notre nature, le mieux senti, le plus facde à interpréter,
et renferme, en peu de mots, toute la morale humaine.
11 est donc prouvé qu’il existe la plus intime analogie entre le sens
moral et la bonté, et qu’il est impossible de séparer les actes de la
bienveillance des actes moraux. Par conséquent, je suis justifié de
faire dériver la bonté, la bienveillance, la sensibilité d’une action énergique
du sens moral, et de n’admettre pour ces deux sentimens modifiés
, qu’un seul organe.
De la conscienc e.
On appelle conscience, la peine ou le plaisir quon éprouvé intérieurement,
par suite d’une mauvaise ou d’une bonne action, ou dune
action qu’on jugeoit mauvaise ou bonne. On demande si ce sentiment,
ce juge intérieur est une qualité fondamentale, affectée à un organe particulier,
ou s’il est une modification seulement d’une autre qualité,
d’un autre organe. Je vais examiner la nature ou l’histoire naturelle de
la conscience. Il résultera, de mes réflexions, que la conscience n’est
autre chose qu’une modification,une affection du sens moral, du sentiment
du juste et de l’injuste , de la bienveillance, comme une sensation
agréable ou douloureuse n’est autre chose qu une affection , une
modification des organes de la sensation en general.
Notre jugement, si telle action est bonne ou mauvaise, est déterminé
d’après deux données de nature bien différente. Ou ce sont nos
dispositions naturelles, ou ce sont les idées reçues par l’influence des
choses extérieures, qui nous font juger une chose, une action, comme
permise ou comme défendue, comme bonne ou comme mauvaise. Dans
le premier cas, c’est la conscience naturelle ; dans le second cas, c’est
la conscience artificielle. Cette distinction nous donnera la facilité de
parler pertinemment, et avec vérité, d’un sentiment qui, aux yeux de
certains moralistes, est un guide sûr de nos actions, et qui aux yeux
d’autres n’est qu’une source féconde d’erreurs.
Examinons d’abord la conscience naturelle dans toutes ses nuances,
selon qu’elle est le produit de différentes dispositions, ou de leur degré
différent.
La conscience naturelle est toujours proportionnée au degré du sens
moral et du sentiment de bienveillance, dont un individu est doué.
Les personnes très-bienveillantes et très-sensibles ont aussi la conscience
très-délicate. Les scrupules, les remords, et souyent les remords les plus
cuisans, les poursuivent après les actions les plus innocentes, pourvu
qu’elles aient entraîné des effets contraires à leur extrême bienveillance.
Mes père et mère avaient vu mourir, avant qu’ils n’aient eu connois-
sance de l’inoculation, l’un de leurs enfans, de la petite vérole. Bien
des fois, je les ai surpris baignés de larmes et examinant avec la plus
tendre inquiétude, s’ils pourroient avoir la moindre chose à se reprocher.
Cependant, il n’existe pas de père et mère qui remplissent leur
devoir avec plus d’exactitude. Je me rappellerai toujours le désespoir
d’un père , à qui j’avois donné le conseil de faire inoculer son fils aîné.
Imbu de principes de métaphysique, il jugea l’inoculation contraire
à la providence divine. Peu de temps après, il perdit cet enfant chéri,
victime de ce terrible fléau. Je crains que jamais ce père ne puisse se
soustraire aux remords de sa conscience. Le motif pour lequel il refusa
le bienfait de l’art, étoit pourtant fondé sur une intention pure et religieuse.
On est la cause innocente d’une promenade qui, par accident,
devient funeste à une personne chérie; et voilà qu’on s’adresse d’éter-
neis reproches, comme si l’on eût été l'instrument du malheur d’un