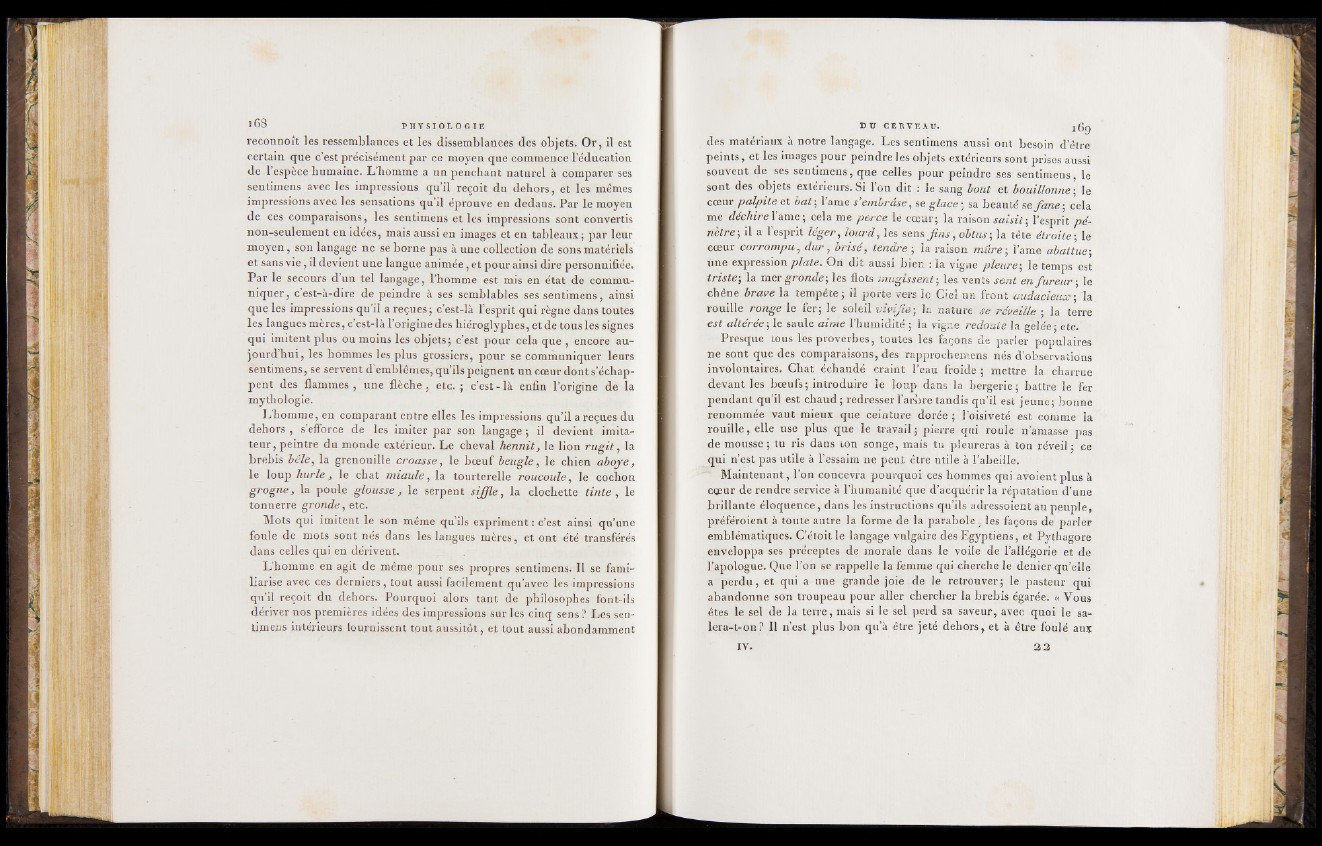
reconnoît les ressemblances et les dissemblances des objets. Or, il est
certain que c’est précisément par ce moyen que commence l’éducation
de l’espèce humaine. L ’homme a un penchant naturel à comparer ses
sentimens avec les impressions qu’il reçoit du dehors, et les mêmes
impressions avec les sensations qu’il éprouve en dedans. Par le moyen
de ces'comparaisons, les sentimens et les impressions sont convertis
non-seulement en idées, mais aussi en images et en tableaux; par leur
moyen, son langage ne se borne pas à une collection de sons matériels
et sans vie, il devient une langue animée, et pour ainsi dire personnifiée.
Par le secours d’un tel langage, l ’homme est mis en état de communiquer
, c’est-à-dire de peindre à ses semblables ses sentimens, ainsi
que les impressions qu’il a reçues; c’est-là l’esprit qui règne dans toutes
les langues mères, c’est-là l’origine des hiéroglyphes, et de tous les signes
qui imitent plus ou moins les objets; c’est pour cela que , encore aujourd’hui,
les hommes les plus grossiers, pour se communiquer leurs
sentimens, se servent d emblèmes, qu’ils peignent un coeur dont s’échappent
des flammes, une flèche, etc. ; c’est-là enfin l’origine de la
mythologie.
Lhomme, en comparant entre elles les impressions qu’il a reçues du
dehors , s’efforce de les imiter par son langage ; il devient imitateur,
peintre du monde extérieur. Le cheval hennit, le lion rugit, la
brebis bêle, la grenouille croasse, le bceuf beugle, le chien aboyé,
le loup hurle, le chat miaule, la tourterelle roucoule, le cochon
grogne, la poule glousse, le serpent siffle, la clochette tinte, le
tonnerre gronde, etc.
Mots qui imitent le son même qu’ils expriment : c’est ainsi qu’une
foule de mots sont nés dans les langues mères, et ont été transférés
dans celles qui en dérivent.
L ’homme en agit de même pour ses propres sentimens. Il se familiarise
avec ces derniers, tout aussi facilement qu’avec les impressions
qu’il reçoit du dehors. Pourquoi alors tant de philosophes font-ils
dériver nos premières idées des impressions sur les cinq sens ? Les sentimens
intérieurs fournissent tout aussitôt, et tout aussi abondamment
des matériaux à notre langage. Les sentimens aussi ont besoin d’être
peints, et les images pour peindre les objets extérieurs sont prises aussi
souvent de ses sentimens, que celles pour peindre ses sentimens, le
sont des objets extérieurs. Si Ion dit : le sang bout et bouillonne ; le
coeur palpite et bat-, l’ame s’embrâse, se glace ; sa beauté se fane-, cela
me déchire l’ame ; cela me perce le coeur; la raison saisit-, l’esprit pénètre,
il a l’esprit léger, lourd, les sens fin s , obtus-, la tête étroite; le
coeur corrompu, dur, brisé, tenüre -, la raison mûre ; l’ame abattue;
ùne expression plate. On dit aussi bien : la vigne pleure; le temps est
triste-, la mer gronde-, les flots mugissent-, les vents sont en fureur ; le
chêne brave la tempête; il porte vers le Ciel uu front audacieux; la
rouille ronge le fer; le soleil vivifie-, la nature se réveille ; la terre
est altérée-, le saule aime l’humidité ; la vigne redoute la gelée • etc.
Presque tous les proverbes, toutes les façons de parler populaires
ne sont que des comparaisons, des rapprochemens nés d’observations
involontaires. Chat échaudé craint l’eau froide ; mettre la charrue
devant les boeufs; introduire le loup dans la bergerie; battre le fer
pendant qu’il est chaud; redresser l’arbre tandis qu’il est jeune; bonne
renommée vaut mieux que ceinture dorée ; l ’oisiveté est comme la
rouille, elle use plus que le travail ; pierre qui roule n’amasse pas
de mousse ; tu ris dans ton songe, mais tu pleureras à ton réveil • ce
qui n’est pas utile à l’essaim ne peut être utile à l’abeille.
Maintenant, l’on concevra pourquoi ces hommes qui avoient plus à
coeur de rendre service à l’humanité que d’acquérir la réputation d’une
brillante éloquence, dans les instructions qu’ils adressoient au peuple,
préféroient à toute autre la forme de la parabole ; les façons de parler
emblématiques. C’étoit le langage vulgaire des Egyptiens, et Pythagore
enveloppa ses préceptes de morale dans le voile de l’allégorie et de
l’apologue. Que l’on se rappelle la femme qui cherche le denier qu’elle
a perdu, et qui a une grande joie de le retrouver; le pasteur qui
abandonne son troupeau pour aller chercher la brebis égarée. « Vous
êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera
t-on? Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors, et à être foulé aux
XV. 22