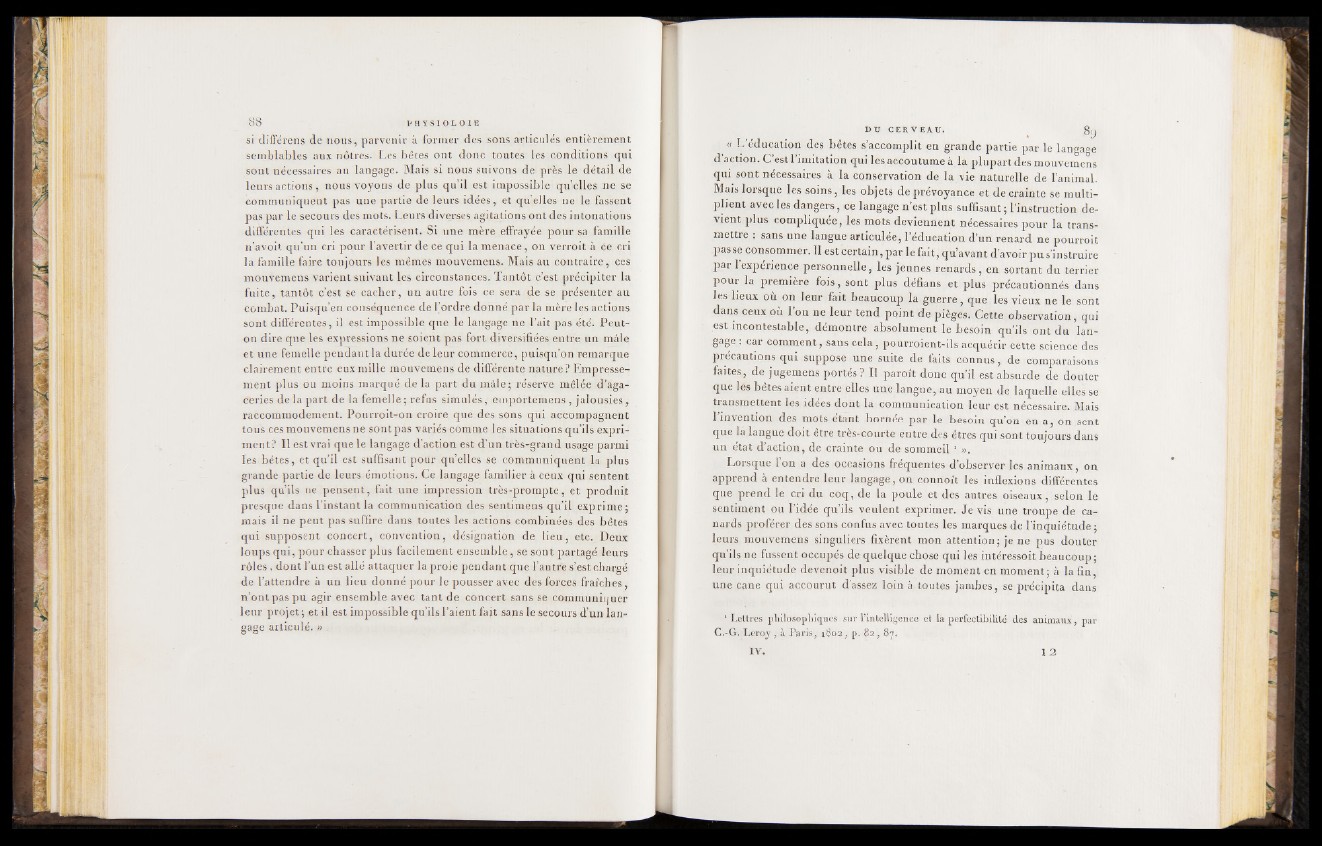
si différens de nous, parvenir à former des sons articulés entièrement
semblables aux nôtres. Les bêtes ont donc toutes les conditions qui
sont nécessaires au langage. Mais si nous suivons de près le détail de
leurs actions, nous voyons de plus qu’il est impossible qu’elles ne se
communiquent pas une partie de leurs idées, et quelles ne le fassent
pas par le secours des mots. Leurs diverses agitations ont des intonations
différentes qui les caractérisent. Si une mère effrayée pour sa famille
n’avoit qu’un cri pour l’avertir de ce qui la menace, on verroit à ce cri
la famille faire toujours les mêmes mouvemens. Mais au contraire, ces
mouvemens varient suivant les circonstances. Tantôt c’est précipiter la
fuite, tantôt c’est se cacher, un autre fois ce sera de se présenter au
combat. Puisqu’en conséquence de l’ordre donné par la mère les actions
sont différentes, il est impossible que le langage ne l’ait pas été) Peut-
on dire que les expressions ne soient pas fort diversifiées entre un mâle
et une femelle pendant la durée de leur commerce, puisqu’on remarque
clairement entre eux mille mouvemens de différente nature? Empressement
plus ou moins marqué de la part du mâle; réserve mêlée d’agaceries
delà part de la femelle ; refus simulés, emportemens , jalousies,
raccommodement. Pourroit-on croire que des sons qui accompagnent
tous ces mouvemens ne sont pas variés comme les situations qu’ils expriment?
Il est vrai que le langage d’action est d’un très-grand usage parmi
les bêtes, et qu’il est suffisant pour qu’elles se communiquent la plus
grande partie de leurs émotions. Ce langage familier à ceux qui sentent
plus qu’ils ne pensent, fait une impression très-prompte, et produit
presque dans l ’instant la communication des sentimens qu’il exprime;
mais il ne peut pas suffire dans toutes les actions combinées des bêtes
qui supposent concert, convention, désignation de lieu, etc. Deux
loups qui, pour chasser plus facilement ensemble, se sont partagé leurs
rôles , dont l’un est allé attaquer la proie pendant que l’autre s’est chargé
de l’attendre à un lieu donné pour le pousser avec des forces fraîches,
n’ont pas pu agir ensemble avec tant de concert sans se communiquer
leur projet; et il est impossible qu’ils l’aient fait sans le secours d’un langage
articulé. » .
« L ’éducation des bêtes s’accomplit en grande partie par le langage
d’action. C’est l’imitation qui les accoutume à la plupart des mouvemens
qui sont nécessaires à la conservation de la vie naturelle de l’animal.
Mais lorsque les soins, les objets de prévoyance et de crainte se multiplient
avec les dangers, ce langage n’est plus suffisant; l ’instruction devient
plus compliquée, les mots deviennent nécessaires pour la transmettre
: sans une langue articulée, l’éducation d’un renard ne pourrait
passe consommer. Il est certain, par le fait, qu’avant d’avoir pus’instruire
par l’expérience personnelle, les jeunes renards, en sortant du terrier
pour la première fois, sont plus défîans et plus précautionnés dans
les lieux où on leur fait beaucoup la guerre, que les vieux ne le sont
dans ceux où l’on ne leur tend point de pièges. Cette observation, qui
est incontestable, démontre absolument le besoin qu’ils ont du langage
: car comment, sans cela, pourroient-ils acquérir cette science des
précautions qui suppose une suite de faits connus, de comparaisons
faites., de jugemens portés? Il paraît donc qu’il est absurde de douter
que les bêtes aient entre elles une langue, au moyen de laquelle elles se
transmettent les idées dont la communication leur est nécessaire. Mais
l ’invention des mots étant bornée par le besoin qu’on en a, on sent
que la langue doit être très-courte entre des êtres qui sont toujours dans
un état d’action, de crainte ou de sommeil 1 ».
Lorsque 1 on a des occasions frequentes d’observer les animaux, on
apprend à entendre leur langage, on connoît les inflexions différentes
que prend le cri du coq, de la poule et des autres oiseaux, selon le
sentiment ou l’idée qu’ils veulent exprimer. Je vis une troupe de canards
proférer des sons confus avec toutes les marques de l ’inquiétude ;
leurs mouvemens singuliers fixèrent mon attention; je ne pus douter
qu’ils ne fussent occupés de quelque chose qui les intéressoit beaucoup ;
leur inquiétude devenoit plus visible de moment en moment; à la fin,
une cane qui accourut d’assez loin à toutes jambes, se précipita dans
1 Lettres philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilité des animaux, par
C.-G. Leroy, à Paris, 1802, p. 82,87,
IV . 1 2