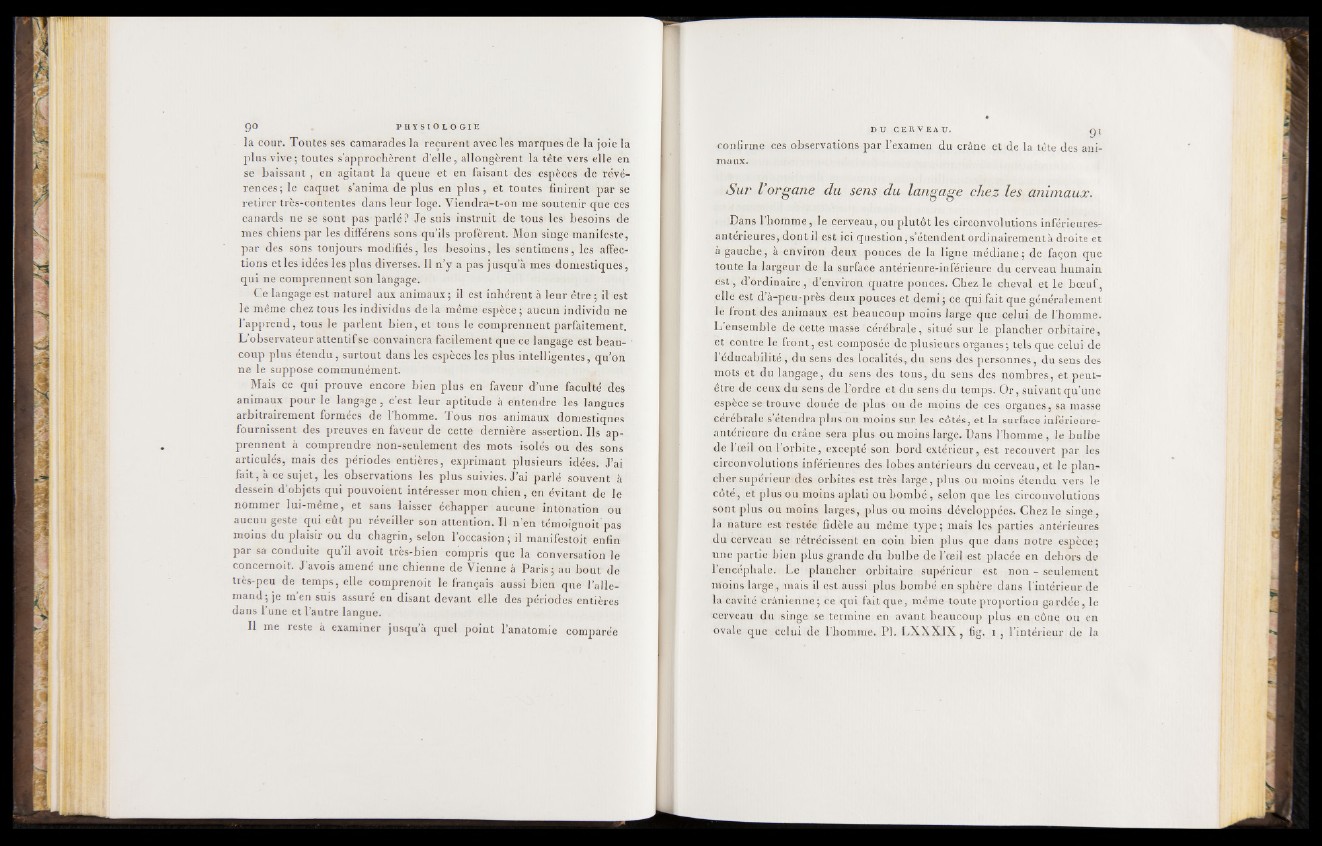
la cour. Toutes ses camarades la reçurent avec les marques de la joie la
plus vive; toutes s’approchèrent d’elle, allongèrent la tête vers elle en
se baissant , en agitant la queue et en faisant des espèces de révérences;
le caquet s’anima de plus en plus, et toutes finirent par se
retirer très-contentes dans leur loge. Viendra-t-on me soutenir que ces
canards ne se sont pas parlé? Je suis instruit de tous les besoins de
mes chiens par les différens sons qu’ils profèrent. Mon singe manifeste,
par des sons toujours modifiés, les besoins, les sentimens, les affections
etles idées les plus diverses. Il n’y a pas jusqu’à mes domestiques,
qui ne comprennent son langage.
Ce langage est naturel aux animaux; il est inhérent à leur être; il est
le même chez tous les individus de la même espèce; aucun individu ne
1 apprend, tous le parlent bien, et tous le comprennent parfaitement.
L ’observateur attentif se convaincra facilement que ce langage est beau- ■
coup plus étendu, surtout dans les espèces les plus intelligentes, qu’on
ne le suppose communément.
Mais ce qui prouve encore bien plus en faveur d’une faculté des
animaux pour le langage , c’est leur aptitude à entendre les langues
arbitrairement formées de l’homme. Tous nos animaux domestiques
fournissent des preuves en faveur de cette dernière assertion. Ils apprennent
à comprendre non-seulement des mots isolés ou des sons
articulés, mais des périodes entières, exprimant plusieurs idées. J’ai
fait, à ce sujet, les observations les plus suivies. J’ai parlé souvent à
dessein d’objets qui pouvoient intéresser mon chien, en évitant de le
nommer lui-même, et sans laisser échapper aucune intonation ou
aucun geste qui eût pu réveiller son attention. Il n’en tëmoignoit pas
moins du plaisir ou du chagrin, selon l’occasion; il manifestoit enfin
par sa conduite qu’il avoit très-bien compris que la conversation le
concernoit. J’avois amené une chienne de Vienne à Paris; au bout de
très-peu de temps, elle comprenoit le français aussi bien que l’allemand;
je m’en suis assuré en disant devant elle des périodes entières
dans l’une et l ’autre langue.
Il me reste à examiner jusqu’à quel point l ’anatomie comparée
confirme ces observations par l’examen du crâne et de la tête des animaux.
Sur l’organe du sens du langage chez les animaux.
Dans l’homme, le cerveau, ou plutôt les circonvolutions inférieures-
an térieures, dont il est ici question, s’étendent ordinairement à droite et
à gauche, à environ deux pouces de la ligne médiane; de façon que
toute la largeur de la surface antérieure-inférieure du cerveau humain
est, d’ordinaire, d’environ quatre pouces. Chez le cheval et le boeuf,
elle est d à-peu-près deux pouces et demi; ce qui fait que généralement
le front des animaux est beaucoup moins large que celui de l’homme.
Lensemble de cette masse cérébrale, situé sur le plancher orbitaire,
et contre le front, est composée de plusieurs organes; tels que celui de
l’éducabilité , du sens des localités, du sens des personnes, du sens des
mots et du langage, du sens des tons, du sens des nombres, et peut-
être de ceux du sens de l’ordre et du sens du temps. Or, suivant qu’une
espèce se trouve douée de plus ou de moins de ces organes, sa masse
cérébrale s’étendra plus ou moins sur les côtés, et la surface inférieure-
antérieure du crâne sera plus ou moins large. Dans l’homme , le bulbe
de l’oeil ou l ’orbite, excepté son bord extérieur, est recouvert par les
circonvolutions inférieures des lobes antérieurs du cerveau, et le plancher
supérieur des orbites est très large, plus ou moins étendu vers le
côté, et plus ou moins aplati ou bombé, selon que les circonvolutions
sont plus ou moins larges, plus ou moins développées. Chez le singe,
la nature est restée fidèle au même type; mais les parties antérieures
du cerveau se rétrécissent en coin bien plus que dans notre espèce;
une partie bien plus grande du bulbe de l’oeil est placée en dehors de
l’encéphale. Le plancher orbitaire supérieur est non - seulement
moins large, mais il est aussi plus bombé en sphère dans l'intérieur de
la cavité crânienne; ce qui fait que, meme toute proportion gardée, le
cerveau du singe se termine en avant beaucoup plus en cône ou en
ovale que celui de l’homme. PI. LX X X IX , fig. 1 , l ’intérieur de la