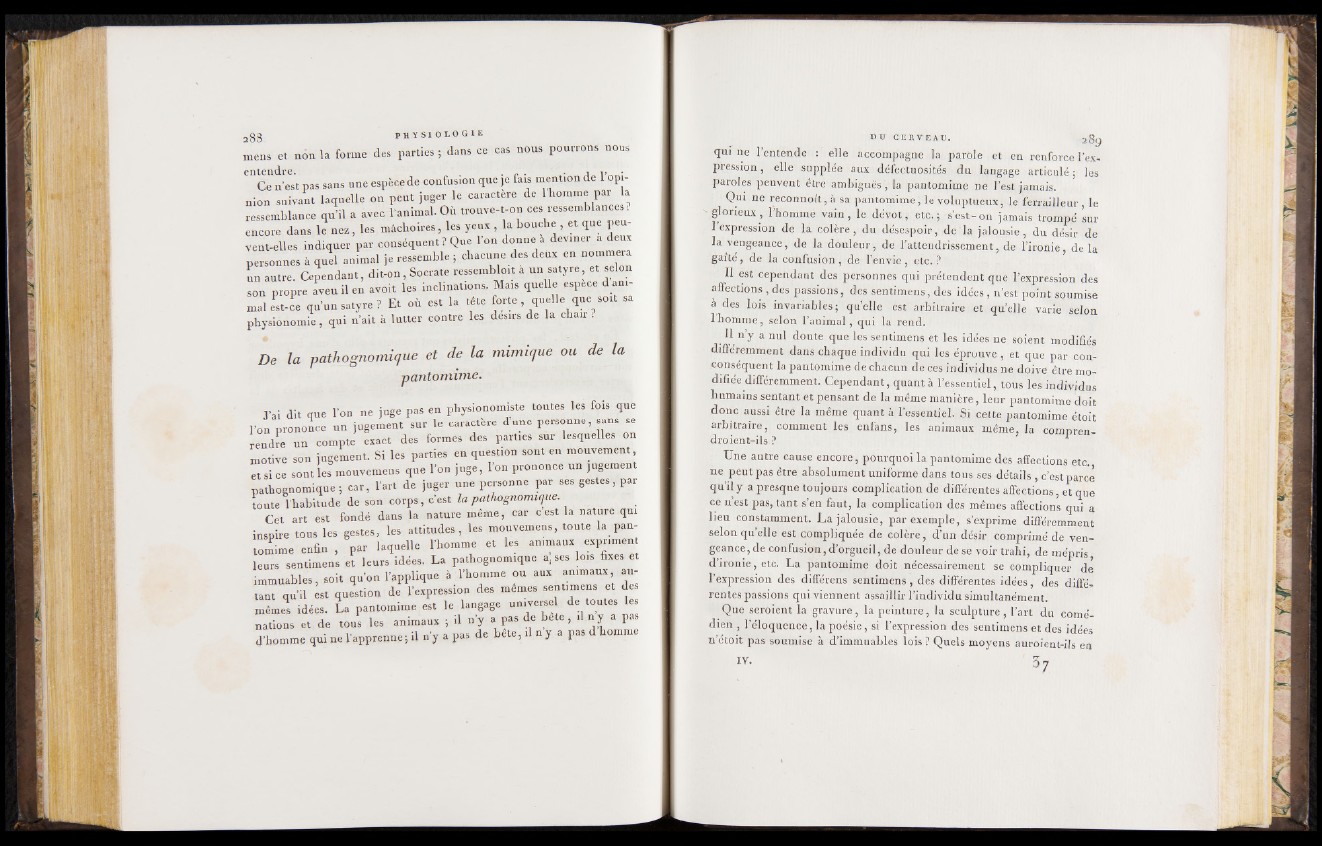
p h y s i o l o g i e 288
mens et nóu la forme des parties ; dans ce cas nous pourrons nous
entendre. . „ . . j •
Ce n’est pas sans une espèce de confusion que g fais mention de 1 opinion
suivant laquelle on peut juger le caractère de Ihomme par a
ressemblance qu’il a avec l'animal. Où trouve-t-on ces ressemblances.
encore dans le nez, les mâchoires, les yeux , la bouche , et que peuvent
elles indiquer par conséquent ? Que l’on donne a deviner a deux
personnes à quel animal je ressemble ; chacune des deux en nommera
un autre. Cependant, dit-on, Socrate ressembloit a un satyre, et selon
son propre aveu il en avoit les inclinations. Mais quelle espece d am-
mal est-ce qu’un satyre? Et où est la tête forte quelle que soit sa
physionomie, qui n’ait à lutter contre les désirs de la chair ;
De la pathognomique et de la mimique ou de la
pantomime.
J’ai dit que l’on ne juge pas en physionomiste toutes les fois que
l ’on prononce un jugement sur le caractère dune personne, sans se
rendre un compte exact des formes des parties sur lesquelles on
motive son jugement. Si les parties en question sont en mouvement,
“ si ce sont les mouvemens que l’on juge, l’on prononce un jugement
pathognomique ; car, l’art de juger une personne par ses gestes, par
toute l'habitude de son corps, c’est la pathognomique.
Cet art est fondé dans la nature même, car c est la nature qui
inspire tous les gestes, les attitudes, les mouvemens, toute la pantomime
enfin , par laquelle l’homme et les animaux expriment
leurs sentimens et leurs idées. La pathognomique a, ses lois fixes et
immuables, soit qu’on l’applique à l’homme ou aux animaux, autant
qu’il est question de l’expression des memes sentimens et des
mêmes idées. La pantomime est le langage universe de toutes les
nations et de tous les animaux ; U n’y a pas de bete, d n y a pas
d’homme qui ne l ’apprenne ; il n’y a pas de b ê te ,.ln y a pas d homme
DU CE RVEAU. 2 8 o
qui ne l ’entende : elle accompagne la parole et en renforce l ’expression
, elle supplée aux défectuosités du langage articulé ; les
paroles peuvent être ambiguës, la pantomime ne l ’est jamais.
Qui ne reconnoit, à sa pantomime, le voluptueux, le ferrailleur , le
- glorieux,-l’homme vain, le dévot, etc.,; s’est-on jamais trompé sur
1 expression de la colère, du désespoir, de la jalousie, du désir de
la vengeance, de la douleur, de l’attendrissement, de l’ironie, de la
gaîté, de la confusion, de l’envie, etc. ?
Il est cependant des personnes qui prétendent que l’expression des
affections , des passions, des sentimens, des idées, n’est point soumise
à des lois invariables; qu’elle est arbitraire et qu’elle varie selon
Ihomme, selon l ’animal, qui la rend.
Il n’y a nul doute que les sentimens et les idées ne soient modifiés
différemment dans chaque individu qui les éprouve , et que par con-
conséquent la pantomime de chacun de ces individus ne doive être modifiée
différemment. Cependant, quant à l’essentiel % tous les individus
humains sentant et pensant de la même manière, leur pantomime doit
donc aussi être la même quant à l ’essentiel. Si cette pantomime etoit
arbitraire, comment les enfans, les animaux même, la compren-
droient-ils ?
Une autre cause encore, pourquoi la pantomime des affections etc.
ne peut pas être absolument uniforme dans tous ses détails , c’est parce
qu’il y a presque toujours complication de différentes affections, et que
ce n’est pas, tant s’en faut, la complication des mêmes affections qui a
lieu constamment. La jalousie, par exemple, s’exprime différemment
selon qu’elle est compliquée de colère, d’un désir comprimé de vengeance,
de confusion,d’orgueil, de douleur de se voir trahi, de mépris
d’ironie, etc. La pantomime doit nécessairement se compliquer de
l’expression des différens sentimens, des différentes idées, des différentes
passions qui viennent assaillir l’individu simultanément.
Que seraient la gravure , la peinture, la sculpture , l’art du comédien
, l’éloquence, la poésie, si l’expression des sentimens et des idées
n’étoit pas soumise à d’immuables lois ? Quels moyens auroient-ils en