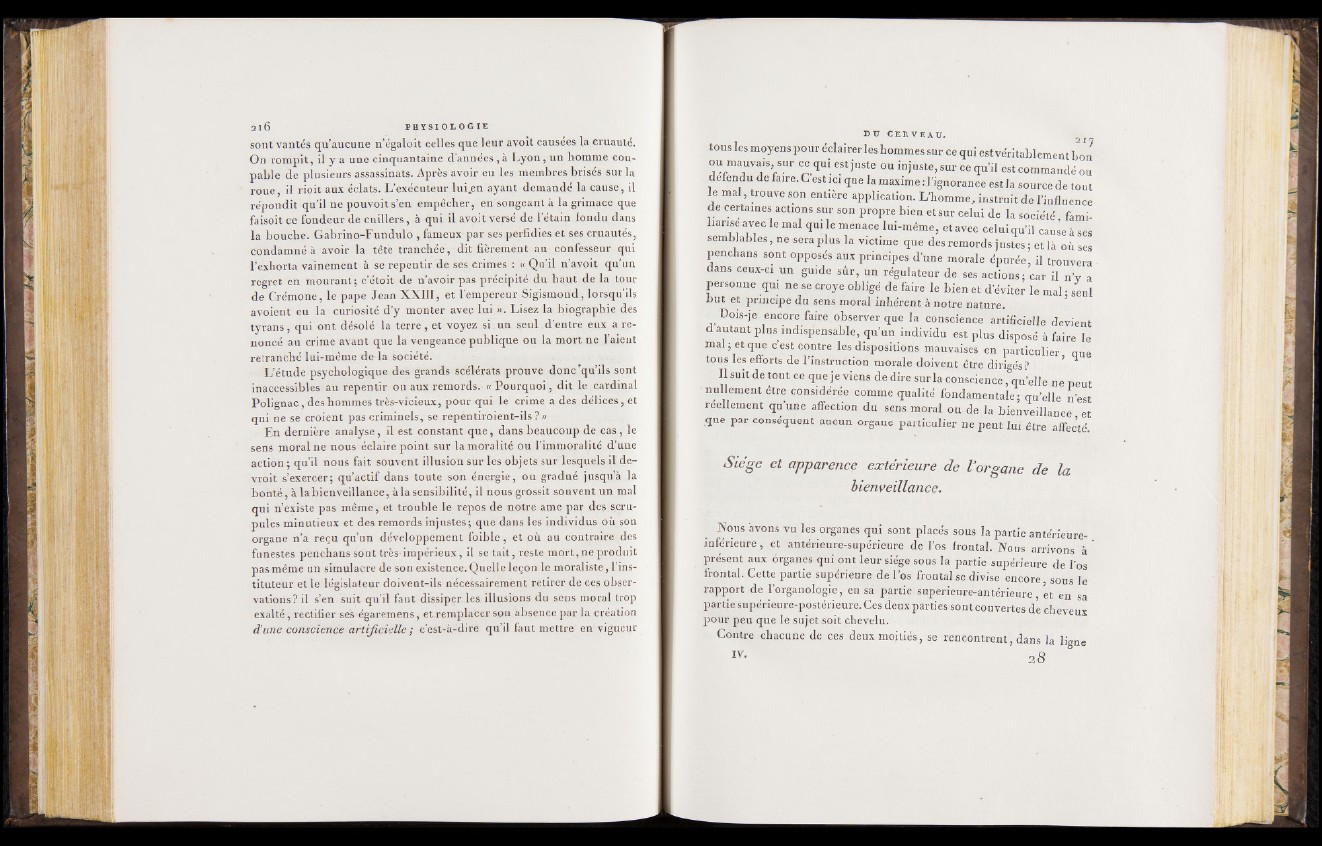
sont vantés qu’aucune n’égaloit celles que leur avoit causées la cruauté.
On rompit, il y a une cinquantaine d'années, à Lyon, un homme coupable
de plusieurs assassinats. Après avoir eu les membres brisés sur la
roue, il rioit aux éclats. L’exécuteur lui.en ayant demandé la cause, il
répondit qu’il ne pouvoits’en empêcher, en songeant à la grimace que
faisoit ce fondeur de cuillers, à qui il avoit versé de l’étain fondu dans
la bouche. Gabrino-Fundulo , fameux par ses perfidies et ses cruautés,
condamné à avoir la tête tranchée, dit fièrement au confesseur qui
l ’exhorta vainement à se repentir de ses crimes : « Qu’il n’avoit qu’un
regret en mourant; c’étoit de n’avoir pas précipité du haut de la tour
de Crémone, le pape Jean XXIII, et l’empereur Sigismond, lorsqu’ils
avoient eu la curiosité d’y monter avec lui ». Lisez la biographie des
tyrans, qui ont désolé la terre, et voyez si un seul d’entre eux a renoncé
au crime avant que la vengeance publique ou la mort ne l’aieut
reiranché lui-même de la société.
L’étude psychologique des grands scélérats prouve donc’qu’ils sont
inaccessibles au repentir ou aux remords. « Pourquoi, dit le cardinal
Polignac, des hommes très-vicieux, pour qui le crime a des délices, et
qui ne se croient pas criminels, se repen tirai ent-ils ? »
En dernière analyse, il est constant que, dans beaucoup de cas, le
sens moraine nous éclaire point sur la moralité ou l’immoralité d’une
action ; qu’il nous fait souvent illusion sur les objets sur lesquels il devrait
s’exercer; qu’actif dans toute son énergie, ou gradué jusqu’à la
bonté, à la bienveillance, à la sensibilité, il nous grossit souvent un mal
qui n’existe pas même, et trouble le repos de notre ame par des scru-
pules minutieux et des remords injustes; que dans les individus où son
organe n’a reçu qu’un développement foible, et où au contraire des
funestes penchans sont très-impérieux, il se tait, reste mort, ne produit
pas même un simulacre de son existence. Quelle leçon le moraliste, l’instituteur
et le législateur doivent-ils nécessairement retirer de ces observations?
il s’en suit qu’il faut dissiper les illusions du sens moral trop
exalté, rectifier ses égaremens, et remplacer son absence par la création
d’une conscience artificielle ; c’est-à-dire qu’il faut mettre en vigueur
B U C E RVEAU.
tous les moyens pour éclairer les hommes sur ce qui est véritablement bon
ou mauvais, sur ce qui est juste ou injuste, sur ce qu’il est commandé ou
défendu de famé. C est ic. que la maxime :l’ignorance est la source de tout
le mal, trouve son entière application. L ’homme, instruit de l’influence
de certaines actions sur son propre bien et sur celui de la société, familiarise
avec le mal qui le menace lui-même, et avec celui qu’il cause à ses
semblables, ne sera plus la victime que des remords justes ; et là où ses
penchans sont opposés aux principes d’une morale épurée, il trouvera
dans ceux-ci un guide sûr, un régulateur de ses actions; car il n’y a
personne qui ne se croye obligé de faire le bien et d’éviter le mal • seul
but et principe du sens moral inhérent à notre nature.
Dois-je encore faire observer que la conscience artificielle devient
d autant plus indispensable, qu’un individu est plus disposé à faire le
mal; et que c’est contre les dispositions mauvaises en particulier que
tous les efforts de l ’instruction morale doivent être dirigés? ’ ’
Il suit de tout ce que je viens de dire sur la conscience, qu’elle ne peut
nullement être considérée comme qualité fondamentale; qu’elle n’est
réellement qu’une affection du sens moral ou de la bienveillance et
que par conséquent aucun organe particulier ne peut lui être affecté.
Siégé et apparence extérieure de l ’organe de la
bienveillance.
Nous avons vu les organes qui sont placés sous la partie antérieure-
inféneure, et antérieure-supérieure de l ’os frontal. Nous arrivons à
présent aux organes qui ont leur siège sous la partie supérieure de l’os
frontal. Cette partie supérieure de l ’os frontal se divise encore, sous le
rapport de l’organologie, en sa partie superieure-antérieure, et en sa
partie supérieure-postérieure. Ces deux parties sont couvertes de cheveux
pour peu que le sujet soit chevelu.
Contre chacune de ces deux moitiés, se rencontrent, dans la ligne
I V ’ 2 8