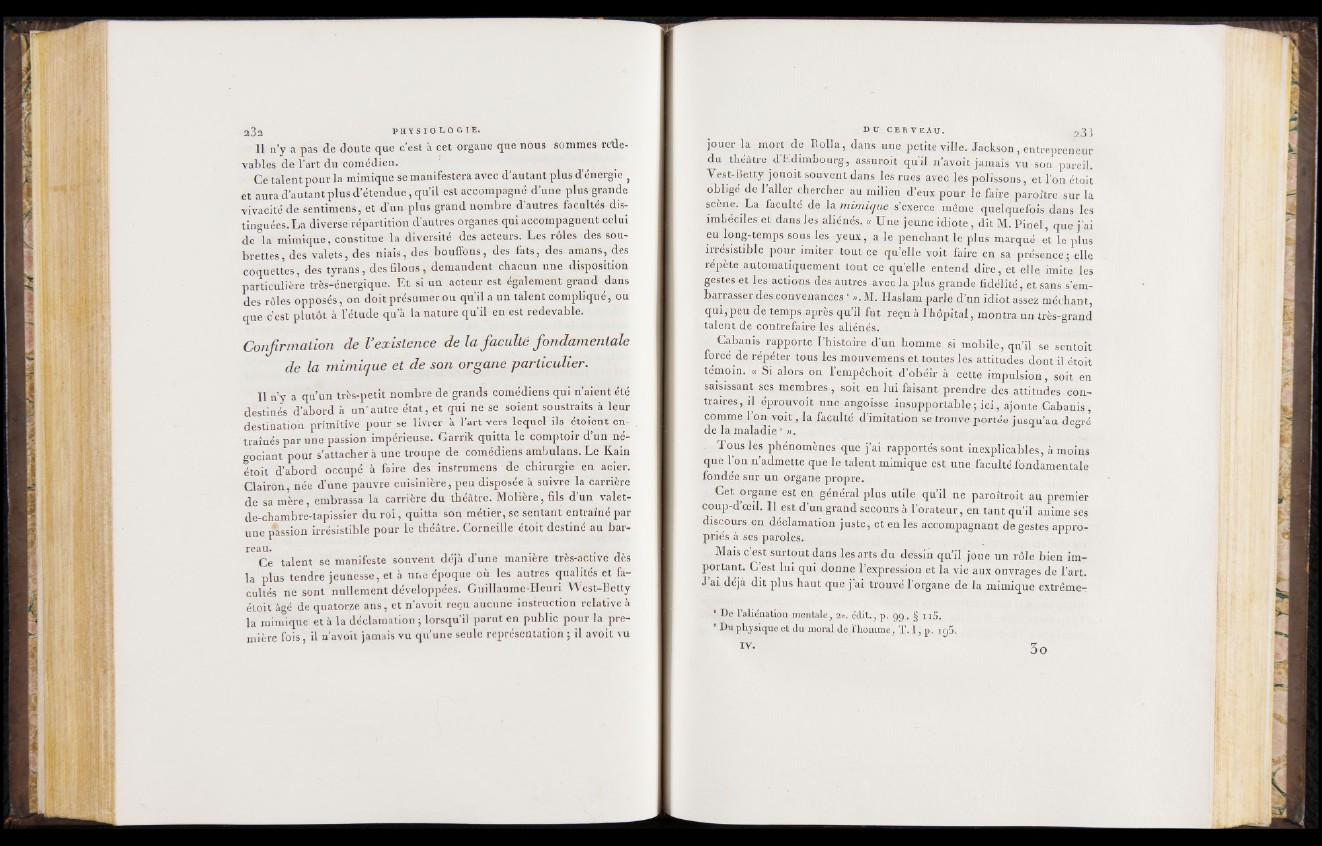
Il n’y a pas de doute que c’est à cet organe que nous sommes redevables
de l’art du comédien. ^ ^
Ce talent pour la mimique se manifestera avec d’autant plus d’énergie f
et aura d’autant plus d’étendue, qu’il est accompagné d’une plus grande
vivacité de sentimens, et d’un plus grand nombre d autres facultés distinguées.
La diverse répartition d'autres organes qui accompagnent celui
de la mimique, constitue la diversité des acteurs. Les rôles des soubrettes,
des valets, des niais, des bouffons, des fats, des amans, des
coquettes, des tyrans, des filous, demandent chacun une disposition
particulière très-énergique. Et si un acteur est egalement grand dans
des rôles opposés, on doit présumerou qu’il a un talent compliqué, ou
que c’est plutôt à l’étude qu’à la nature qu’il en est redevable.
Confirmation de l’existence de la faculté fondamentale
de la mimique et de son organe particulier.
Il n’y a qu’un très-petit nombre de grands comédiens qui n’aient été
destinés d’abord à un'autre état, et qui ne se soient soustraits à leur
destination primitive pour se livrer à l’art vers lequel ils étoient entraînés
par une passion impérieuse. Garrik quitta le comptoir d’un négociant
pour s’attacher à une troupe de comédiens ambulans. Le Kain
étoil d’abord occupé à faire des instrumens de chirurgie en acier.
Clairon, née d’une pauvre cuisinière, peu disposée à suivre la carrière
de sa mère, embrassa la carrière du théâtre. Molière, fils d’un valet-
de-cbambre-tapissier du roi, quitta son métier, se sentant entraîné par
une plssion irrésistible pour le théâtre. Corneille étoit destiné au barr
e a U * • N - I V Ce talent se manifeste souvent déjà d’une manière très-active dès
la plus tendre jeunesse,et à une époque où les autres qualités et facultés
ne sont nullement développées. Guillaume-Henri West-Betty
étoit âgé de quatorze ans, et n’avoit reçu aucune instruction relative à
la mimique et à la déclamation ; lorsqu'il parut en public pour la première
fois, il n’avoit jamais vu qu’une seule représentation ; il avoit vu
jouer la mort de Rolla, dans une petite ville. Jackson, entrepreneur
du théâtre d Edimbourg, assurait qu’il n’avoit jamais vu son pareil.
Vest-Betty jouoit souvent dans les rues avec les polissons, et l’on étoit
obhgé de 1 aller chercher au milieu d’eux pour le faire paraître sur la
scène. La faculté de la mimique,s’exerce même quelquefois dans les
imbéciles et dans les aliénés, « Une jeune idiote , dit M. Pinel, que j'ai
eu long-temps sous les yeux, a le penchant le plus marqué et le plus
irrésistible pour imiter tout ce quelle voit faire en sa présence ; elle
répète automatiquement tout ce quelle entend dire, et elle imite les
gestes et les actions des autres avec la plus grande fidélité, et sans s’embarrasser
des convenances 1 ».M. Haslam parle d’un idiot assez méchant,
qui,peu de temps après qu’il fut reçu à l ’hôpital, montra un très-grand
talent de contrefaire les aliénés.
Cabanis rapporte l ’histoire d’un homme si mobile, qu’il se sentoit
forcé de répéter tous les mouvemens et toutes les attitudes dont il étoit
témoin. « Si alors on l’empêchoit d’obéir à cette impulsion, soit en
saisissant ses membres, soit en lui faisant prendre des attitudes contraires,
il éprouvoit une angoisse insupportable ; ic i, ajoute Cabanis,
comme l’on voit, la faculté d’imitation se trouve portée jusqu’au degré
de la maladie * », j ,a , 1' .’” :'^ ■ '.* T
Tous les phénomènes que j’ai rapportés sont inexplicables, à moins
que l’on n’admette que le talent mimique est une faculté fondamentale
fondée sur un organe propre.
Cet organe est en général plus utile qu’il ne paraîtrait au premier
coup-d’oeil. II est d’un grand secours à l’orateur, en tant qu’il anime ses
discours en déclamation juste, et en les accompagnant de gestes appropriés
à ses paroles.
Mais c est surtout dans les arts du dessin qu’il joue un rôle bien important.
C’est lui qui donne l’expression et la vie aux ouvrages de l’art.
J ai déjà dit plus haut que j’ai trouvé l ’organe de la mimique extréme-r
1 De l ’alienation mentale, 2». éd it.,p . 99, § n 5 .
* Du physique et (lu moral de l’homme, T. I , p. rg5.
XV. 3o