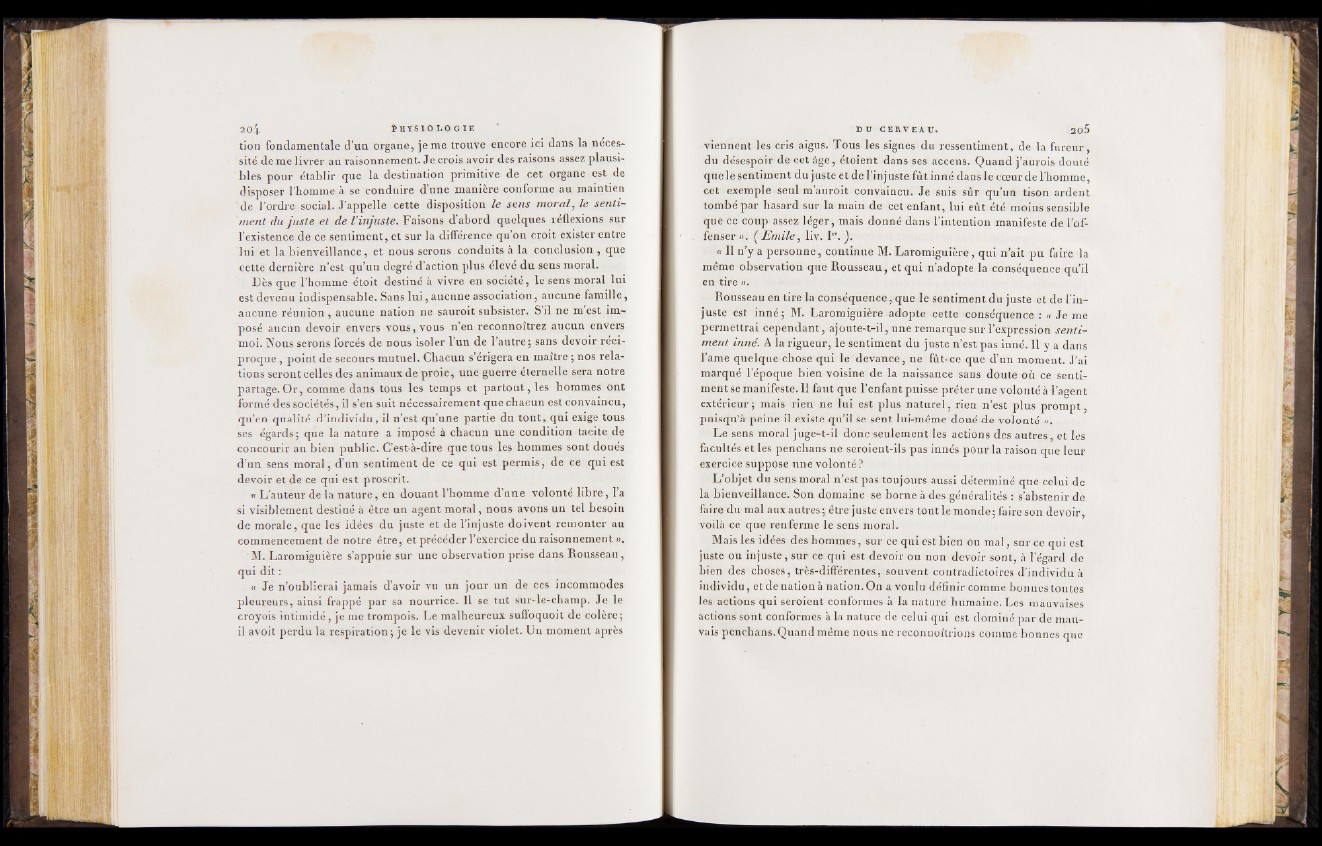
tion fondamentale d’un organe, je me trouve encore ici dans la nécessité
de me livrer au raisonnement. Je crois avoir des raisons assez plausibles
pour établir que la destination primitive de cet organe est de
disposer l’homme à se conduire d’nne manière conforme au maintien
de l ’ordre social. J’appelle cette disposition le sens moral, le sentiment
du juste et de l ’injuste. Faisons d’abord quelques réflexions sur
l’existence de ce sentiment, et sur la différence qu’on croit exister entre
lui et la bienveillance, et nous serons conduits à la conclusion , que
cette dernière n’est qu’un degré d’action plus élevé du sens moral.
Dès que l ’homme étoit destiné à vivre en société, le sens moral lui
est devenu indispensable. Sans lui, aucune association, aucune famille,
aucune réunion , aucune nation ne sauroit subsister. S’il ne m’est imposé
aucun devoir envers vous, vous n’en reconnoîtrez aucun envers
moi. Nous serons forcés de nous isoler l’un de l’autre; sans devoir réciproque
, point de secours mutuel. Chacun s’érigera en maître ; nos relations
seront celles des animaux de proie, une guerre éternelle sera notre
partage.Or, comme dans tous les temps et partout, les hommes ont
formé des sociétés, il s’en suit nécessairement que chacun est convaincu,
qu’en qualité d’individu, il n’est qu’une partie du tout, qui exige tous
ses égards; que la nature a imposé à chacun une condition tacite de
concourir au bien public. C’est-à-dire que tous les hommes sont doues
d’un sens moral, d’un sentiment de ce qui est permis, de ce qui est
devoir et de ce qui est proscrit.
« L ’auteur de la nature, en douant l’homme dune volonté libre, la
si visiblement destiné à être un agent moral, nous avons un tel besoin
de morale, que les idées du juste et de l’injuste doivent remonter au
commencement de notre être, et précéder l’exercice du raisonnement».
M. Laromiguière s’appuie sur une observation prise dans Rousseau,
qui dit :
« Je n’oublierai jamais d’avoir vu un jour un de ces incommodes
pleureurs, ainsi frappé par sa nourrice. 11 se tut sur-le-champ. Je le
croyois intimidé, je me trompois. Le malheureux suffoquoit de colère ;
il avoit perdu la respiration ; je le vis devenir violet. Un moment après
viennent les cris aigus. Tous les signes du ressentiment, de la fureur,
du désespoir de cet âge, étoient dans ses accens. Quand j’aurois douté
que le sentiment du j uste et de l’injuste fût inné dans le coeur de l’homme,
cet exemple seul m’auroit convaincu. Je suis sûr qu’un tison ardent
tombé par hasard sur la main de cet enfant, lui eût été moins sensible
que ce coup assez léger, mais donné dans l’intention manifeste de l’offenser
». ( Emile, liv. I". J.
« Il n’y a personne, continue M. Laromiguière, qui n’ait pu faire la
même observation que Rousseau, et qui n’adopte la conséquence qu’il
en tire ».
Rousseau en tire la conséquence, que le sentiment du juste et de l’injuste
est inné ; M. Laromiguière adopte cette conséquence : « Je me
permettrai cependant, ajoute-t-il, une remarque sur l’expression sentiment
inné. A la rigueur, le sentiment du juste n’est pas inné. Il y a dans
l’ame quelque chose qui le devance, ne fût-ce que d’un moment. J’ai
marqué l’époque bien voisine de la naissance sans doute où ce sentiment
se manifeste. 11 faut que l’enfant puisse prêter une volonté à l ’agent
extérieur; mais rien ne lui est plus naturel, rien n’est plus prompt,
puisqu'à peine il existe qu’il se sent lui-même doué de volonté »..
Le sens moral juge-t-il doncseulement les actions des autres, et les
facultés et les penchans ne seroient-ils pas innés pour la raison que leur
exercice suppose une volonté ?
L ’objet du sens moral n’est pas toujours aussi déterminé que celui de
la bienveillance. Son domaine se borne à des généralités : s’abstenir de
faire du mal auxautres; être juste envers tout lemonde; faire son devoir,
voilà ce que renferme le sens moral.
Mais les idées des hommes, sur ce qui est bien ou mal, sur ce qui est
juste ou injuste, sur ce qui est devoir ou non devoir sont, à l’égard de
bien des choses, très-différentes, souvent contradictoires d’individu à
individu, et de nation à nation. On a voulu définir comme bonnes toutes
les actions qui seroient conformes à la nature humaine. Les mauvaises
actions sont conformes à la nature de celui qui est dominé par de mauvais
penchans. Quand même nous ne reconnoîtrions comme bonnes que