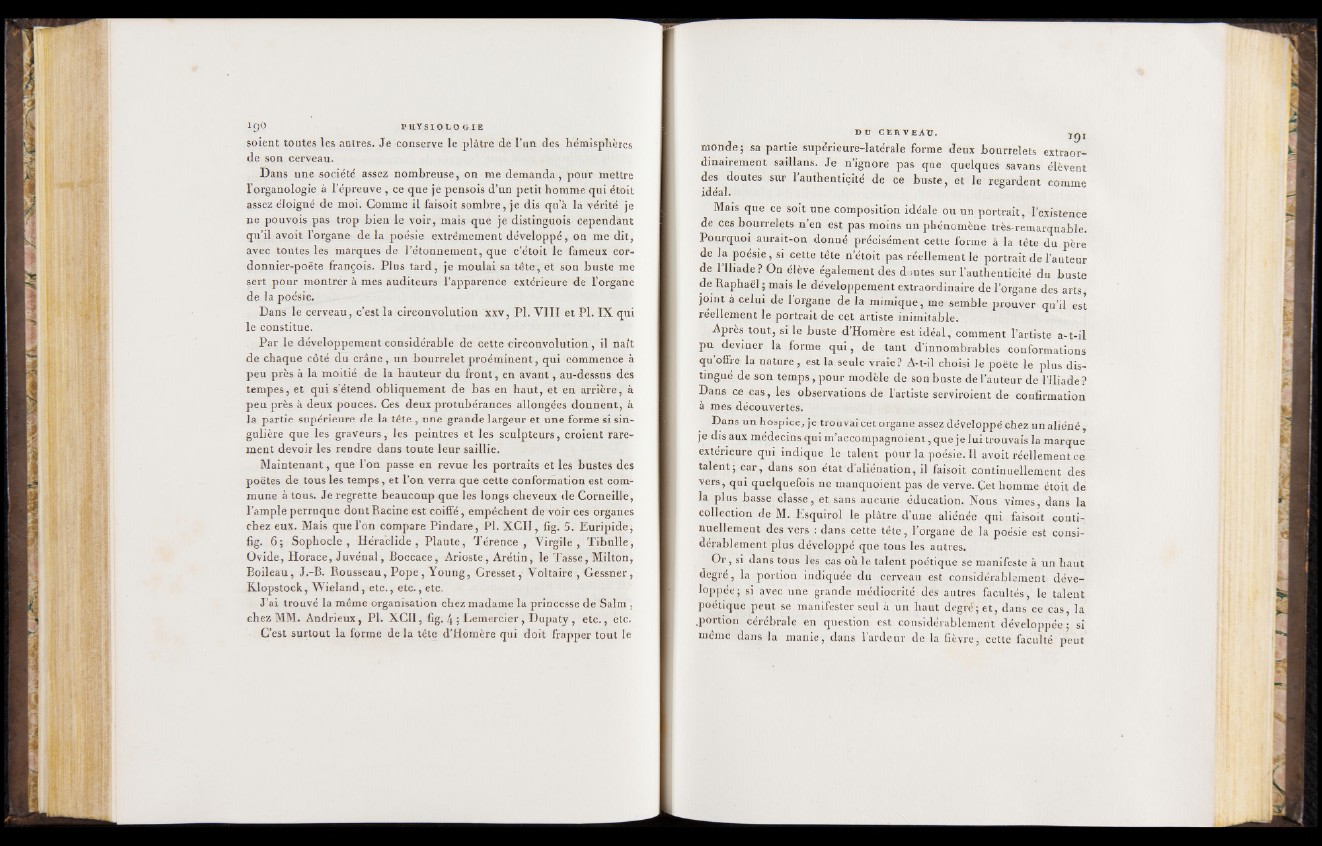
3 I gO P H Y S I O L O G I E
soient toutes les autres. Je conserve le plâtre de l ’un des hémisphères
de son cerveau.
Dans une société assez nombreuse, on me demanda, pour mettre
l’organologie à l’épreuve , ce que je pensois d’un petit homme qui étoit
assez éloigné de moi. Gomme il faisoit sombre, je dis qu’à la vérité je
ne pouvois pas trop bien le voir, mais que je distioguois cependant
qu’il avoit l’organe de la poésie extrêmement développé, on me dit,
avec toutes les marques de l’étonnement, que c’étoit le fameux cor-
donnier-poëte françois. Plus tard, je moulai sa tête, et son buste me
sert pour montrer à mes auditeurs l’apparence extérieure de l’organe
de la poésie.
Dans le cerveau, c’est la circonvolution xxv, PI. VIII et PI. IX qui
le constitue.
Par le développement considérable de cette circonvolution, il naît
de chaque côté du crâne, un bourrelet proéminent, qui commence à
peu près à la moitié de la hauteur du front, en avant, au-dessus des
tempes, et qui s’étend obliquement de bas en haut, et en arrière, à
peu près à deux pouces. Ces deux protubérances allongées donnent, à
la partie supérieure de la tête , une grande largeur et une forme si singulière
que les graveurs, les peintres et les sculpteurs, croient rarement
devoir les rendre dans toute leur saillie.
Maintenant, que l’on passe en revue les portraits et les bustes des
poètes de tous les temps, et l’on verra que cette conformation est commune
à tous. Je regrette beaucoup que les longs cheveux de Corneille,
l ’ample perruque dont Racine est coiffé, empêchent de voir ces organes
chez eux. Mais que l’on compare Pindare, PI. XCII, fig. 5. Euripide;
fig. 6; Sophocle, Héra'clide , Plaute, Térence , Virgile, Tibulle,
Ovide, Horace, Juvénal, Boccace, Arioste, Arétin, le Tasse, Milton,
Boileau, J.-B. Rousseau, Pope, Young, Gresset,- Voltaire , Gessner,
Klopstock, "Wieland, etc., etc., etc.
J’ai trouvé la même organisation chez madame la princesse de Salm ,
chez MM. Andrieux, PI. XCII, fig. 4 ; Lemercier, Dupaty , etc., etc.
C’est surtout la forme de la tête d’Homère qui doit frapper tout le
monde; sa partie supérieure-latérale forme deux bourrelets extraordinairement
saillans. Je n’ignore pas que quelques savans élèvent
des doutes sur 1 authenticité de ce buste, et le regardent comme
idéal.
Mais que ce soit une composition idéale ou un portrait, l ’existence
de ces bourrelets n’en est pas moins un phénomène très-remarquable.
Pourquoi aurait-on donné précisément cette forme à la tête du père
de la poésie, si cette tête n’étoit pas réellement le portrait de l’auteur
de l ’Iliade? On élève également des duutes sur l’authenticité du buste
de Raphaël ; mais le développement extraordinaire de l ’organe des arts
joint à celui de l’organe de la mimique, me semble prouver qu’il est
réellement le portrait de cet artiste inimitable.
Après tout, si le buste d’Homère est idéal, comment l’artiste a-t-il
pu deviner la forme q u i, de tant d’innombrables conformations
qu’offre la nature, est la seule vraie? A-t-il choisi le poète le plus distingué
de son temps, pour modèle de son buste de l’auteur de l’Iliade?
Dans ce cas, les observations de l ’artiste serviroient de confirmation
à mes découvertes.
Dans un hospice, je trouvai cet organe assez développé chez un aliéné,
je dis aux médecins qui m’accompagnoient, que je lui trouvais la marque
extérieure qui indique le talent pour la poésie. Il avoit réellement ce
talent; car, dans son état d’aliénation, il faisoit continuellement des
vers, qui quelquefois ne manquoient pas de verve. Çet homme étoit de
la plus basse classe, et sans aucune éducation. Nous vîmes, dans la
collection de M. Esquirol le plâtre d’une aliénée qui faisoit continuellement
des vers : dans cette tête, l’organe de la poésie est considérablement
plus développé que tous les autres.
Or, si dans tous les cas où le talent poétique se manifeste à un haut
degre, la portion indiquée du cerveau est considérablement développée;
si avec une grande médiocrité des autres facultés, le talent
poétique peut se manifester seul à un haut degré; et, dans ce cas la
.portion cérébrale en question est considérablement développée ; si
même dans la manie, dans 1 ardeur de la fièvre, cette faculté peut