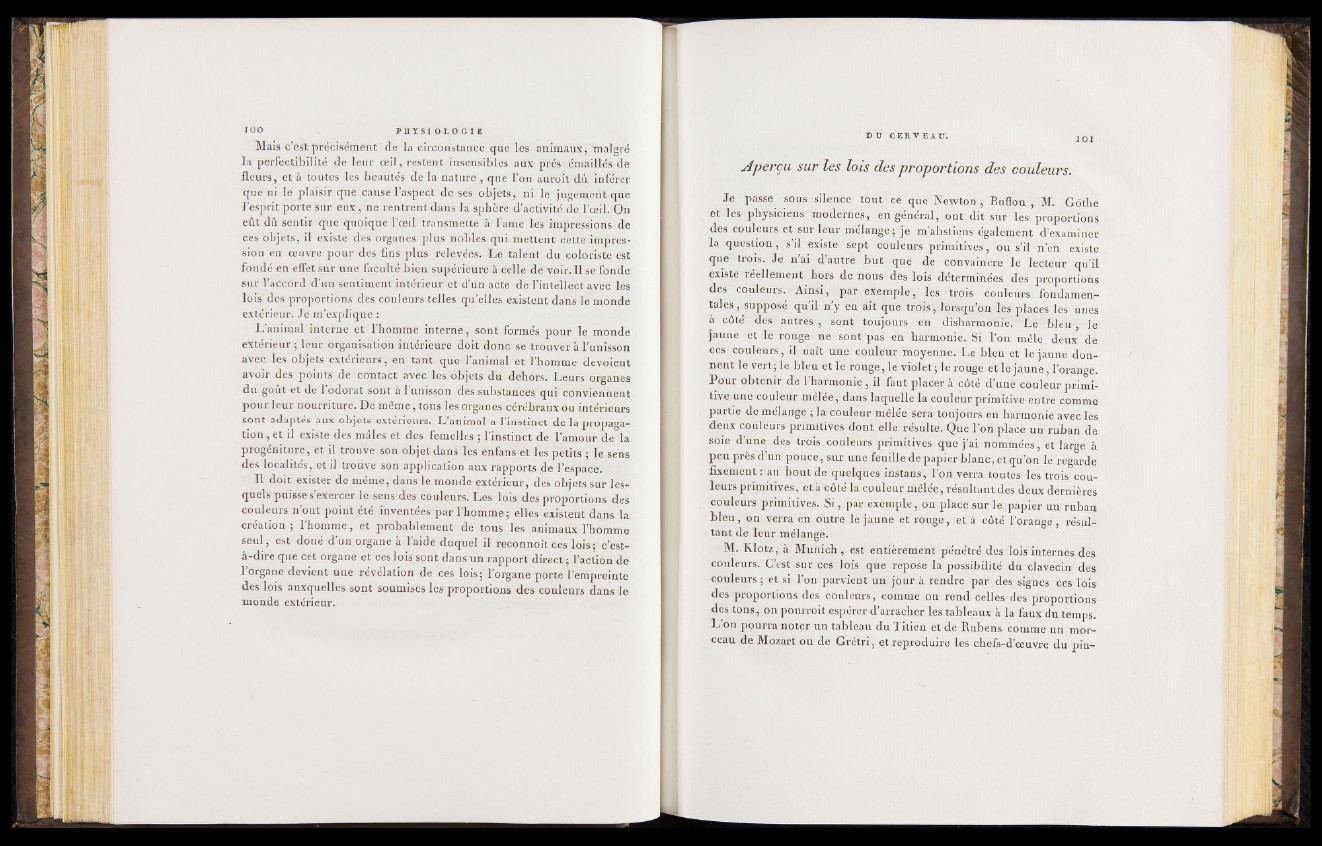
100 P 1IYS I O L O G I E
Mais c’est précisément de la circonstance que les animaux, malgré
la perfectibilité de leur oeil, restent insensibles aux prés .émaillés de
fleurs, et à toutes les beautés de la nature , que l’on auroit dû inférer
que ni le plaisir que cause l’aspect de ses objets, ni le jugement que
l ’esprit porte sur eux, ne rentrent dans la sphère d’activité de l’oeil. On
eût dû sentir que quoique l’oeil transmette à lame les impressions de
ces objets, il existe des organes plus nobles qui mettent cette impression
en oeuvre pour des fins plus relevées. Le talent du coloriste est
fondé en effet sur une faculté bien supérieure à celle de voir. Il se fonde
sur l’accord d’un sentiment intérieur et d’un acte de l’intellect avec les
lois des proportions des couleurs telles qu’elles existent dans le monde
extérieur. Je m’explique :
L ’animal interne et l’homme interne, sont formés pour le monde
extérieur ; leur organisation intérieure doit donc se trouver à l’unisson
avec les objets extérieurs, en tant que l’animal et l’homme dévoient
avoir des points de contact avec les objets du dehors. Leurs organes
du goût et de 1 odorat sont à 1 unisson des substances qui conviennent
pour leur nourriture. De même, tous les organes cérébraux ou intérieurs
sont adaptés aux objets extérieurs. L ’animal a l’instinct de la propagation
, et il existe des mâles et des femelles ; l’instinct de l’amour de la
progéniture, et il trouve son objet dans les enfans et les petits ; le sens
des localités, et il trouve son application aux rapports de l’eSpace.
Il doit exister de même, dans le monde extérieur, des objets sur lesquels
puisse s’exercer le sens des couleurs. Les lois des proportions dès
couleurs n’ont point été inventées par l’homme; elles existent dans la
création ; l ’homme, et probablement de tous les animaux l’homme
seul, est doué d’un organe à l’aide duquel il reconnoit ces lois; c’est-
à-dire que cet organe et ces lois sont dans un rapport direct ; l’action de
l’organe devient une révélation de ces lois; l’organe porte l’empreinte
des lois auxquelles sont soumises les proportions des couleurs dans le
monde extérieur.
Aperçu sur les lois des proportions des couleurs.
Je passe sous silence tout ce que Newton , Buffon , M. Gôthe
et les physiciens modernes, en général, ont dit sur les proportions
des couleurs et sur leur mélange; je m’abstiens également d’examiner
la question, s il existe sept couleurs primitives, ou s’il n’en existe
que trois. Je n ai d autre but que de convaincre le lecteur qu’il
existe réellement hors de nous des lois déterminées des proportions
des couleurs.. Ainsi, par exemple, les trois couleurs fondamentales,
supposé qu’il n’y en ait que trois, lorsqu’on les places les unes
à côté des autres , sont toujours en disharmonie. Le b leu , le
jaune et le rouge ne sont pas en harmonie. Si l’on mêle deux de
ces couleurs, il naît une couleur moyenne. Le bleu et le jaune donnent
le vert; le bleu et le rouge, le violet ; le rouge et le jaune, l’orange.
Pour obtenir de l’harmonie, il faut placera côté d’une couleur primitive
une couleur mêlée, dans laquelle la couleur primitive entre comme
partie de mélange ; la couleur mêlée sera toujours en harmonie avec les
deux couleurs primitives dont elle résulte. Que l ’on place un ruban de
soie d’une des trois couleurs primitives que j’ai nommées, et large à
peu près d’un pouce, sur une feuille de papier blanc, et qu’on le regarde
fixement : au bout de quelques instans, l ’on verra toutes les trois couleurs
primitives, et à côté la couleur mêlée, résultant des deux dernières
couleurs primitives. S i , par exemple, on place sur le papier un ruban
bleu, on verra en outre le jaune et rouge, et à côté l ’orange, résultant
de leur mélange.
M. Klotz, à Munich, est entièrement pénétré des lois internes des
couleurs. C’est sur ces lois que repose la possibilité du clavecin des
couleurs; et si l’on parvient un jour à rendre par des signes ces lois
des proportions des couleurs, comme on rend celles des proportions
des tons, on pourroit espérer d’arracher les tableaux à la faux du temps.
L ’on pourra noter un tableau du Titien et de Rubens comme un morceau
de Mozart ou de Grétri, et reproduire les chefs-d’oeuvre du pin