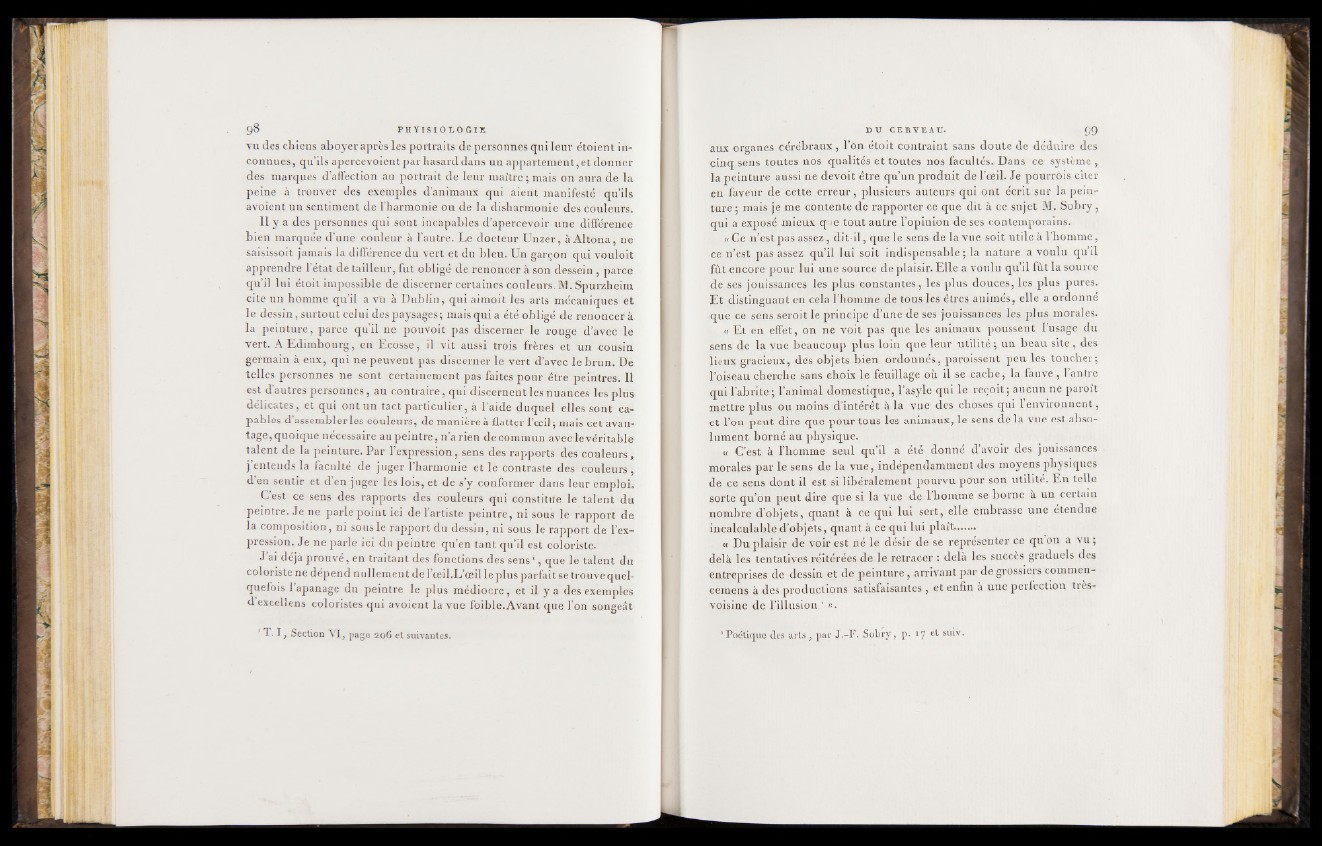
vu des chiens aboyer après les portraits de personnes qui leur e'toient inconnues,
qu’ils apercevoient par hasard dans un appartement, et donner
des marques d’affection au portrait de leur maître ; mais on aura de la
peine à trouver des exemples d’animaux qui aient manifesté qu’ils
avoient un sentiment de l’harmonie ou de la disharmonie des couleurs.
Il y a des personnes qui sont incapables d’apercevoir une différence
bien marquée d’une couleur à l’autre. Le docteur Unzer, à Altona, ne
saisissoit jamais la différence du vert et du bleu. Un garçon qui vouloit
apprendre 1 état de tailleur, fut obligé de renoncer à son dessein , parce
qu’il lui étoit impossible de discerner certaines couleurs. M. Spurzheim
cite un homme qu’il a vü à Dublin, qui aimoit les arts mécaniques et
le dessin, surtout celui des paysages; mais qui a été obligé de renoncer à
la peinture, parce qu’il ne pouvoit pas discerner le rouge d’avec le
vert. A Edimbourg, en Ecosse, il vit aussi trois frères et un cousin
germain à eux, qui ne peuvent pas discerner le vert d’avec le brun. De
telles personnes ne sont certainement pas faites pour être peintres. Il
est d’autres personnes, au contraire, qui discernent les nuances les plus
délicates, et qui ont un tact particulier, à l ’aide duquel elles sont capables
d’assembler les couleurs, de manière à flatter l’oeil; mais cet avan-
ta§e> quoique nécessaire au peintre, n’a rien de commun avec le véritable
talent de la peinture. Par l’expression, sens des rapports des couleurs,
j’enteuds la faculté de juger l’harmonie et le contraste des couleurs,
d’en sentir et d’en juger les lois, et de s’y conformer dans leur emploi.
C’est ce sens des rapports des couleurs qui constitue, le talent du
peintre. Je ne parle point ici de l’artiste peintre, ni sous le rapport de
la composition, ni sous le rapport du dessin, ni sous le rapport de l’expression.
Je ne parle ici du peintre qu’en tant qu’il est coloriste.
J ai déjà prouvé, en traitant des fonctions des sens1, que le talent du
coloriste ne dépend nullement de l’oeil.L’ceil le plus parfait se trouve quelquefois
1 apanage du peintre le plus médiocre, et il y a des exemples
dexcellens coloristes qui avoient la vue foible. Avant que l’on songeât
1 T . I , Section Y I , page 206 et suivantes.
aux organes cérébraux, l’on étoit contraint sans doute de déduire des
cinq sens toutes nos qualités et toutes nos facultés. Dans ce système ,
la peinture aussi ne devoit être qu’un produit de l’oeil. Je pourrois citer
en faveur de cette erreur, plusieurs auteurs qui ont écrit sur la peinture
; mais je me contente de rapporter ce que dit à ce sujet M. Sobry,
qui a exposé mieux q ie tout autre l’opinion de ses contemporains.
« Ce n’est pas assez, dit-il, que le sens de la vue soit utile à l ’homme,
ce n’est pas assez qu’il lui soit indispensable ; la nature a voulu qu’il
fût encore pour lui une source de plaisir. Elle a voulu qu’il fut la source
de ses jouissances les plus constantes, les plus douces, les.plus pures.
Et distinguant en cela l’homme de tous les êtres animés, elle a ordonne
que ce sens seroit le principe d’une de ses jouissances les plus morales.
. « Et en effet, on ne voit pas que les animaux poussent l’usage du
sens de la vue beaucoup plus loin que leur utilité ; un beau site , des
lieux gracieux, des objets bien ordonnés, paroissent peu les toucher;
l ’oiseau cherche sans choix le feuillage où il se cache, la fauve , l’antre
qui l ’abrite; l’animal domestique, l’asyle qui le reçoit; aucun ne paroît
mettre plus ou moins d’intérêt à la vue des choses qui 1 environnent,
et l’on peut dire que pour tous les animaux, le sens de la vue est absolument
borné au physique.
« C’est à l’homme seul qu’il a été donné d’avoir des jouissances
morales par le sens de la vue, indépendamment des moyens physiques
de ce sens dont il est si libéralement pourvu pour son utilité. En telle
sorte qu’on peut dire que si la vue de l’homme se borne à un certain
nombre d’objets, quant à ce qui lui sert, elle embrasse une etendue
incalculable d’objets, quant à ce qui lui plaît......
« Du plaisir de voir est né le désir de se représenter ce qu on a vu ;
delà les tentatives réitérées de le retracer : delà les succès graduels des
entreprises de dessin et de peinture, arrivant par de grossiers commen-
cemens à des productions satisfaisantes , et enfin à une perfection très-
voisine de l’illusion 1 ».
* Poétique des arts ; par J.-F. Sobry, p. 17 et suiv.