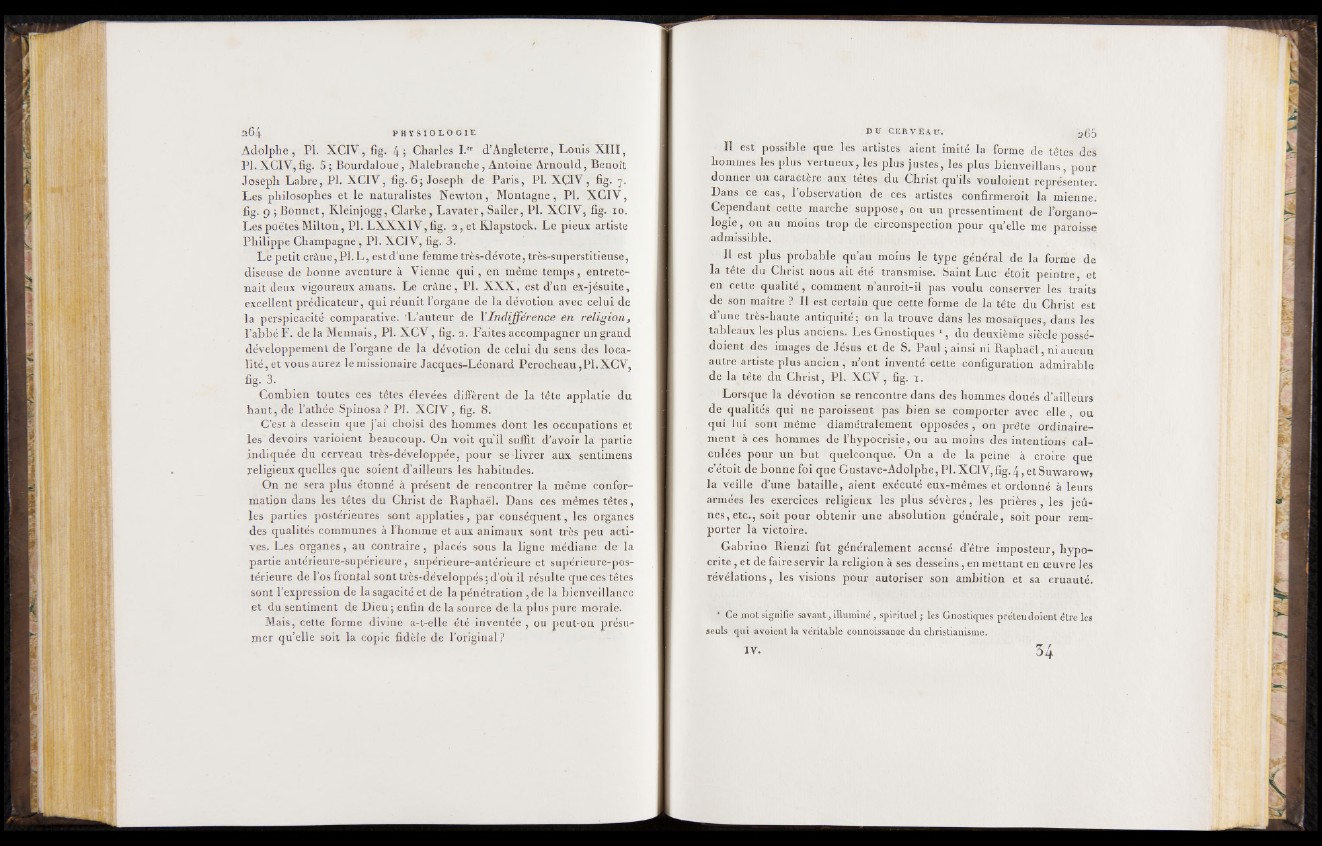
Adolphe, PI. XCIV, fig. 4 ; Charles I.er d’Angleterre, Louis X III,
Pl.XCIV,fig. 5 ; Bourdaloue, Malebranche, Antoine Arnould, Benoît
Joseph Labre, Ph XCIY, fig. 6; Joseph de Paris, PL XCIV , fig. 7.
Les philosophes et le naturalistes Newton, Montagne, PL X C IY ,
fig. g ; Bonnet, Klèinjogg, Clarke , Lavater, Sailer, Pl. XCIV, fig. 10.
Les poètes Milton, PL LXXXIV,fig. 2, et Klapstock. Le pieux artiste
Philippe Champagne, PL XCIV, fig. 3.
Lë petit crâne, PL L, est d’une femme très-dévote, très-superstitieuse,
diseuse de bonne aventure à Vienne q u i, en même temps, entretenait
deux vigoureux amans. Le crâne, Pl. X X X , est d’un ex-jésuite,
excellent prédicateur, qui réunit l’organe de la dévotion avec celui de
la perspicacité comparative. L ’auteur de l ’Indifférence en religion,
l ’abbé F. de la Mennais, PL X C V , fig. 2. Faites accompagner un grand
développement de l’organe de la dévotion de celui du sens des localité,
et vous aurez lemissionaire Jacques-Léonard Perocheau,Pl.XGV,
fig. 3.
Combien toutes ces têtes élevées diffèrent de la tête applatie du
haut, de l’athée Spinosa ? Pl. XCIV, fig. 8.
C’est à dessein que j’ai choisi des hommes dont les occupations et
les devoirs varioient beaucoup. On voit qu’il suffit d’avoir la partie
indiquée du cerveau très-développée, pour se-livrer aux sentimens
religieux quelles que soient d’ailleurs les habitudes.
On ne sera plus'étonné à présent de rencontrer la même conformation
dans les têtes du Christ de Raphaël. Dans ces mêmes têtes,
les parties postérieures sont applaties, par conséquent, les organes
des qualités communes à l’homme et aux animaux sont très peu actives.
Les organes, au contraire , placés sous la ligne médiane de la
partie antérieure-supérieure, supérieure-antérieure et supérieure-postérieure
de l’os frontal sont très-développés ; d'où il résulte que ces têtes
sont l’expression de la sagacité et de la pénétration ,de la bienveillance
et du sentiment de Dieu; enfin de la source de la plus pure morale.
Mais, cette forme divine a-t-elle été inventée , ou peut-on présu-
jner qu’elle soit la copie fidèle de l’original?
Il est possible que les artistes aient imité la forme de têtes des
hommes les plus vertueux, les plus justes, les plus bienveillans, pour
donner un caractère aux têtes du Christ qu’ils vouloient représenter.
Dans ce cas, l’observation de ces artistes confirmeroit la mienne.
Cependant cette marche suppose, ou un pressentiment de l’organologie,
ou au moins trop de circonspection pour qu’elle me paroisse
admissible.
11 est plus probable qu’au moins le type général de la forme de
la tête du Christ nous ait été transmise. Saint Luc étoit peintre, et
en cette qualité , comment n’auroit-il pas voulu conserver les traits
de son maître ? Il est certain que cette forme de la tête du Christ est
d une très-haute antiquité ; on la trouve dans les mosaïques, dans les
tableaux les plus anciens. Les Gnostiques 1, du deuxième siècle possé-
doient des images de Jésus et de S. Paul ; ainsi ni Raphaël, ni aucun
autre artiste plus ancien, n’ont inventé cette configuration admirable
de la tête du Christ, Pl. X C V , fig. 1.
Lorsque la dévotion se rencontre dans des hommes doués d’ailleurs
de qualités qui ne paroissent pas bien se comporter avec elle , ou
qui lui sont même diamétralement opposées , on prête ordinairement
à ces hommes de l’hypocrisie, ou au moins des intentions calculées
pour un but quelconque. On a de la peine à croire que
c’étoit de bonne foi que Gustave-Adolphe, PL XCIV,fig. 4, elSuwarow»
la veille d’une bataille, aient exécuté eux-mêmes et ordonné à leurs
armées les exercices religieux les plus sévères, les prières, les jeûnes,
etc., soit pour obtenir une absolution générale, soit pour remporter
la victoire.
Gabrino Rienzi fut généralement accusé d’être imposteur, hypocrite
, et de faire servir la religion à ses desseins, en mettant en oeuvre les
révélations, les visions pour autoriser son ambition et sa cruauté.
‘ Ce mot signifie savant, illuminé, spirituel ; les Gnostiques prétendoient être les
seuls qui avoient la véritable connoissance du christianisme.
XV. 3 4