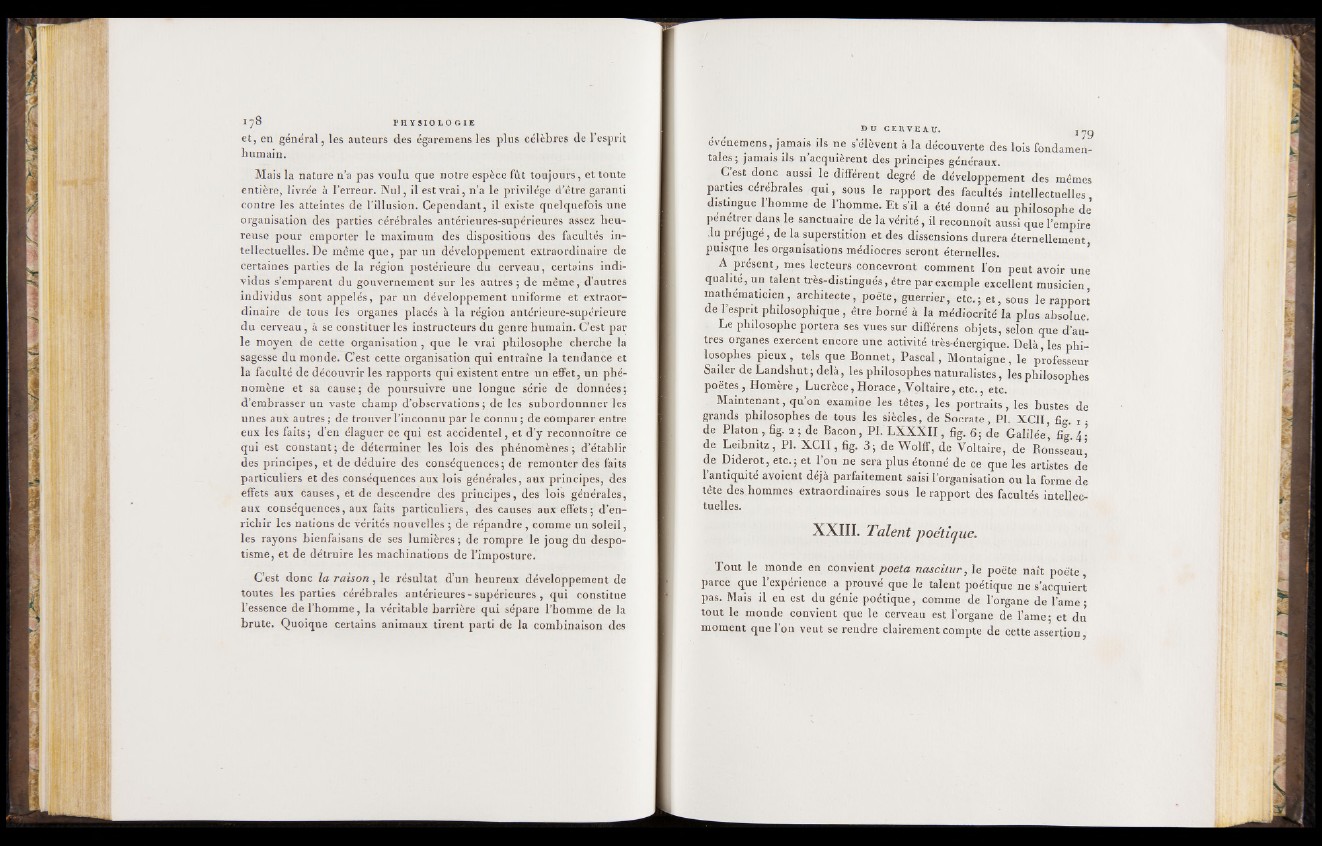
et, en général, les auteurs des égaremens les plus célèbres de l’esprit
humain.
Mais la nature n’a pas voulu que notre espèce fût toujours, et toute
entière, livrée à l ’erreur. Nul, il est vrai, n’a le privilège d’être garanti
contre les atteintes de l’illusion. Cependant, il existe quelquefois une
organisation des parties cérébrales antérieures-supérieures assez heureuse
pour emporter le maximum des dispositions des facultés intellectuelles.
De même que, par un développement extraordinaire de
certaines parties de la région postérieure du cerveau, certains individus
s’emparent du gouvernement sur les autres; de même, d’autres
individus sont appelés, par un développement uniforme et extraordinaire
de tous les organes placés à la région antérieure-supérieure
du cerveau, à se constituer les instructeurs du genve humain. C’est par
le moyen de cette organisation, que le vrai philosophe cherche la
sagesse du monde. C’est cette organisation qui entraîne la tendance et
la faculté de découvrir les rapports qui existent entre un effet, un phénomène
et sa cause; de poursuivre une longue série de données;
d’embrasser un vaste champ d’observations; de les subordonnner les
unes aux autres; de trouver l ’inconnu par le connu; de comparer entre
eux les faits; d’en élaguer ce qui est accidentel, et d’y reconnoître ce
qui est constant; de déterminer les lois des phénomènes; d’établir
des principes, et de déduire des conséquences; de remonter des faits
particuliers et des conséquences aux lois générales, aux principes, des
effets aux causes, et de descendre des principes, des lois générales,
aux conséquences, aux faits particuliers, des causes aux effets; d’enrichir
les nations de vérités nouvelles ; de répandre , comme un soleil,
les rayons bienfaisans de ses lumières ; de rompre le joug du despotisme,
et de détruire les machinations de l’imposture.
C’est donc la raison, le résultat d’un heureux développement de
toutes les parties cérébrales antérieures-supérieures, qui constitue
l’essence de l’homme, la véritable barrière qui sépare l’homme de la
brute. Quoique certains animaux tirent parti de la combinaison des
, D U C E R V E A U . 179
evenemens, jamais ils ne s’élèvent à la découverte des lois fondamentales;
jamais ils n’acquièrent des principes généraux.
C’est donc aussi le différent degré de développement des mêmes
parties cérébrales qui, sous le rapport des facultés intellectuelles
distingue l’homme de l’homme. Et s’il a été donné au philosophe de
penetrer dans le sanctuaire de la vérité, il reconnoît aussi que l’empire
:lu préjugé, de la superstition et des dissensions durera éternellement
puisque les organisations médiocres seront éternelles.
A présent, mes lecteurs concevront comment l’on peut avoir une
qualité, un talent très-distingués, être par exemple excellent musicien,
mathématicien, architecte, poète, guerrier, etc.; et, sous le rapport
deTesprit philosophique, être borné à la médiocrité la plus absolue.
Le philosophe portera ses vues sur différens objets, selon que d’autres
organes exercent encore une activité très-énergique. Delà, les philosophes
pieux, tels que Bonnet, Pascal, Montaigne, le professeur
Sailer de Landshut ; delà, les philosophes naturalistes, les philosophes
poètes , Homère, Lucrèce, Horace, Voltaire, etc., etc.
Maintenant, qu’on examine les têtes, les portraits, les bustes de
grands philosophes de tous les siècles, de Socrate, PI. XCII, fig. 1 ■
de Platon , fig. 2 ; de Bacon, PI. L X X X I I , fig. 6; de Galilée’ fig. i ■
de Leibnitz, PI. X C I I , fig. 3 ; de Wolff, de Voltaire, de Rousseau’
de Diderot, etc.; et 1 on ne sera plus étonné de ce que les artistes de
l’antiquité avoient déjà parfaitement saisi l’organisation ou la forme de
tête des^hommes extraordinaires sous le rapport des facultés intellectuelles.
XXIII. Talent poétique.
Tout le monde en convient poeta nascitur, le poète naît poé'te
parce que l’expérience a prouvé que le talent poétique ne s’acquiert
pas. Mais il en est du génie poétique, comme de l’organe de lame;
tout le monde convient que le cerveau est l’organe de l’ame- et du
moment que l ’on veut se rendre clairement compte de cette assertion,