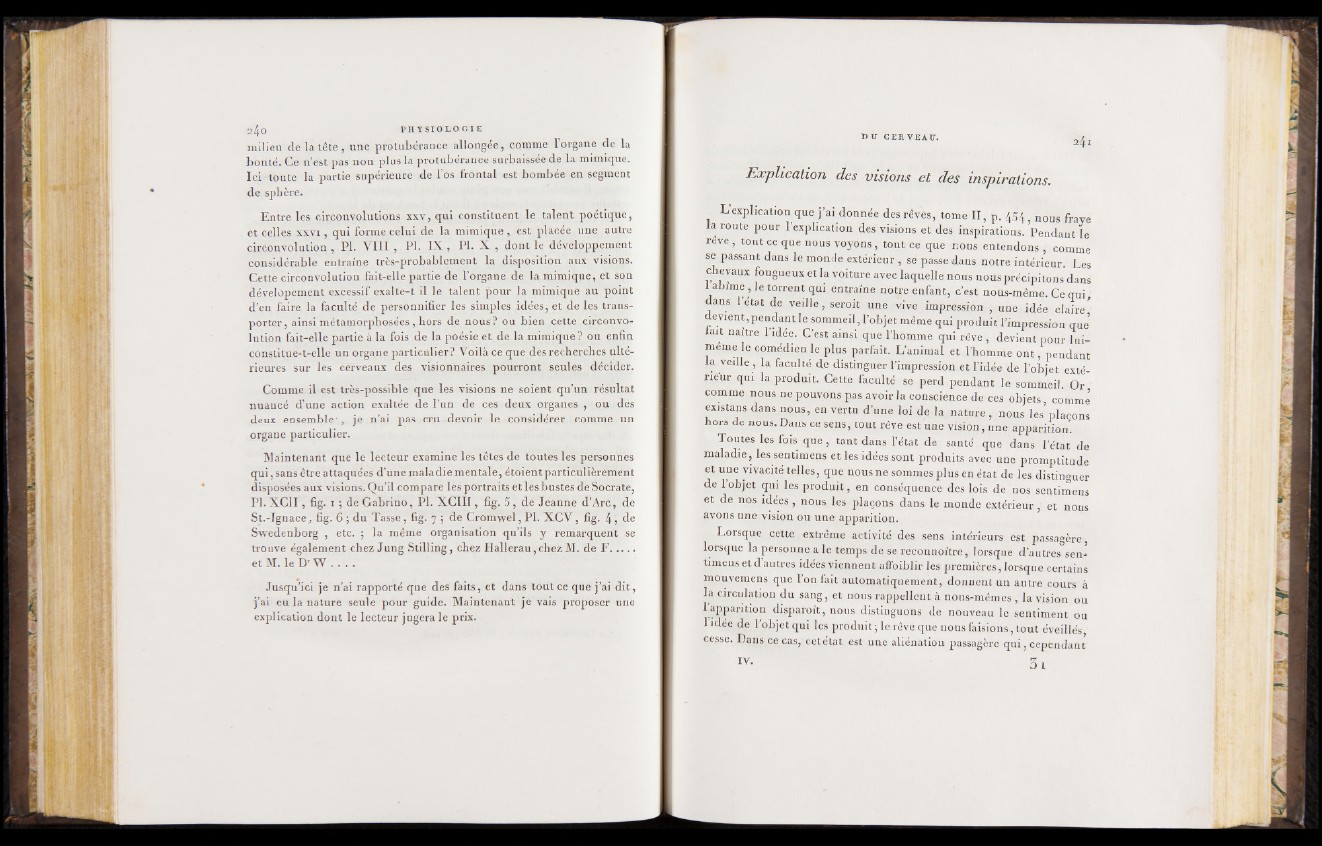
2 4 o P H Y S I O L O G I E
milieu de la tête , une protubérance allongée, comme l’organe de la
bonté. Ce n’est pas non plus la protubérance surbaissée de la mimique.
Ici toute la partie supérieure de l’os frontal est bombée en segment
de sphère.
Entre les circonvolutions x xv, qui constituent le talent poétique,
et celles x x v i, qui forme celui de la mimique , est placée une autre
circonvolution , PI. VIII , PI. IX , PL X , d ont le développement
considérable entraîne très-probablement la disposition aux visions.
Cette circonvolution fait-elle partie de l’organe de la mimique^ et son
dévelopement excessif exalte-t il le talent pour la mimique au point
d’en faire la faculté de personnifier les simples idées, et de les transporter,
ainsi métamorphosées, hors de nous ? ou bien cette circonvolution
fait-elle partie à la fois de la poésie et de la mimique? ou enfin
constitue-t-elle un organe particulier? Voilà ce que des recherches ultérieures
sur les cerveaux des visionnaires pourront seules décider.
Comme il est très-possible que les visions ne soient qu’un résultat
nuancé d’une action exaltée de l ’un de ces deux organes , ou des
deux ensemble-, je n’ai pas cru devoir le considérer comme un
organe particulier.
Maintenant que le lecteur examine les têtes de toutes les personnes
qui, sans être attaquées d’une maladie mentale, étoient particulièrement
disposées aux visions. Qu’il compare les portraits et les bustes de Socrate,
PL XC1I , fig. i ; de Gabrino, PL X C II I, fig. 5 , de Jeanne d’Arc, de
St.-Ignace^ fig. 6 ; du Tasse, fig. 7 ; de Cromwel, Pl. X C V , fig. 4 , de
Swedenborg , etc. ; la même organisation qu’ils y remarquent se
trouve également chez Jung Stilling, chez Hallerau,chez M. de F ........
et M. le D 'W ___
Jusqu’ici je n’ai rapporté que des faits, et dans tout ce que j’ai dit,
j’ai eu la nature seule pour guide. Maintenant je vais proposer une
explication dont le lecteur jugera le prix.
Explication des visions et des inspirations.
L explication que j’ai donnée des rêves, tome II, p. 454, nous fraye
la route pour l ’explication des visions et des inspirations. Pendant le
rêve, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons , comme
se passant dans le monde extérieur , se passe dans notre intérieur Les
chevaux fougueux et la voiture avec laquelle nous nous précipitons dans
i abîme , le torrent qui entraîne notre enfant, c’est nous-même. Ce qui,
ans 1 état de veille, seroit une vive impression , une idée claire*
devient,pendant le sommeil, l’objet même qui produit l’impression que’
tait naître l’idée. C’est ainsi que l’homme qui rêve , devient pour lui-
meme le comédien le plus parfait. L’animal et l’homme ont, pendant
la veille , la faculté de distinguer l’impression et l’idée de l’objet extérieur
qui la produit. Cette faculté se perd pendant le sommeil. Or
comme nous ne pouvons pas avoir la conscience de ces objets comme’
existans dans nous, en vertu d’une loi de la. nature , nous les’ plaçons
hors de nous. Dans ce sens, tout rêve est une vision, une apparition.
Toutes les fois que, tant dans l’état de santé que dans l ’état de
maladie, les sentimens et les idées sont produits avec une promptitude
et une vivacité telles, que nous ne sommes plus en état de les distinguer
de 1 objet qui les produit, en conséquence des lois de nos sentimens
et de nos idées, nous les plaçons dans le monde extérieur, et nous
avons une vision ou une apparition.
Lorsque cette extrême activité des sens intérieurs est passagère
lorsque la personne a le temps de se reconnoître, lorsque d’autres sentimens
et d autres idées viennent affoiblir les premières, lorsque certaius
mouvemens que Ion fait automatiquement, donnent un autre cours à
la circulation du sang, et nous rappellent à nous-mêmes , la vision ou
1 apparition disparoît, nous distinguons de nouveau le sentiment ou
1 idée de 1 objet qui les produi t ; le rêve que nous faisions, tout éveillés,
cesse. Dans ce cas, cetétat est une aliénation passagère qui, cependant
IV. 3 1