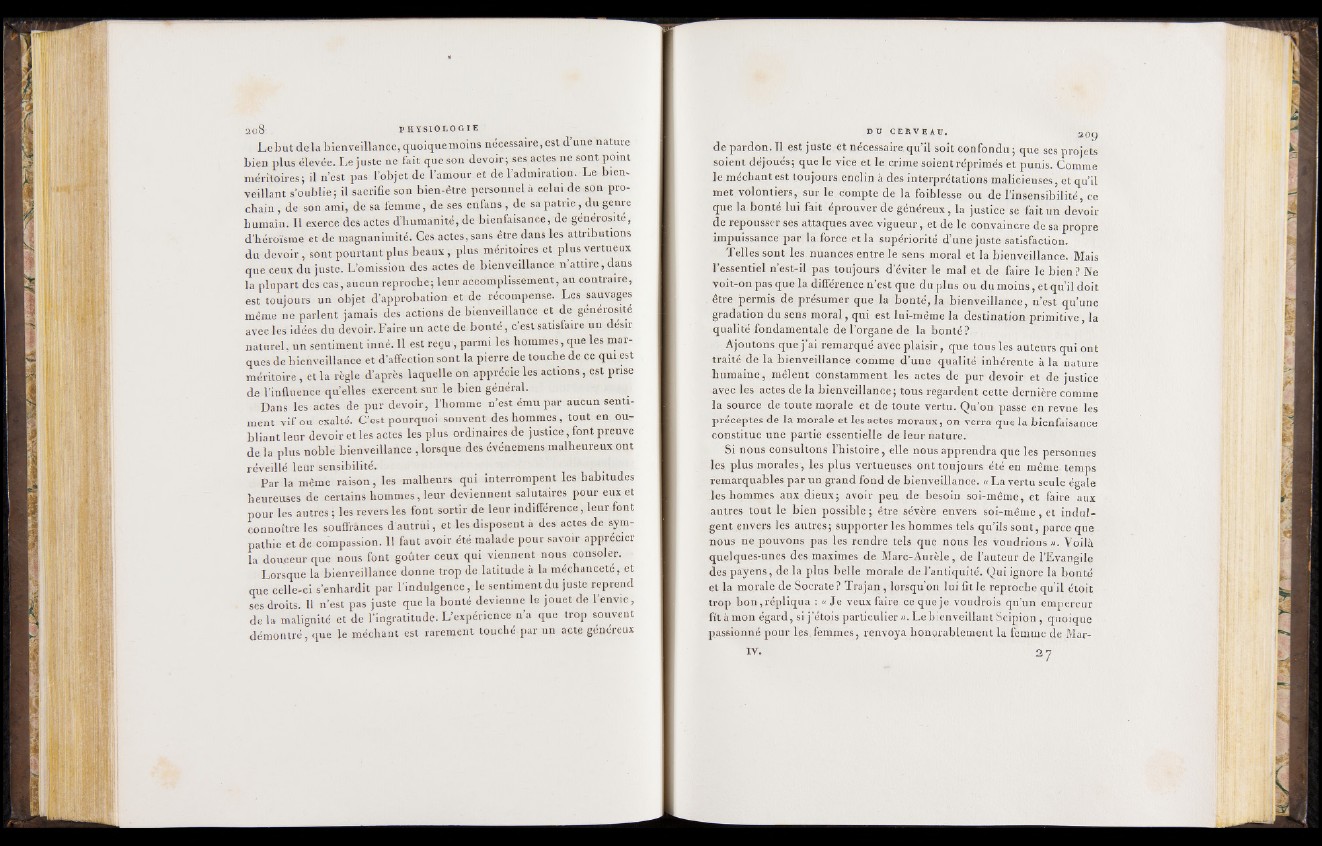
208 ph y s iologi e
Le but de la bienveillance, quoique moins nécessaire, est d une nature
bien plus élevée. Le juste ne fait que son devoir; ses actes ne sont point
méritoires; il n’est pas l’objet de l’amour et de l’admiration. Le bienveillant
s'oublie; il sacrifie son bien-être personnel à celui de son prochain
, de son ami, de sa femme, de ses enfans , de sa patrie, du genre
humain. Il exerce des actes d’humanité, de bienfaisance, de générosité,
d’héroïsme et de magnanimité. Ces actes, sans être dans les attributions
du devoir , sont pourtant plus beaux, plus méritoires et plus vertueux
que ceux du juste. L’omission des actes de bienveillance n’attire, dans
la plupart des cas, aucun reproche; leur accomplissement, au contraire,
est toujours un objet d'approbation et de récompense. Les sauvages
même ne parlent jamais des actions de bienveillance et de généiosite
avec les idées du devoir. Faire un acte de bonté, c’est satisfaire un désir
naturel, un sentiment inné. Il est reçu , parmi les hommes, que les marques
de bienveillance et d’affection sont la pierre de touche de ce qui est
méritoire, et la règle d’après laquelle on apprécie les actions , est prise
de l’influence quelles exercent sur le bien général.
Dans les actes de pur devoir, l’homme n’est ému par aucun sentiment
vif ou exalté. C’est pourquoi souvent des hommes, tout en oubliant
leur devoir et les actes les plus ordinaires de justice, font preuve
de la plus noble bienveillance , lorsque des événemens malheureux ont
réveillé leur sensibilité.
Par la même raison, les malheurs qui interrompent les habitudes
heureuses de certains hommes, leur deviennent salutaires pour eux et
pour les autres ; les revers les font sortir de leur indifférence, leur font
connoître les souffrànces d'autrui, et les disposent à des actes de sympathie
et de compassion. 11 faut avoir été malade pour savoir apprécier
la douceur que nous font goûter ceux qui viennent nous consoler.
Lorsque la bienveillance donne trop de latitude à la méchanceté, et
que celle-ci s’enhardit par l ’indulgence, le sentiment du juste reprend
ses droits. Il n’est pas juste que la bonté devienne le jouet de l ’envie,
de la malignité et de l’ingratitude. L ’expérience n’a que trop souvent
démontré , que le méchant est rarement touché par up acte généreux
de pardon. Il est juste et nécessaire qu’il soit confondu ; que ses projets
soient déjoués; que le vice et le crime soient réprimés et punis. Comme
le méchant est toujours enclin à des interprétations malicieuses, et qu’il
met volontiers, sur le compte de la foiblesse ou de l ’insensibilité, ce
que la bonté lui fait éprouver de genereux, la justice se fait un devoir
de repousser ses attaques avec vigueur, et de le convaincre de sa propre
impuissance par la force et la supériorité d’une juste satisfaction.
Telles sont les nuances entre le sens moral et la bienveillance. Mais
l ’essentiel n’est-il pas toujours d’éviter le mal et de faire le bien? Ne
voit-on pas que la différence n’est que du plus ou du moins, et qu’il doit
être permis de présumer que la bonté, la bienveillance, n’est qu’une
gradation du sens moral, qui est lui-même la destination primitive, la
qualité fondamentale de l ’organe de la bonté?
Ajoutons que j ’ai remarqué avec plaisir, que tous les auteurs qui ont
traité de la bienveillance comme d’une qualité inhérente à la nature
humaine, mêlent constamment les actes de pur devoir et de justice
avec les actes de la bienveillance; tous regardent cette dernière comme
la source de toute morale et de toute vertu. Qu’on passe en revue les
préceptes delà morale et les actes mora ux, on verra qu e la bienfaisance
constitue une partie essentielle de leur nature.
Si nous consultons l’histoire, elle nous apprendra que les personnes
les, plus morales, les plus vertueuses ont toujours été en même, temps
remarquables par un grand fond de bienveillance. «La vertu seule égale
les hommes aux dieux; avoir peu de besoin soi-même, et faire aux
autres tout le bien possible; être sévère envers soi-même, et indulgent
envers les autres; supporter les hommes tels qu’ils sont, parce que
nous ne pouvons pas les rendre tels que nous les voudrions ». Voilà
quelques-unes des maximes de Marc-Aurèle, de l’auteur de l’Evangile
des payens, de la plus belle morale de l’antiquité. Qui ignore la bonté
et la morale de Socrate? Trajan , lorsqu’on lui fit le reproche qu’il étoit
trop bon,répliqua : «Je veux faire cequeje voudrais qu’un empereur
fît à mon égard, si j ’étois particulier ». Le bienveillant Scipion , quoique
passionné pour les.femmes, renvoya honorablement la femme de Mar-
IV. 2 7