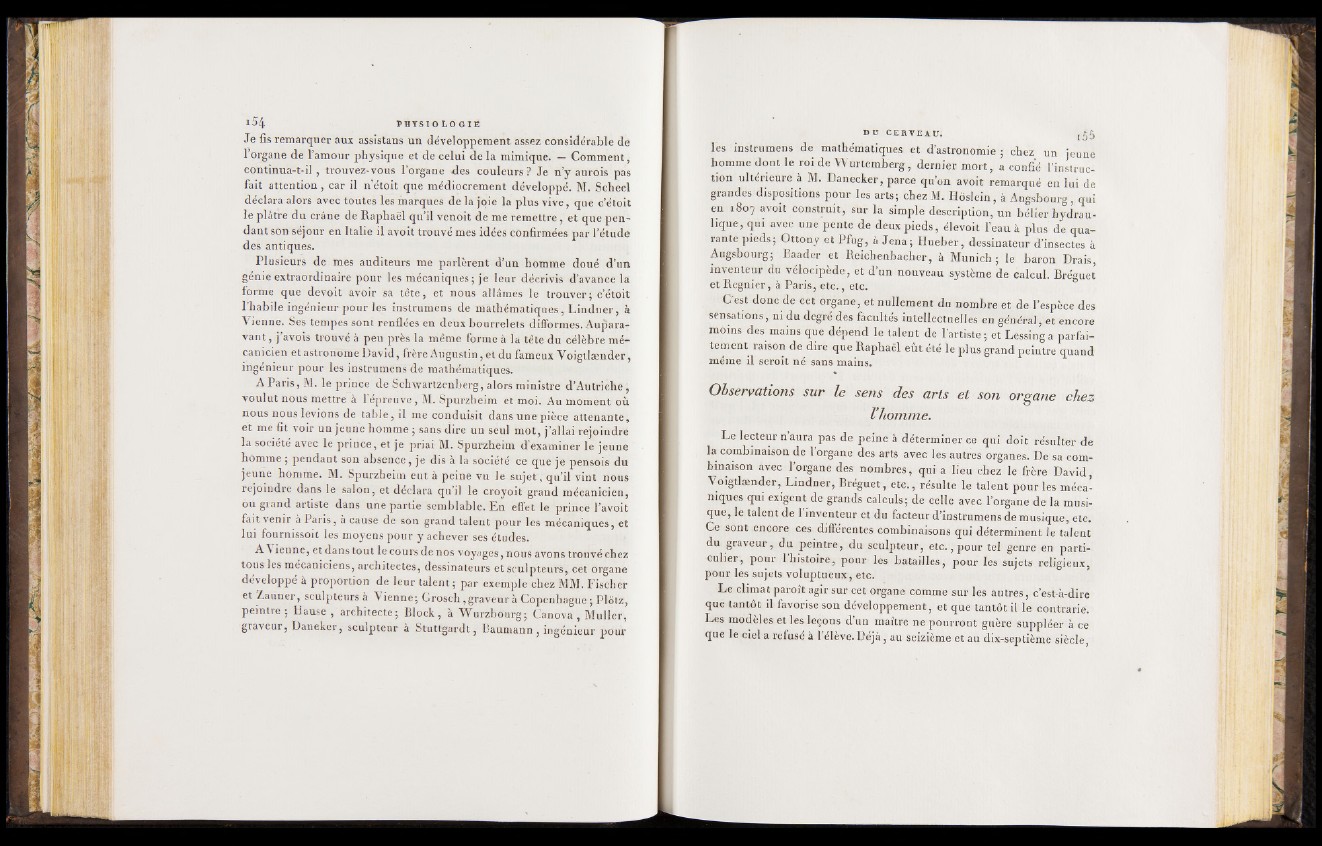
Je fis remarquer aux assistans un développement assez considérable de
1 organe de l’amour physique et de celui de la mimique. — Comment j
eontinua-t-il, trouvez-vous l ’organe des couleurs ? Je n’y aurois pas
fait attention , car il n’étoit que médiocrement développé. M. Scheel
déclara alors avec toutes les marques de la joie la plus vive, que c’étoit
le plâtre du crâne de Raphaël qu’il venoit de me remettre, et que pendant
son séjour en Italie il avoit trouvé mes idées confirmées par l’étude
des antiques.
Plusieurs de mes auditeurs me parlèrent d’un homme doué d’un
génie extraordinaire pour les mécaniques; je leur décrivis d’avance la
forme que devoit avoir sa tête, et nous allâmes le trouver; c’étoit
l ’habile ingénieur pour les instrumens de mathématiques, Lindner, à
Vienne. Ses tempes sont renflées en deux bourrelets difformes. Auparavant,
j’avois trouvé à peu près la même forme à la tête du célèbre mécanicien
et astronome David, frere Augustin, et du fameux Voigtlænder,
ingénieur pour les instrumens de mathématiques.
A Paris, M. le prince de Schwartzenberg, alors ministre d’Autriche,
voulut nous mettre à 1 epreuve, M. Spurzheim et moi. Au moment où
nous nous levions de table, il me conduisit dans une pièce attenante,
et me fit voir un jeune homme ; sans dire un seul mot, j’allai rejoindre
la société avec le prince, et je priai M. Spurzheim d’examiner le jeune
homme ; pendant son absence, je dis a la société ce que je pensois du
jeune homme. M. Spurzheim eut à peine vu le sujet, qu’il vint nous
rejoindre dans le salon, et déclara qu’il le croyoit grand mécanicien,
ou grand artiste dans une partie semblable. En effet le prince l’avoit
fait venir à Paris, à cause de son grand talent pour les mécaniques, et
lui fournissoit les moyens pour y achever ses études.
A Vienne, et dans tout le cours de nos voyages, nous avons trouvé chez
tous les mécaniciens, architectes, dessinateurs et sculpteurs, cet organe
développé à proportion de leur talent; par exemple chez MM. Fischer
et Zauner, sculpteurs à Vienne; Grosch, graveur à Copenhague; Plôtz,
peintre; Hause , architecte; Block, à Wurzbourg; Canova, Muller,
graveur, Daneker, sculpteur à Stuttgardt, Baumann, ingénieur pour
les instrumens de mathématiques et d’astronomie ; chez un jeune
homme dont le roi de Wurtemberg, dernier mort, a confié l’instruction
ultérieure à M. Danecker, parce qu’on avoit remarqué en lui de
grandes dispositions pour les arts; chez M. Hôslein, à Augsbourg , qui
en 1807 avoit construit, sur la simple description, un bélier hydraulique,
qui avec une pente de deux pieds, élevoit l’eau à plus de quarante
pieds; Ottony et Pfug, à Jena; Hueber, dessinateur d’insectes à
Augsbourg; Baader et Reichenbacher, à Munich; le baron Drais,
inventeur du vélocipède, et d’un nouveau système de calcul. Bréguet
et Regnier, à Paris, etc., etc.
C’est donc de cet organe, et nullement du nombre et de l’espèce des
sensations, ni du degré des facultés intellectuelles en général, et encore
moins des mains que dépend le talent de l ’artiste ; et Lessing a parfaitement
raison de dire que Raphaël eût été le plus grand peintre quand
même il seroit né sans mains.
Observations sur le sens des arts et son organe chez
l homme.
Le lecteur n aura pas de peine à déterminer ce qui doit résulter de
la combinaison de 1 organe des arts avec les autres organes. De sa combinaison
avec l’organe des nombres, qui a lieu chez le frère David,
Voigtlænder, Lindner, Bréguet, etc., résulte le talent pour les mécaniques
qui exigent de grands calculs; de celle avec l’organe de la musique,
le talent de 1 inventeur et du facteur d’instrumens de musique, etc.
Ce sont encore ces differentes combinaisons qui déterminent le talent
du graveur, du peintre, du sculpteur, etc:j;pour tel genre en particulier,
pour 1 histoire, pour les batailles, pour les sujets religieux,
pour les sujets voluptueux, etc.
Le climat paroît agir sur cet organe comme sur les autres, c’est-à-dire
que tantôt il favorise son développement, et que tantôt il le contrarie.
Les modèles et les leçons d’un maître ne pourront guère suppléer à ce
que le ciel a refusé à l’élève. Déjà, au seizième et au dix-septième siècle,