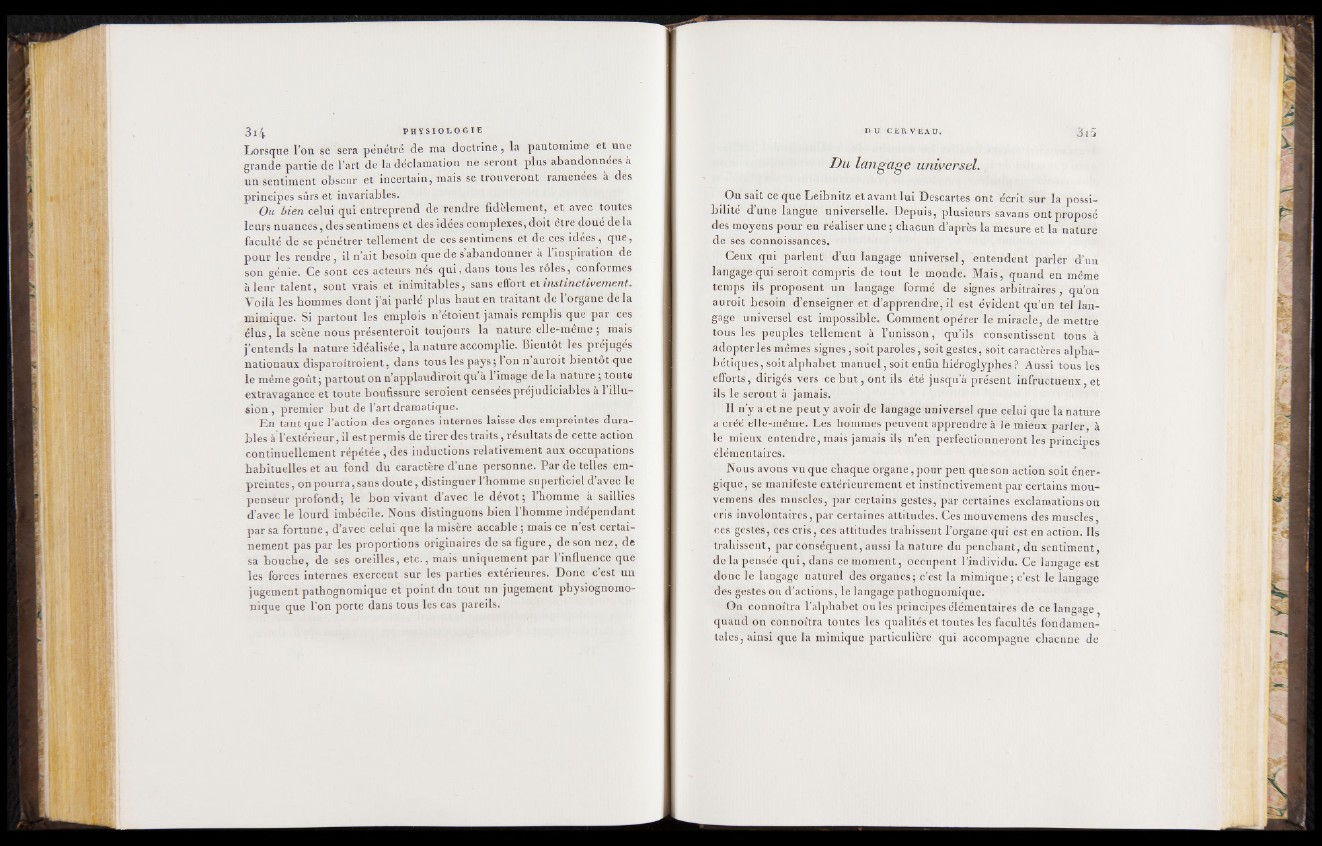
Lorsque l’on se sera pénétré de ma doctrine, la pantomime et une
grande partie de l’art de la déclamation ne seront plus abandonnées à
un sentiment obscur et incertain, mais se trouveront ramenées à des
principes sûrs et invariables.
Ou bien celui qui entreprend de rendre fidèlement, et avec toutes
leurs nuances, des sentimens et des idees complexes, doit être doué de la
faculté de se pénétrer tellement de ces sentimens et de ces idees, que,
pour les rendre, il n’ait besoin que de s’abandonner à l’inspiration de
son génie. Ce sont ces acteurs nés qui .dans tous les rôles, conformes
à leur talent, sont vrais et inimitables, sans effort et instinctivement.
Voilà les hommes dont j’ai parlé plus haut en traitant de l’organe de la
mimique. Si partout les emplois n’étoient jamais remplis que par ces
élus, la scène nous présenteroit toujours la nature elle-meme ; mais
j’entends la nature idéalisée, la nature accomplie. Bientôt les préjuges
nationaux disparoîtroient, dans tous les pays; 1 on n auroit bientôt que
le même goût; partout on n’applaudiroit qu à 1 image de la nature ; toute
extravagance et toute boufissure seroient censeesprejudiciables a 1 illusion
, premier but de l’art dramatique.
En tant que l’action des organes internes laisse des empreintes durables
à l’extérieur, il est permis de tirer des traits, résultats de cette action
continuellement répétée, des inductions relativement aux occupations
habituelles et au fond du caractère d’une personne. Par de telles empreintes,
on pourra,sans doute, distinguer l’homme superficiel d’avec le
penseur profond; le bon vivant davec le dévot; 1 homme a saillies
d’avec le lourd imbécile. Nous distinguons bien l’homme indépendant
par sa fortune, d’avec celui que la misère accable ; mais ce n’est certainement
pas par les proportions originaires de sa figure, de son nez, de
sa bouche, de ses oreilles, etc., mais uniquement par l’influence que
les forces internes exercent sur les parties extérieures. Donc c’est un
jugement pathognomique et point du tout un jugement physiognomo-
nique que l ’on porte dans tous les cas pareils.
Du langage universel.
On sait ce que Leibnitz et avant lui Descartes ont écrit sur la possibilité
d’une langue universelle. Depuis, plusieurs savans ont proposé
des moyens pour en réaliser une ; chacun d’après la mesure et la nature
de ses connoissances.
Ceux qui parlent d’un langage universel, entendent parler d’un
langage qui seroit compris de tout le monde. Mais, quand en même
temps ils proposent un langage formé de signes arbitraires, qu’on
auroit besoin d’enseigner et d’apprendre, il est évident qu’un tel langage
universel est impossible. Comment opérer le miracle, de mettre
tous les peuples tellement à l’unisson, qu’ils consentissent tous à
adopter les mêmes signes, soit paroles, soit gestes, soit caractères alphabétiques,
soit alphabet manuel, soit enfin hiéroglyphes ? Aussi tous les
efforts, dirigés vers ce b u t, ont ils été jusqu a présent infructueux, et
ils le seront à jamais.
Il n’y a et ne peut y avoir de langage universel que celui que la nature
a créé elle-même. Les hommes peuvent apprendre à le mieux parler, à
le mieux entendre, mais jamais ils n’en perfectionneront les principes
élémentaires.
Nous avons vu que chaque organe, pour peu que son action soit énergique,
se manifeste extérieurement et instinctivement par certains mou-
vemens des muscles, par certains gestes, par certaines exclamations ou
cris involontaires, par certaines attitudes. Ces mouvemens des muscles,
ces gestes, ces cris, ces attitudes trahissent l’organe qui est en action. Ils
trahissent, par conséquent, aussi la nature du penchant, du sentiment,
de la pensée qui, dans ce moment, occupent l ’individu. Ce langage est
donc le langage naturel des organes; c’est la mimique; c’est le langage
des gestes ou d’actions, le langage pathognomique.
On connoitra l’alphabet ouïes principes élémentaires de ce langage
quand on connoitra toutes les qualités et toutes les facultés fondamentales,
ainsi que la mimique particulière qui accompagne chacune de