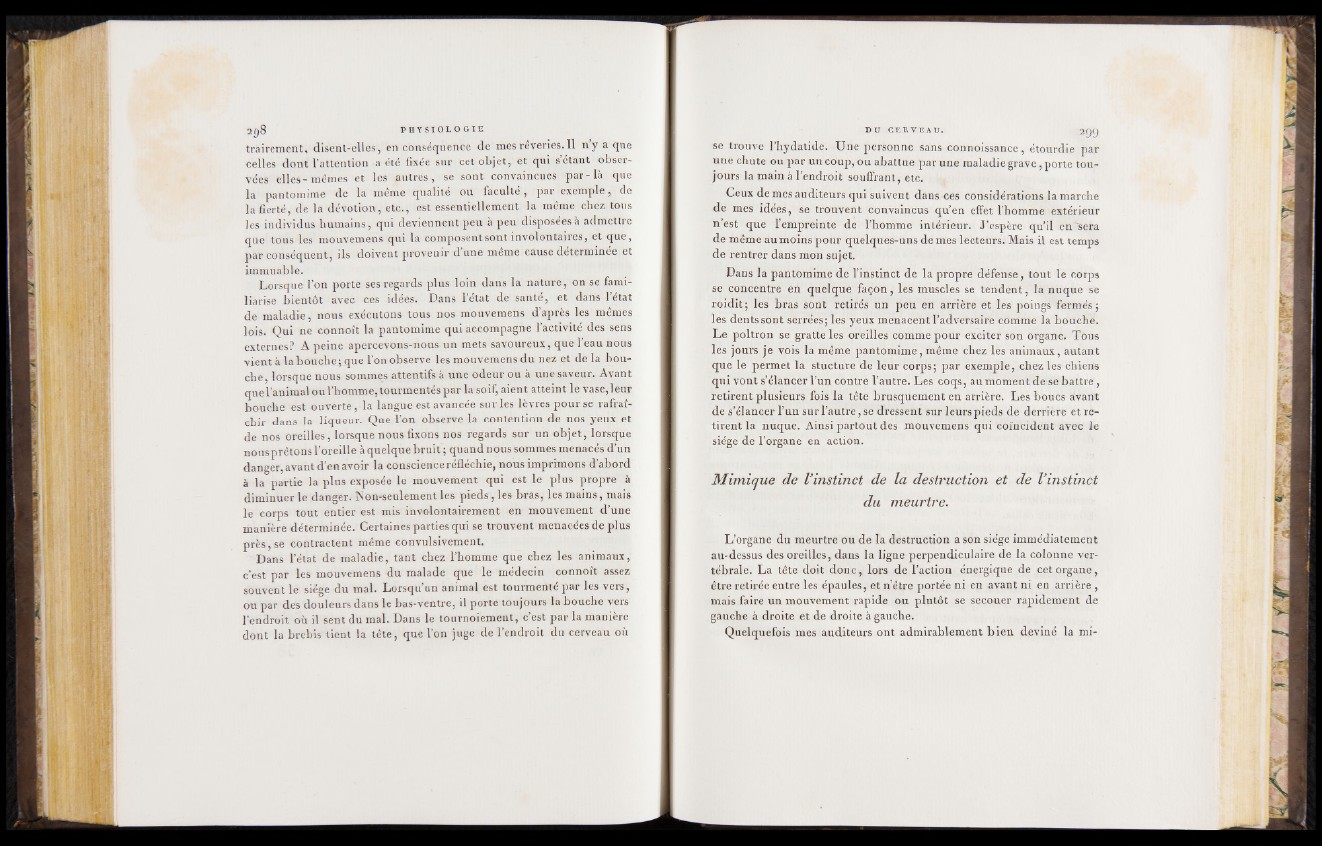
2( )8 p h y s i o l o g i e
trairement, disent-elles, en conséquence de mes rêveries.11 nyaque
celles dont l’attention a été fixée sur cet objet, et qui sétant observées
elles-mêmes et les autres, se sont convaincues par-là que
la pantomime de la même qualité ou faculté, par exemple, de
la fierté, de la dévotion, etc., est essentiellement la même chez tous
les individus humains, qui deviennent peu à peu disposées à admettre
que tous les mouvemens qui la composent sont involontaires, et que,
par conséquent, ils doivent provenir d une même cause determinee et
immuable.
Lorsque l’on porte ses regards plus loin dans la nature, on se familiarise
bientôt avec ces idées. Dans l ’état de santé, et dans l’état
de maladie, nous exécutons tous nos mouvemens d’après les mêmes
lois. Qui ne connoît la pantomime qui accompagne l’activité des sens
externes? A peine apercevons-nous un mets savoureux, que l’eau nous
vient à la bouche; que l’on observe les mouvemens du nez et de la bouche,
lorsque nous sommes attentifs à une odeur ou à une saveur. Avant
quel’animal ou l’homme, tourmentés par la soif, aient atteint le vase, leur
bouche est ouverte, la langue est avancée sur les lèvres pour se rafraîchir
dans la liqueur. Que l’on observe la contention de nos yeux et
de nos oreilles, lorsque nous fixons nos regards sur un objet, lorsque
nous prêtons l’oreille à quelque bruit ; quand nous sommes menacés d’un
danger, avant d’en avoir la conscience réfléchie, nous imprimons d’abord
à la partie la plus exposée le mouvement qui est le plus propre à
diminuer le danger. Non-seulement les pieds, les bras, les mains, mais
le corps tout entier est mis involontairement en mouvement d’une
manière déterminée. Certaines parties qui se trouvent menacées de plus
près, se contractent même convulsivement.
Dans l’état de maladie, tant chez l’homme que chez les animaux,
c’est par les mouvemens du malade que le médecin connoît assez
souvent le siège du mal. Lorsqu’un animal est tourmenté par les vers,
ou par des douleurs dans le bas-ventre, il porte toujours la bouche vers
l’endroit où il sent du mal. Dans le tournoiement, c est par la maniéré
dont la brebis tient la tête, que l’on juge de l ’endroit du cerveau où
DU CERVE A U . 2 9 9
se trouve l’hydatide. Une personne sans connoissance, étourdie par
une chute ou par un coup, ou abattue par une maladie grave, porte toujours
la main à l’endroit souffrant, etc.
Ceux de mes auditeurs qui suivent dans ces considérations la marche
de mes idées, se trouvent convaincus qu’en effet l’homme extérieur
n’est que l’empreinte de l’homme intérieur. J’espère qu’il en sera
de même au moins pour quelques-uns de mes lecteurs. Mais il est temps
de rentrer dans mon sujet.
Dans la pantomime de l’instinct de la propre défense, tout le corps
se concentre en quelque façon, les muscles se tendent, la nuque se
roidit; les bras sont retirés un peu en arrière et les poings fermés;
les dents sont serrées; les yeux menacent l’adversaire comme la bouche.
Le poltron se gratte les oreilles comme pour exciter son organe. Tous
les jours je vois la même pantomime, même chez les animaux, autant
que le permet la stucture de leur corps; par exemple, chez les chiens
qui vont s’élancer l’un contre l’autre. Les coqs, au moment de se battre,
retirent plusieurs fois la tête brusquement en arrière. Les boucs avant
de s’élancer l’un sur l’autre, se dressent sur leurs pieds de derrière et retirent
la nuque. Ainsi partout des mouvemens qui coïncident avec le
siège de l ’organe en action.
Mimique de l’instinct de la destruction et de l’instinct
du meurtre.
L ’organe du meurtre ou de la destruction a son siège immédiatement
au-dessus des oreilles, dans la ligne perpendiculaire de la colonne vertébrale.
La tête doit donc, lors de l’action énergique de cet organe,
être retirée entre les épaules, et n’être portée ni en avant ni en arrière ,
mais faire un mouvement rapide ou plutôt se secouer rapidement de
gauche à droite et de droite à gauche.
Quelquefois mes auditeurs ont admirablement bien deviné la mi