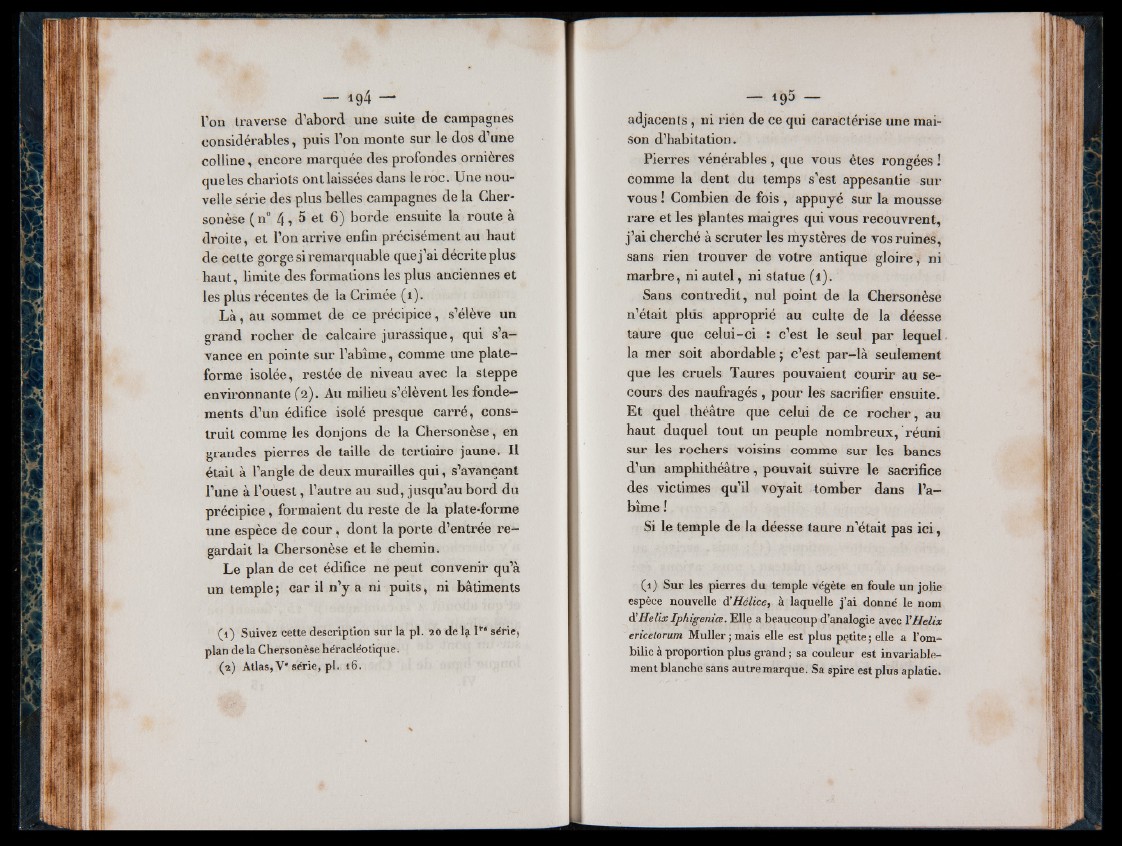
l’on traverse d’abord une suite de campagnes
considérables, puis l’on monte sur le dos d’une
colline, encore marquée des profondes ornières
queles chariots ont laissées dans le roc. Une nouvelle
série des plus belles campagnes de la Cher-
sonèse (n° 4> 5 et 6) borde ensuite la route à
droite, et l’on arrive enfin précisément au haut
de cette gorge si remarquable que j ’ai décrite plus
haut, limite des formations les plus anciennes et
les plus récentes de la Crimée (î).
L à , au sommet de ce précipice, s’élève un
grand rocher de calcaire jurassique, qui s’avance
en pointe sur l’abîme, comme une plateforme
isolée, restée de niveau avec la steppe
environnante (2). Au milieu s’élèvent les fondements
d’un édifice isolé presque carré, construit
comme les donjons de la Chersonèse, en
grandes pierres de taille de tertiaire jaune. Il
était à l’angle de deux murailles qui, s’avançant
l’une à l’ouest, l’autre au sud, jusqu’au bord du
précipice, formaient du reste de la plate*forme
une espèce de cour, dont la porte d’entrée re-*-
gardait la Chersonèse et le chemin.
Le plan de cet édifice ne peut convenir qu’à
un temple; car il n’y a ni puitsi ni bâtiments
(1 ) Suivez cette description sur là pl. 20 de 1$ ï ta série,
plan de la Chersonèse héracléotique.
(2) Atlas,Ve série, pl. 16.
adjacents , ni rien de ce qui caractérise une maison
d’habitation.
Pierres vénérables, que vous êtes rongées!
comme la dent du temps s’est appesantie sur
vous ! Combien de fois , appuyé sur la mousse
rare et les plantes maigres qui vous recouvrent,
j ’ai cherché à scruter les mystères de vos ruines,
sans rien trouver de votre antique gloire, ni
marbre, ni autel, ni statue (1).
Sans contredit, nul point de la Chersonèse
n’était plus approprié au culte de la déesse
taure que celui-ci : c’est le seul par lequel
la mer soit abordable ; c’est par-là seulement
que les cruels Taures pouvaient courir au secours
des naufragés , pour les sacrifier ensuite.
Et quel théâtre que celui de ce rocher , au
haut duquel tout un peuple nombreux, réuni
sur les rochers voisins comme sur les bancs
d’un amphithéâtre, pouvait suivre le sacrifice
des victimes qu’il voyait tomber dans l’abîme
!
Si le temple de la déesse taure n’était pas ic i,
( i ) Sur les pierres du temple végète en foule un jolie
espèce nouvelle d'Hélice, à laquelle j ’ai donné le nom
d’Hélix Iphigenioe. Elle a beaucoup d’analogie avec l’Hélix
ericetorum Muller ; mais elle est plus petite ; elle a l’ombilic
à proportion plus grand ; sa couleur est invariablement
blanche sans autre marque. Sa spire est plus aplatie.