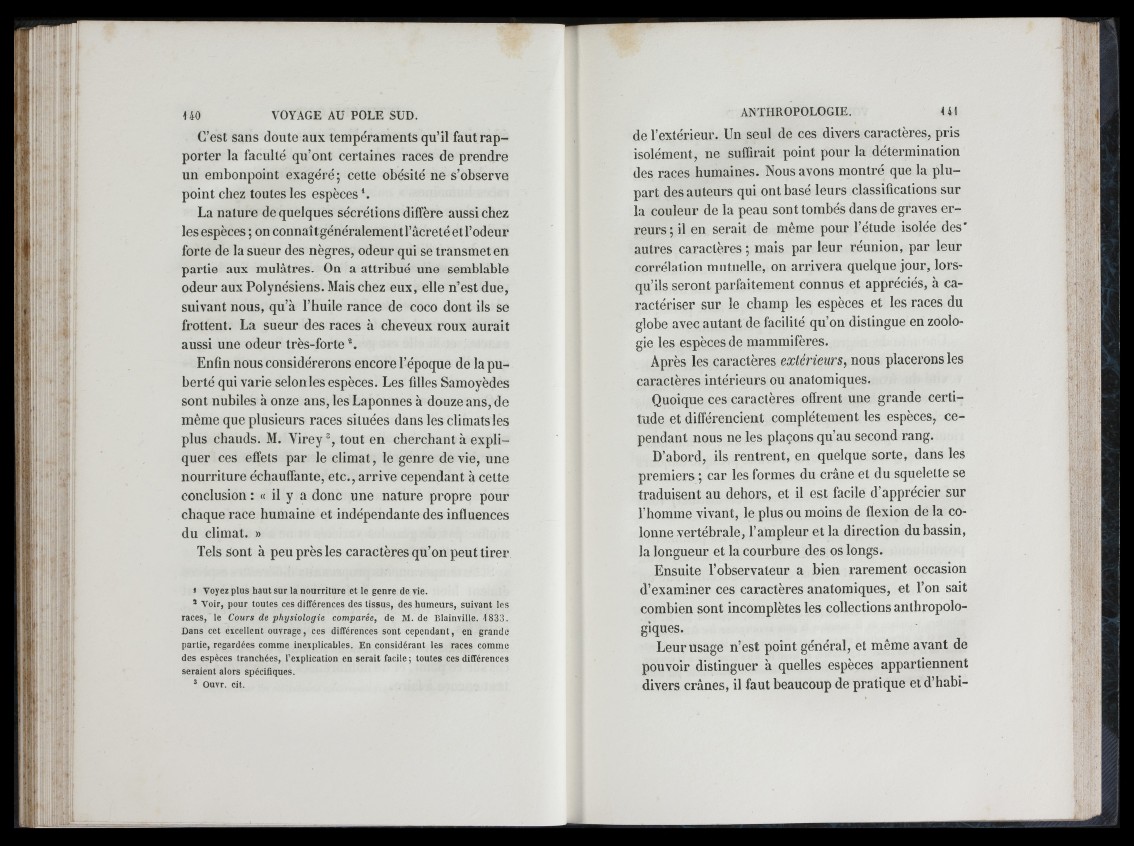
“ iS
r
IIIl i'
I» .'i
1
iiF
F ’
IF
Il
Il ■;
C’est sans doute aux tempéraments qu’il faut ra p porter
la faculté q u ’ont certaines races de prendre
un embonpoint exagéré; cette obésité ne s ’observe
point chez toutes les espèces *.
La na ture de quelques sécrétions diffère aussi chez
les espèces ; on connaîtgénéralementrâcrelé e tl ’odeur
forte de la sueur des nègres, odeur qui se transme t en
partie aux mulâtres. On a attribué une semblable
odeur aux Polynésiens. Mais chez eux, elle n ’est due,
suivant nous, q u ’à l’huile rance de coco dont ils se
frottent. La sueur des races à cheveux roux aurait
aussi une odeur très-forte
Enfin nous considérerons encore l’époque de la puberté
qui varie selon les espèces. Les filles Samoyèdes
sont nubiles à onze ans, les Laponnes à douze ans, de
même que plusieurs races situées dans les climats les
plus chauds. M. Yirey % tout en cherchant à expliquer
ces effets pa r le c lima t, le genre de xie, une
nourriture échauffante, etc., a rrive cependant à celte
conclusion : « il y a donc une n a ture propre pour
chaque race humaine et indépendante des influences
du climat. »
Tels sont à peu près les caractères q u ’on peut tire r
: iSl:
t Voyez plus haut su r la n o u r r i tu r e et le genre de vie.
* Voir, pour toutes ces différences des tissus, des humeurs, suivant les
races, le Cours de physiologie comparée, de M. de Blainville. 1833.
Dans cet excellent ouvrage, ces différences sont cependant, en grande
partie, regardées comme inexplicables. En considérant les races comme
des espèces tranchées, l’explicalion en serait facile ; toutes ces différences
seraient alors spécifiques.
* Ouvr. cit.
T'
t !
HiFi':
de l’extérieur. Un seul de ces divers caractères, pris
isolément, ne suffirait point pour la détermination
des races humaines. Nous avons montré que la plup
a rt des auteurs qui ont basé leurs classifications sur
la couleur de la peau sont tombés dans de graves e rr
e u r s ; il en serait de même pour l’étude isolée d e s '
autres caractères ; mais par leur réunion, p a r leur
corrélation mutuelle, on a rrive ra quelque jour, lorsqu’ils
seront parfaitement connus et appréciés, à caractériser
sur le champ les espèces et les races du
globe avec autant de facilité qu’on distingue en zoologie
les espèces de mammifères.
Après les caractères extérieurs, nous placerons les
caraclères intérieurs ou anatomiques.
Quoique ces caractères offrent une grande certitude
et différencient complètement les espèces, cependant
nous ne les plaçons qu’au second rang.
D’abord, ils rentrent, en quelque sorte, dans les
premiers ; car les formes du crâne et du squelette se
traduisent au dehors, et il est facile d’apprécier sur
l’homme vivant, le plus ou moins de flexion de la colonne
v ertébrale, l’ampleur et la direction du bassin,
la longueur et la courbure des os longs.
Ensuite l’observateur a bien ra remen t occasion
d ’examiner ces caractères anatomiques, et l’on sait
combien sont incomplètes les collections anthropologiques.
Leur usage n ’est point général, et même avant de
pouvoir distinguer à quelles espèces appartiennent
divers crânes, il faut beaucoup de p ratique et d ’habi-
'Yf
'• i?!
‘• î . l
VA