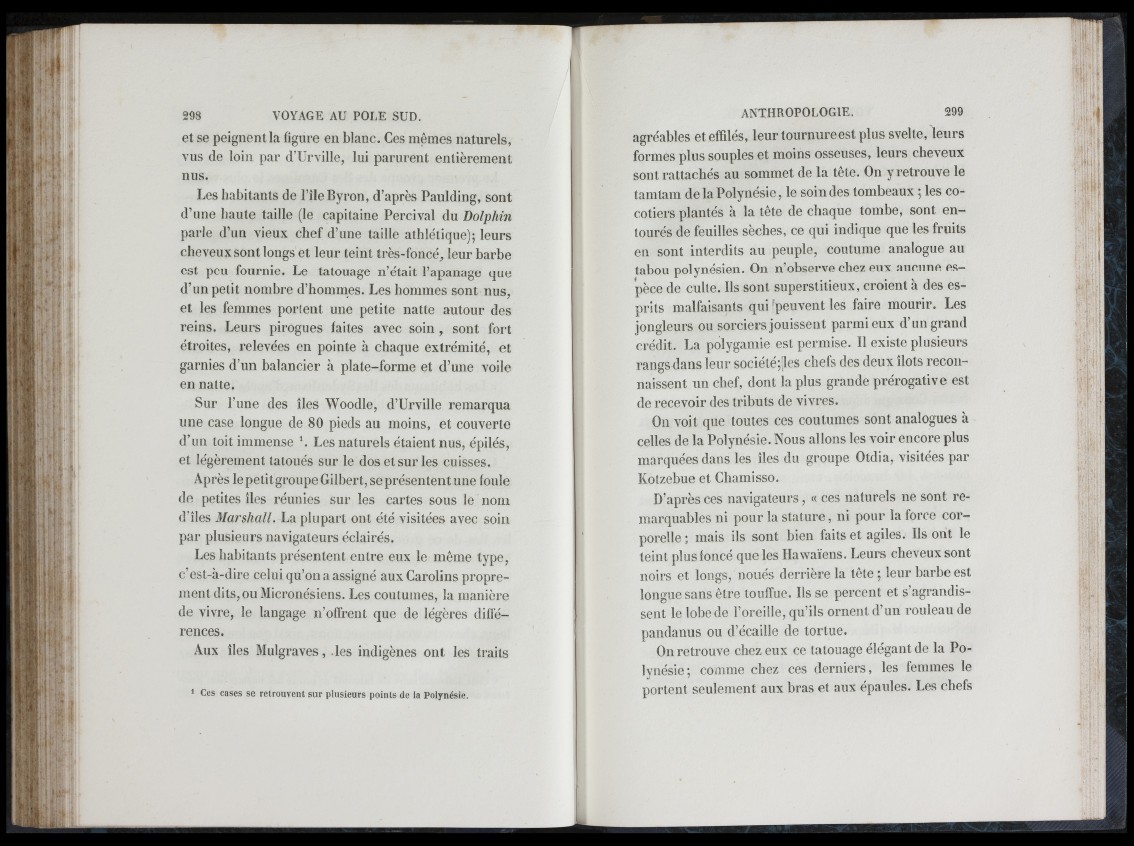
■ í • Aí. 1ï
J
*■‘11(1= p i i
1.4 .1 l i i
p ]
<11
:■> I .-/ri",
■
et se peignent la figure en blanc. Ces mffines n a tu re ls,
vus de loin p a r d ’Urville, lui p a ru re n t e n tiè rem en t
nu s.
Les habitants de l ’île Byron, d ’après Paulding, sont
d ’une h au te taille (le capitaine Percival du Dolphin
parie d’un vieux chef d ’une taille athlétique); leurs
cheveux sont longs e t le u r tein t très-fonc é, leu r b a rb e
est peu fournie. Le tatouage n ’était l’apanage que
d ’im petit nomb re d’hommes. Les hommes sont nus,
et les femmes p o rten t u ne petite n a tte a u to u r des
re in s. Leurs pirogues faites avec soin , so n t fort
étroites, relevées en pointe à chaque ex trém ité , et
garnies d ’un b a lan c ie r à p la te -fo rm e et d ’une voile
en n a tte .
S u r l’une des îles Woodle, d ’Urville rem a rq u a
u n e case longue de 80 pieds au moins, et couverte
d ’un toit immense *. Les n a tu re ls é ta ien t nus, épilés,
et légèrement tatoués su r le dos et su r les cuisses.
Après le petit groupe Gilbert, se p ré s en te n t u ne foule
de petites îles réu n ie s su r les cartes sous le nom
d ’îles Marshall. La p lu p a rt o n t été visitées avec soin
p a r p lusieurs n avigateurs éclairés.
Les hab itan ts p ré sen ten t e n tre eux le même type,
c ’est-à-d ire celui q u ’on a assigné aux Carolins p ro p re ment
d its,o u Alicronésiens. Les coutumes, la manière
de vivre, le langage n ’offrent que de légères différences.
Aux îles Alulgraves, les indigènes o n t les traits
« Ces cases se retrouvent sur plusieurs points de la Polynésie.
agréables et effilés, le u r to u rn u re est plus svelte, leu rs
formes plus souples et moins osseuses, leu rs cheveux
sont ra tta ch é s au sommet de la tête. On y re tro u v e le
tamtain de la P o ly n é sie , le soin des tombeaux ; les cocotiers
plantés à la tête de chaque tombe, sont e n tourés
de feuilles sèches, ce qui in d iq u e que les fruits
en sont in te rd its au peuple, coutume analogue au
tabou polynésien. On n ’observe chez eux au cu n e espèce
de culte, ils sont su p e rstitieu x , c ro ien t à des esp
rits malfaisants qui ^peuvent les faire m o u rir. Les
jo n g leu rs ou sorciers jo u is sen t p a rm i eux d ’un g ran d
créd it. La polygamie est permise. Il existe p lusieurs
ran g s dans le u r société;iles chefs des d eux îlots re co n n
a issent u n chef, dont la plus grande p ré ro g a tiv e est
de recevoir des trib u ts de vivres.
On voit que toutes ces coutumes sont analogues à
celles de la Polynésie. Nous allons les v o ir encore plus
m arq u é es dans les îles du groupe Otdia, visitées p a r
Kotzebue et Chamisso.
D’ap rè s ces n a v ig a te u rs, « ces n a tu re ls ne sont re marquables
n i p o u r la s ta tu r e , n i p o u r la force co rporelle
; mais ils sont b ien faits e t agiles. Ils ont le
te in t plus foncé que les Hawaïens. Leurs cheveux sont
noirs e t longs, noués d e rriè re la tête ; le u r b a rb e est
longue sans ê tre touffue. Ils se p e rc en t et s’agrandissent
le lobe de l’oreille, q u ’ils o rn en t d’u n ro u le au de
p an d an u s ou d ’écaille de to rtu e .
On retro u v e chez eux ce tatouage élégant de la P o lynésie;
comme chez ces d e rn ie rs , les femmes le
p o rten t seulement aux b ras et aux épaules. Les chefs
MM
p
m
Ml
ri!
v;j
r i
* tÍ Í,
J