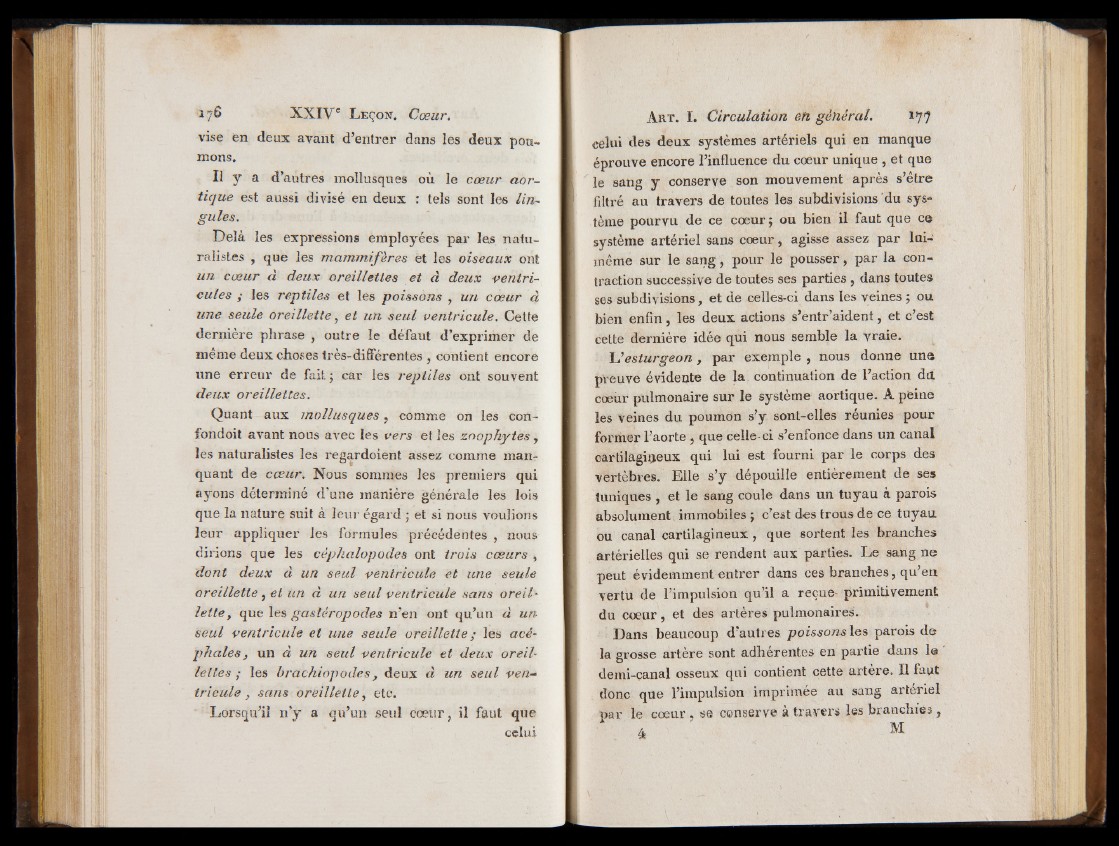
vise en deux avant d’entrer dans les deux poumons.
Il y a d’autres mollusques où le coeur aortique
est aussi divisé en deux : tels sont les lin-
gu les.
Delà les expressions employées par lus naturalistes
, que les mammifères et les oiseaux ont
un coeur d deux oreillettes et à deux ventricules
; les reptiles et les poissons , un coeur à
une seule oreillette, et un seul ventricule. Cette
dernière phrase , outre le défaut d’exprimer de
meme deux choses très-différentes , contient encore
une erreur de fait 5 car les reptiles ont souvent
deux oreillettes.
Quant aux mollusques , comme on les con-
fondoit avant nous avec les vers et les znophytes,
les naturalistes les regardoient assez comme manquant
de coeur% Nous sommes les premiers qui
ayons déterminé d’une manière générale les lois
que la nature suit à leur égard § et si nous voulions
leur appliquer les formules précédentes , nous
dirions que les céphalopodes ont trois coeurs ,
dont deux d un seul ventricule et une seule
oreillette, et un à un seul ventricule sans oreil'
lettef que les gastéropodes n’en ont qu’un à un-
seul ventricule et une seule oreillette ; les acéphales
3 un à un seul ventricule et deux oreillettes
y les brachiopodes, deux à un seul ventricule
} sans oreillette, etc.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul coeur, il faut que
celui
celui des deux systèmes artériels qui en manque
éprouve encore l’influence du coeur unique , et que
le sang y conserve son mouvement après s’être
filtré au travers de toutes les subdivisions du système
pourvu de ce coeur $ ou bien il faut que ce
système artériel sans coeur, agisse assez par lui-
même sur le sang, pour le pousser, par la contraction
successive de toutes ses parties , dans toutes
ses subdivisions, et de celles-ci dans les veines ; ou
bien enfin, les deux actions s’entr’aident, et c’est
cette dernière idée qui nous semble la vraie.
L ’esturgeon , par exemple , nous donne un©
pleuve évidente de la continuation de l’action du
coeur pulmonaire sur le système aortique. A peine
les veines du poumon s’y sont-elles réunies pour
former l’aorte , que celle-ci s’enfonce dans un canal
cartilagineux qui lui est fourni par le corps des
vertèbres. Elle s’y dépouille entièrement de ses
tuniques , et le sang coule dans un tuyau à parois
absolument, immobiles j c’est des trous de ce tuyau
ou canal cartilagineux, que sortent les branches
artérielles qui se rendent aux parties. L e sang ne
peut évidemment entrer dans ces branches, qu’en
vertu de l’impulsion qu’il a reçue- primitivement
du coeur, et des artères pulmonaires.
Dans beaucoup d’autres poissons les parois de
la grosse artère sont adhérentes en partie dans le
demi-çanal osseux qui contient cette artère. Il faut
donc que l’impulsion imprimée au sang artériel
par le coeur, se conserve à travers les branchies,
M