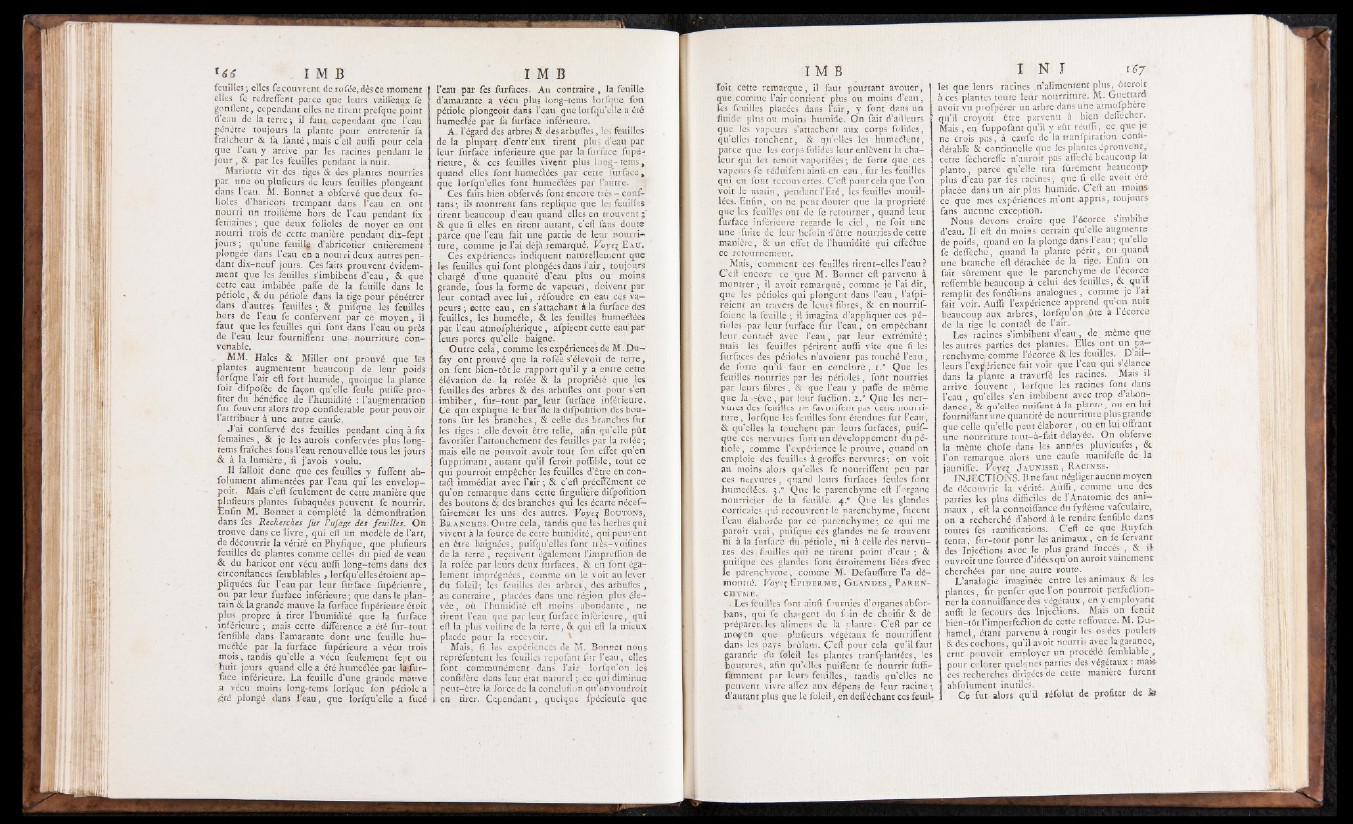
l 66 . I M B
feuilles-, elles fecouvrent de rofée, dès Ce moment
elles fe redreffent parce que leurs vaifïeaux fe
gonflent, cependant elles ne rirent prefque point
d eau de la terre \ il faut, cependant que l’eau
pénètre toujours la plante pour entretenir fa
fraîcheur & fa lanté ; mais c’eft aufli pour cela
que l’eau y arrive par les racines pendant le
jour , & par les feuilles pendant la nuit.
Mariette vit des tiges & des plantes nourries :
par une ou plufieurs de leurs feuilles plongeant
dans l’eau. M. Bonnet a obfervé que deux folioles
d’haricots trempant dans l’eau en ont
nourri un troilième hors de l’eau pendant lix
femaines ; que deux folioles de noyer en ont
nourri trois .de cette manière pendant dix-fept
jours ; qu’une feuille d’abricotier entièrement
plongée dans l’eau en a nourri deux autres pendant
dix-neuf jours. Ces faits prouvent évidemment
que les -feuilles s’imbibent d’eau, & que
cette eau imbibée paffe de la feuille dans le
pétiole, & du pétiole dans la tige pour pénétrer
dans d’autres feuilles -, & puilque les feuilles
hors de l’eau fe confervent par ce moyen, il
faut que les feuilles qui font dans l’eau ou près
de Feau leur fourniflent une nourriture convenable.
- MM. Haies & Miller ont prouvé que lès
plantes augmentent beaucoup de leur poids
lorfque l’ai'r eft fort humide, quoique la plante
foit difpofée de façon qu’elle feule puiffe profiter
du bénéfice de l’humidité : l’augmentation
fut fouvent alors trop confidérable pour pouvoir
l’attribuer à une autre caufe.
J ’ai confervé des feuilles pendant cinq à fix
femaines , & je les aurois confervées plus long-
tems fraîches fous l’eau renouvellée tous les jours
& à la lumière, fi j’avois voulu.
Il falloir donc que ces feuilles y fuffent ab~
folument alimentées par l’eau qui les enveiop-
poit. Mais c’eft feulement de cette manière que
plufieurs plantés fubaquée.s peuvent fe nourrir.
Enfin M. Bonnet a complété la démonftration
dans fes Recherches fur l’ufage des feuilles. Oh
trouve dans ce liv re , qui eft un modèle de l’art,
de découvrir la vérité en Phyfique, que plufieurs
feuilles de plantes comme celles du pied de veau
& du haricot ont vécu aufli long-tems dans des
circonftances femblables , lorfqu’elles étoient appliquées
fur l’eau par leur furface fupérieure,
ou par leur furface inférieure ; que dans le plantain
& la grande mauve la furface fupérieure étoit
plus propre à. tirer l’humidité que la furface
inférieure ; mais cette différence a été fur-tout
fenfible dans - l’amarante dont une feuille hu-
meéîée par la furface fupérieure a vécu trois
mois, tandis quelle a vécu feulement fept ou
huit jours quand elle a été humèélée par laifur-
face inférieure. La feuille d’une grande mauve
,a vécu moins long-tems lorfque fon pétiole a
éxé plongé dans l ’eau, que lorfqu’elle a fucé
I M B
l’eau par fes furfaces. Au contraire, la feuille
d’amarante a vécu plus long-tems lorfque fon
pétiole plongeoir dans l’eau que lorfqu’elle a été
humeètée par fa furface inférieure.
A . l’égard des arbres & des arbuftes, les feuilles
de la plupart d’en tr’eux tirent plus d’eau par
leur furface inférieure que par la furface fupérieure,
& ces feuilles vivent plus long-tems,
quand elles font humeCtées par cette furface
que lorfqu’elles font humeCtées par l’autre.
Cès faits bien obfervés font encore très - conf-
tans -, ils montrent fans répliqué que les feuilles
tirent beaucoup d’eau quand elles en trouvent f
& que fi elles en tirent autant, c’eft fans doute
parce que l’eau fait une partie de leur nourriture,
comme je l’ai déjà remarqué. Voyez E au.
Ces expériences indiquent naturellement que
les feuilles qui font plongées dans l’a ir , toujours
chargé d’une quantité d’eau plus ou moins
grande, fous la forme de vapeurs, doivent par
leur conta# avec lu i, réfoudre en eau cés vapeurs
; cette eau, en s’attachant à la furface des
feuilles, les humeéle, & les feuilles humectées
par l’eau atmofphérique, afpirent cettè eau par
leurs pores quelle baigne.
Outre cela, comme les expériences de M .D u -
fay ont prouvé que la rofée s’élevoit de terre,
on fent bien-tôtle rapport qu’il y a entre cette
élévation de. la rofée & la propriété que les
feuilles des arbres & des arbuftes ont pour s’en
•imbiber, fur-tout par leur furface inférieure.
Ce qui explique le but de la difpofition des boutons
fur les branches, & celle des branches fur
les tiges : elle devoir être telle, afin qu’elle pût
favorifer l’attouchement des feuilles par la rofée;
mais elle ne pouvoir. avoir tout fon effet qu’en
fupprimant, autant qu’il feroit poflible, tout ce
qui pourroit empêcher les feuilles d’être eh conta#
immédiat avec l’air ; & c’eft précisément ce
qu’on remarque dans cette fingufière difpôfition
des boutons & des branches qui les écarte nécef-
fairement les uns des autres. Voyez Boxjtons,
Branches. Outre cela, tandis que les herbes qui
vivent à la fource de cette humidité, qui peuvent
en être baignées, puifqu’ellès font très-voifines
de la terre , reçoivent également l’impreflion de
la rofée -par leurs deux furfaces, & en font également
imprégnées, comme on le voit au lever
du foleil; les feuilles des arbres , dés arbuftes,
au contraire , placées dans une région plus élevée
, où l’humidiré eft moins abondanré, ne
tirent Feau que par leur furface inférieure, qui
eft la plus vQifine de la terre, & qui eft la mieux
placée pour la recevoir.
Mais, fi les expériences de M. Bonnet nous
repféfentent les feuilles repofant fur Feau, elles
font communément dans l ’air lorfqu’ôn les
confidère dans leur état naturel; ce qui diminue
j peut-être la force de la conclufion qu’on voudroit
I en tirer. Cependant, quelque fpéçieufé que
I M B
Toit cette remarque, il faut pourtant avouer,
que comme l’air contient plus ou moins d’eau,
les feuilles placées dans l’à i r , y font dans un
fluide plus ou moins humide. On fait d’ailleurs
que les vapeurs s’attachent aux corps folides,
qu’elles touchent, & q,u’elles les hume#ent,
parce que les corps folides leur enlèvent la chaleur
qui les tenon vaporifées ; de forte que ces
vapeurs,fe réduifent ainfi en eau, fur les feuilles
qui, en font recouvertes. C’eft pour cela que l’on
voit le matin, pendant l’Eté, les feuilles mouillées.
Enfin, on ne peut douter que la propriété
que les feuilles ont de fe retourner, quand leur
furface inférieure regarde le c ie l, ne foit une
une fuite de leur hefoin d’être nourries de cette
manière, & un effet de l’humidité qui effeélue
ce retournement.
Mais, comment ces feuilles tirent-elles Feau?
C’eft encore ce 'que M. Bonnet eft parvenu à
montrer; il- avoit remarqué, comme je l’ai dit,
que les pétioles qui plongent dans l’eau, l’afpi-
roient au travers de leurs fibres, & en nourrif-
foieru la feuille ; il imagina d’appliquer ces pétioles
par leur furface fur Feau, en empêchant
leur eonta# avec l’eau, par leur extrémité ;
mais les feuilles périrent aufli vite que fi les
furfaces des pétioles n’avoiem pas touché l’eau,
de forte qu’il faut en conclure, i.° Que les
feuilles nourries par les pétioles, font nourries
par leurs fibres, & que l’eau y paffe de même
que la -sève, par leur fu#ion. i.° Que les nervures
des feuilles ne favorifent pas cette nourriture
, lorfque les feuilles font étendues fur l’eau,
& qu’elles la touchent par leurs furfaces, puif-
que ces nervures font un développement du pétiole,
comme l’expérience le prouve, quand on
emploie des feuilles à groffes nervures ; on voit
au moins alors qu’elles fe nourriffent peu par
ces nci;vures, quand leurs furfaces feules font
hume#ées. 3.0 Que le parenchyme eft l’organe
nourricier de la feuille. 4.® Que les glandes
corticales qui recouvrent le parenchyme, fucent
l ’eau élaborée par ce parenchyme; ce qui me
paroît vrai, puifquë ces glandes ne fe trouvent
ni à la furface du pétiole, ni à celle des nervures
des . feuilles qui ne tirent point d’eau ; &
puilque tes glandes font étroitement liées rfvec
le parenchyme, comme M. Defauffure Fa démontré.
Voyez Epid erm e , G landes , Pa r en ch
ym e .;
... Les féuilles font ainfi fournies d’organes abfor-
bans, qui fe chargent du foin de choifir & de
préparer..les alimens de la plante. C’eft par ce
mo$'en que plufieurs végétaux fe nourriflènt
dans les, pays brùlans. C’eft pour cela qu’il faut
garantir d'u foleil les plantes tranfplamées, les
boutures, afin qu’elles puiffent fe riourrir fuffi-
famment par leurs feuilles, tandis quelles ne
peuvent vivre allez aux dépens .de leur racine ;
d’autant plus que le foleil, en defféchant cesfeuil-
I N J r67
les que leurs racines .n’alimentent plus, ôteroit
à ces plantes toute leur nourriture. M. Gnettard
avoit vu profpérér un arbre dans une atmofphère
qu’il croyoit être parvenu à bien deffécher.
Mais, eti fuppofant qu’il y eût réuffi, ce que je
ne crois pas, à caufe de la tranfpiration confia
dérabïe & continuelle que les plantes éprouvent*
cette féchereffe n’auroit pas affeélé beaucoup la
plante, parce quelle tira fûrément beaucoup
plus d’ eau par fes racines-, que fi d ie avoit été
placée dans un air plus humide. C eft au moins
ce que mes expériences m’ont >appris, toujours
fans aucune exception.
Nous devons croire que l’écorce s’imbibe
d’eau. Il eft du moins certain qu’elle augmente
de poids, quand on la plonge dans l’eau ; qu elle
fe deffèche, quand la plante périt, ou quand
une branche eft détachée de la tige. Enfin on
fait sûrement que le parenchyme de 1 écorce
reffemble beaucoup à celui des feuilles, & qu il
remplit dés fondions analogues, comme je 1 at
fait voir. Aufli l’expérience apprend qu’on nuis
beaucoup aux arbres-, lorfqu on ôte à 1 écorce
de la tige le conta# de l’air.
Les racines s’imbibent .d’eau , de même que
les autres parties des plantes. Elles ont un parenchyme!
comme l’écorce & les feuilles. D ailleurs
l’exgfirience fait voir que l’eau qui s’élance
dans la plante a traverfé les racines. Mais il
arrive fouvent , lorfque les racines font dans
l’eau, qu’elles s’en imbibent avec trop d abondance
, & qu’elles nuifent à la plante, ou en lui
fourniflant une quantité de nourriture plus grande
que celle qu’elle peut élaborer , ou en lui offrant
une nourriture tout-à-fait délayée. On obferve
la même choie dans les années pluvieufes, &
l’on remarque alors une caufe manifefte de la
jauniffe. Voyez J aunisse , Racines.
INJECTIONS. H ne faut négliger aucun moyen
de découvrir la vérité. Aùffi, comme une des
parties les plus difficiles de l’Anatomie des animaux
, eft la connoiffance du fyftême vafculaire*
on a recherché d’abord à le rendre fenfible dans
toutes fes ramifications. C’eft ce que Ruyfch
tenta, fur-tout pour les animaux , en fe fervant
des ïnjedions avec le plus grand fuccès , & il
oüvroit une fourçe d’idéesqu’on auroit vainement
cherchées par une autre soute.
L ’analogie imaginée entre les animaux & les
plantes, fit penfer que Fon pourroit perfectionner
la connoiffance des végétaux, en y employant
aufli le fecours des Injeètions. Mais on fentit
bien-tôt l’imperfeètion de cette reflource. M. Duhamel,,
étant parvenu à rougir les os des poulets
& des cochons , qu’il avoit nourris avec la garance*
crut pouvoir employer un procédé femblable *
pour colorer quelques parties des végétaux : mais
ces recherches dirigées de cette manière furent
abfolument inutiles.
Cç fut alors qu’il réfolut de profiter de M