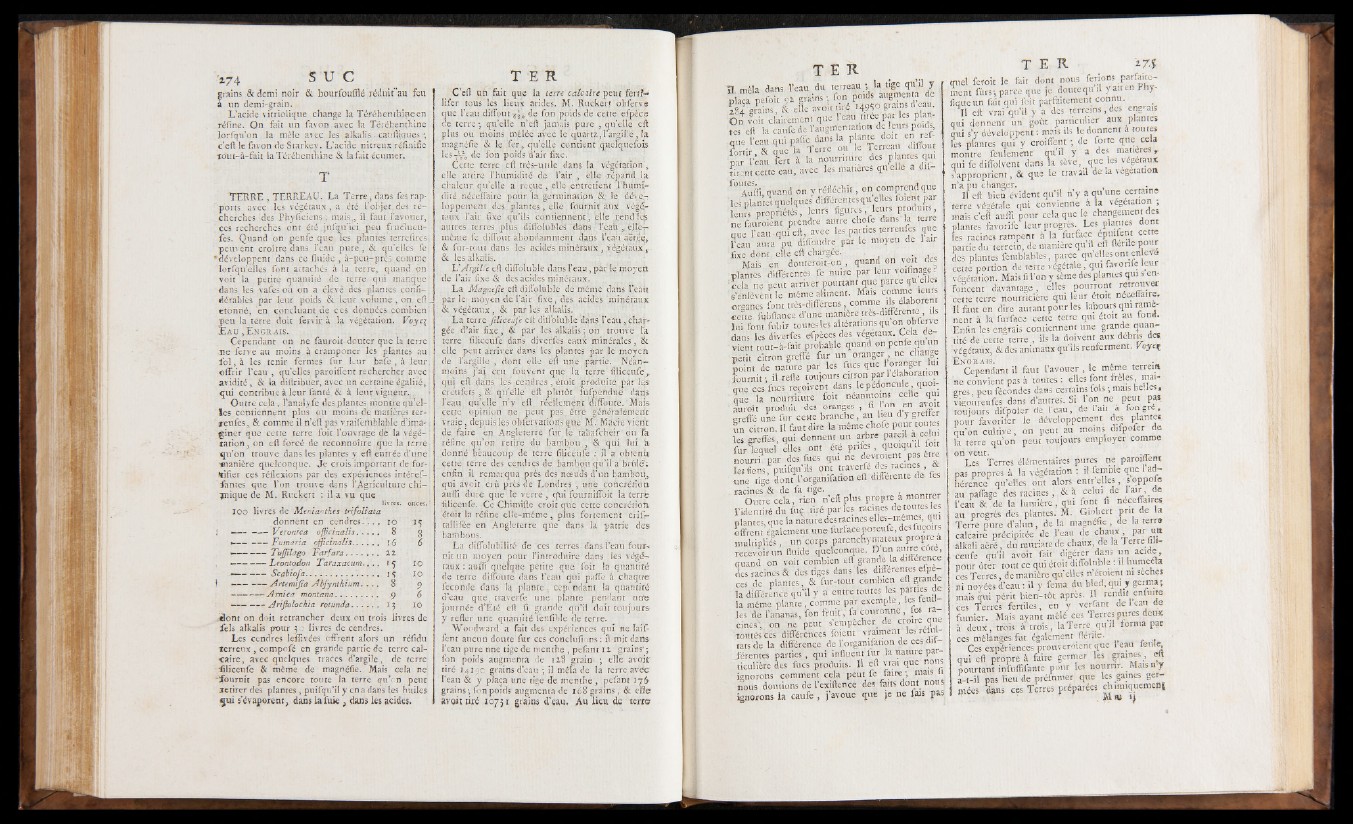
'*74 S U C grains & demi noir & bourfouftlé réduit au feu
à un demi-grain.
L ’acide virriolique change la Térébenthine en
réfine. On fait un favon avec la Térébenthine
lorfqu’on la mêle avec les alkalis,. cauftiques
c’eft le favon de Starkey. L ’acide nitreux réfinifie
toiu-à-fait la Térébenthine St lafait écumer.
T
TERRE , TERREAU. La Terre , dans fesrap-
ports avec les végétaux , a été l’objet; des recherches
des Phyficiens mais., il faut l’avouer,
ces recherches ont été juiqu’ici peu fruclueu-
fes. Quand on .penfe que les plantes terrelires ■
peuvent croître dans l’eau pure’ , & qu’elles fe
’développent dans ce fluide , à-peu-près comme
lorfqu’êlles font attachés à la terre, quand on
voit la petite quantité de terre qui manque’
dans les vafes ou on a élevé des plantes cqnfi-;
dérables par leur poids &/leur volume , on. eft _
etonné, en çpnclüant de ces données combien’
peu la terre doit fervir à la végétation. Voye\
E au ,Engrais.
Cependant on ne fauroit douter que la terre ;
ne ferve au moins à cramponer lès plantes au
f o l , à les tenir fermes fur leur bafe , à leur,
offrir l’eau , qu’elles paroiffent rechercher avec j :
avidité, & la distribuer, avec un certaine égalité,
qui contribue à leur fanté & à leur vigueur... •-
Outre cela, l’analyfe des plantes montre qu’elles
contiennent plus ou moins de matières ter-
sreufes, & comme il n’eft pas vraifemblable d’ima-j-
giner que cette terre foit l’ouvrage dé la végé-'
ia tion, on eft forcé de recounoître que la terre
qu’on trouve dans les plantes y efl entrée d’une
«lanière quelconque. Je crois important de for-:
üifier ces réflexions par des expériences intéref-;
famés que l ’on trouve dans l’Agriculture chi-
■ jnique de M. Rockert : il a vu que
livrés de Meniantkes trifoliata
donnent en cendrés. '. . . IO -*5
-----Veronica officinalis........... 8 8
---- Fuma ri a officinali s............. I<$ 6
-----Tujftago Far far a ..............
---- Leontodon Taraxacum.. ..
22
l 5 IO
-----Scàbiofa...................... .. 15 IO
---- Artcrmfia Abfynthium. . . . 8 9
— — Arnica montana. ........... .... f) 6
---- Ariftolochia rotunda............. IO
Sont on doit retrancher deux ou trois livres de
Tels alkalis pour 3 : livres de cendres.
Les cendres leflivées offrent alors un réfidu
terreux , compofé en grande partie de terre calcaire,
avec quelques traces d’argile, de terre
iiliceufe & même de magnéfie. Mais cela ne
-fournit pas encore toute la terre qu’on peur
retirer des plantes, puifqu’il y en a dans les huiles
qui s’évaporent, dans la fuie , dans les acides.
T E R
C’efi un fait que la terre calcaire peut feif?—
lifer tous les lieux arides,. M. Ruckerî obferve
que l’eau dilfout^gô de fon poids de cette efpècé
ce terre *, qu’elle n’eft jamais, pure qu’elle efl
plus ou moins mêlée avec le quartz, l’argife, la
magnéfie & le fer, qu’elle contient quelquefois
les f-}Q de Ton poids d’air fixe.
Cette terre efl très-utile dans la végétation',
elle artire l’humidité de l’air , elle répand,, la
chaleur qu’elle a reçue , elle .entretient .l’humidité
néceffaire pour la germination 80 le développement
des. plantes, elle, fournit aux végétaux
l’air fixe qu’ils contiennent:.', elle rend !ês
autres terres plus diflbïublés dans •Tèau;, .éllc-r
même fe difl'out abondamment dans l’eau âereè,
& fur-tout dans les acides minéraux, végétaux ,
&. les alkalis.
UArgilïe efl diflolubie dans l’eau, par le moyen
de l’air fixe & des acides minéraux.
La Magnéfie efl djfloluble dé même dans l’eâiî
par le: moyen de 1,’air fixey des acides ‘minéraux
& végétaux, & par les alkalis.
La terre Jiüceufè efl diflolubie dans l’eau, chargée
d’air fixe., & par les alkalis ton, trouve Ta
terre filiceùfe dans diverfés eaux minérales , &
elle peut arriver dans les plantes par le moyen
de l’argille ., dont elle efl une partie. Néanmoins
pà| cru Souvent que la terre filiceùfe,.
qui efl dans Jes .cendres , étoit 'produite par' les'
creufets qu’elle ëft plutôt fufpèndue' daqs
l’eau, qu’elle ,n’y efl réellement diffoute. Mais-
çet.te opinion né peut pas r être généraièiTieflt
vraie, depuis les obleryatioris que M. Macie Vient
de faire en. Angle terre fur. Iç tabafchèir on fa
réfine qu’on retire du bambou , & qui lui 'a
donné beaucoup de terre filicétife ; il a obtenu
cette terre des cendres de bambou qu’il a brûlé:
enfin il remarqua près dès noeu’ds d’un bambou,
qui âveit crû près de Londres , une çoûcféri'dn
aufli dure que1 le verre , qui fournîffok la terre
filiceùfe. Ce Chimifle croit que cette concrétioîi
étoit la réfine elle-même, plus fortement crif—
tallifée en Angleterre que dans la patrie desbambous.
La diflolubilité de ces terres dans l’eau four-,
nit un moyen pour l'introduire dans ;;lés végétaux
: aufli quelque petite que foit la quantité
de terre difloute dans l’eau qui paffe à chaque
fécondé dans la plante. cependant la quantité
d’eau que, traverfe une plante5 pendant urïe
journée d’Eté eft fi grande qii’il doit toujours
y relier une quantité fenfible de terre.
Woodward a fait des expériences qui ne Iaif-
fenf aucun doute fur ces conclufions : il mit dans
l’eau pure une tige de menthe pefant 12 f grains1;
fon poids augmenta de 128 grain ; elle avoir
tiré 1419 c grains d’eau ; il mêla de la terre avec
l’eau & y plaça une tige de menthe , pefant 176
grains-, fon poids augmenta de 168 grains, & elle:
aYoiniré 10731 grains d’çau, Au lieu de terre
T E ît
>1 mêla dans l’eau du terreau -, la tige qu’il y
plaça pefoit 1 grains;, fon poids augmenta de
M4 grains & elle »voit <*«>“ •
On voit clairement que l'eau urée par les plan,
tes eft la caufcde l’augmentation de leurs poids,
■ dueTeau qui pafi’e dans la p ante dort en ref-
?ortir & que‘ la Terre ou le Terreau d.ffout
par l’eau 1ère à la nourriture des, plantes qui
Firent cette eau, avec les matières quelle a dit
f0 Aufli, quaud on y réfléchit, on comprend que
les plantes quelques différentes qu elles lurent par
leurs propriétés, leurs figures , leurs produits,
ne fauroient prendre ' autre chofe dans la terre
que l’eau • qui eft, avec les parties terreufes. que
Peau aura V diffoudre par le moyen de larr
fixe dont, elle eft chargée. ,
Mais en ddutéro»-cn , quand on voit des
plantés différentes fe nuire par leur vodinage.
: cela ne peut arriver pourtant que parce qu elles ;
s’enlèvent le même aliment. Mais comme leurs
organes font très-différens, comme ils élaborent
cette fubftance d’une manière«ès-différente , ils
lui font fubir toutes le's;Mtérations qri on obferve
dans les dlverfes efpèces des végétaux. Cela devient
tout-à-fait probable quand on penfe quup
pèiic citron greffé fur un oranger ne change
point de nature par les focs que 1 oranger lui ,
Fournit; il relie toujours citron par 1 élaboration
que ces. fucs reçoivent dans le pédoncule, quoi:
que la nourriture foit néanmoins celle qui
auto» produit des branges I fi L. on ,.en ^
arefle une fur cette branche, au lieu d y grefrer
un citron. Il faut dire la même chofe .
les greffes, qui donnent un arbre pareil a celui
fur lequel elles .ont été prîtes, quoiqu il foit.
nourri, par des fucs qui ne -df £ oiem .P“ êt£
les Sensf puifqu’ils ont traverfé des racines &
sine tige dont l’orgahifatïon eft différente de les >
racines & de fa tige*
Outre cela, rien® n’eft plus propre à montrer
l ’identité du foc tiré parles racines de toutesles
niantes, que la nature des racines elles-mêmes, qui
offrent également une l'urfaceporeufe, desfoçoirs
multipliés, un corps parenchymateux propre » ;
recevoir un fluide quelconque. D un autre côté,
quand on voit combien eft grande la différence ;
des racines & des tiges dans les differentes e fp è - ,
ces de plantes, & fur-tout combien eft grande .
la différence qu'il y a entre toutes les parues J e
la même plante, comme par exemple, les terni
les de l’ananas, fon fruit , fa couronne, fes racines',
on ne peut s’empêcher^ de croire que
routés ccs ’ différences foient vraiment lesrétul-
tats de la différence de l’.organrlauon de ces .dit
..férentes parties, qui influent fur la nature particulière
des fucs produits. 11 eft vrai que nous
ignorons comment cela peut fe faire ; .mais.»
BOUS doutions de l’exiftence des faits doM nous;
ignorons la caufe , j’avoue que je ne fais pas
t e r |ts
, quel feroit le fait dont nous ' ferions parfaite-
1 ment fors; parce que je doutequ il y aiten J-ny-
fiqûeun fait qui feit paffaitement connu.
Il eft vrai qu’il y a des terrems, des engrais
qui donneur un goût particulier aux plantes
qui s’y développent : mais ils te donnent a toutes
les plantes qui y croiffent ; de forte que cela
montre feulement qu’il y a des matières r
qui fe diffolvent dans la sève, que les végétaux
: ^approprient, & que le travail de la v égétauon
n’a pu changer. .
If eft bien évident qu’il n’y a qu une certaine
terre végétale qui convienne à la végétation ;
mais c’eft aufli pour cela que le changement des
plantés favorife leur progrès. Les plantes dont
les racines rampent à la furface d?u^ e",t ce
partie du terrein, de manière qu il eft lténle pour
des plantes femblables, parce quelles ont enlevé
celte portion de terre végétale, qui favorife leur
végétation. Mais fi l’on y sème des plantes qui s enfoncent
davantage, elles pourront retrouver
cette terre nourricière qui leur étoit néceltaire.
Il faut en dire autant pour les labours qui ramènent'
à la furface cette tetre qui étoit au fond.
Enfin les engrais contiennent une grande quantité
de’cette terre , ils la doivent aux débris des
"végétaux, &des animaux qu’ils renferment, yoyef
Etroit, aïs.' : , . . •
Cependant il faut l’avouer , le même terrem
ne convient pas à toutes : elles font frêles, mai-
' grès peu fécondes dans certains fols ; mais belles,
vigoüreufes dans d’autres. Si l’on ne peut pas.
■ toujours difpofer de, l’eau, de 1 air a fon gré,
pour favori fer le développement des plantes
qu’on cultive, on peut au moins difpoler de
la terre qu’on peut toujours employer comme
‘on veut. .jj- a
Les Terres élémentaires pures ne parodient
pas propres à la végétation : il fernnle que 1 adhérence
qu’elles o.nt alors entr’elles , soppoje
au paflage des racines, & à celui de la » , de
l’eau & .de la lumière, qui font fi néceffaires
au progrès des plantes. M. Giobert prit de la
Terre pure d’alun , de la magnéfie , de la terre
calcaire précipitée de l ’eau de chaux par un
alkali aéré dû muriatc de chaux, de la Terre fili-
•ceufe qu’il avoir fait digérer dans « a g j
pour ôter tout ce qui étoit diflolubie : il humecla
ces Terres de manière qu’elles n’étoient ni sèches
ni noyées d’eau : il y fema du bled, qui y germa;
mais qui périt bien-tôt après. Il rendit enfuite
ces Terres fertiles, en y verfant de 1 eau de
fumier. Mais ayant mêlé ces Terres pures deux
à deux, trois fi trois, la Terre qu il forma pat
ces mélanges, fut. également ftérile-
Ces expériences prouverdierit que beau feule,
oui eft propre à faire germer les graines _, eft
pourtant infuffifante pour Les nourrir. Mais n y
a-t-il pas lieu de prélnmer que les gaines ger-
mées dans ces Terres préparées chimiquement
Mm i)