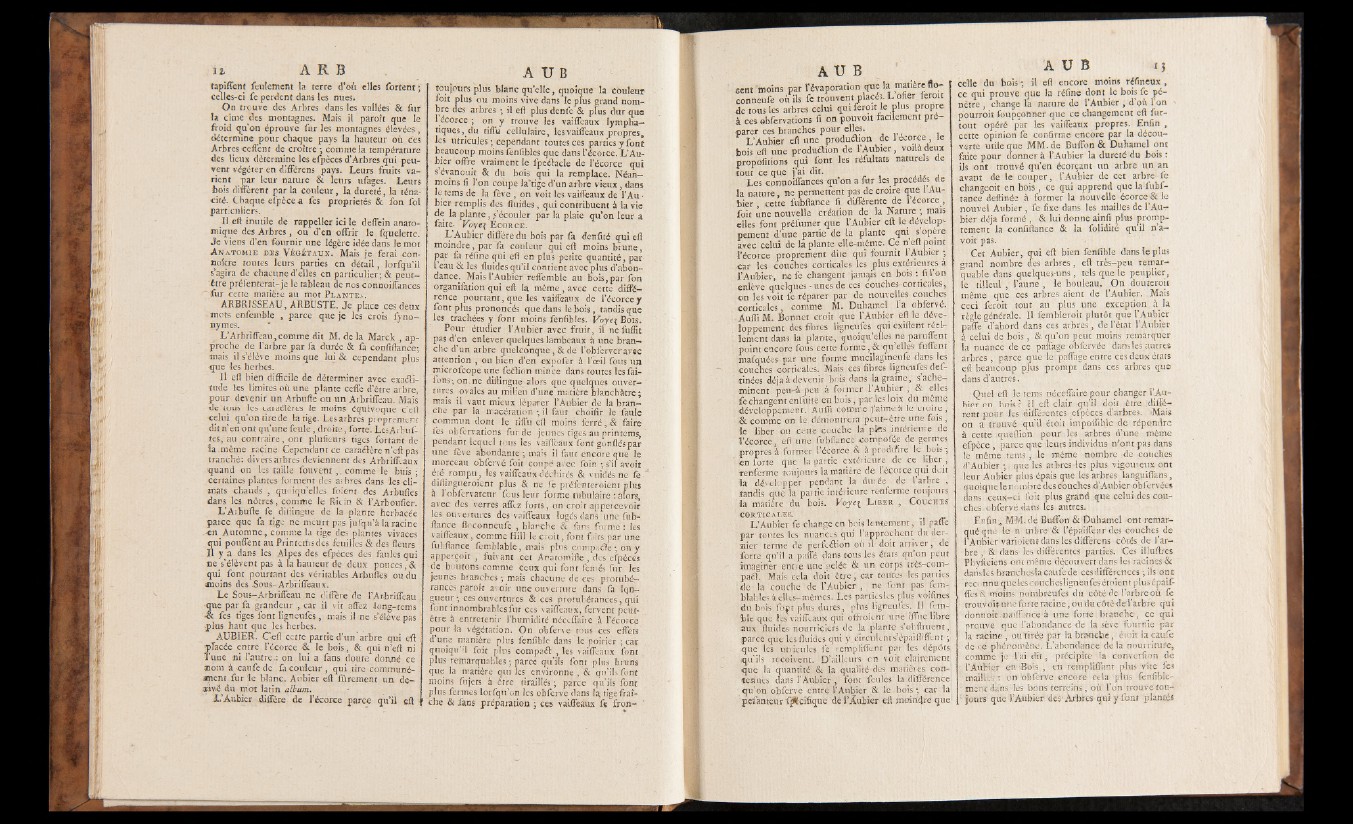
i i A R B
tapiffent feulement la terre d'où elles forterit;
celles-ci fe perdent dans les nues.
On trouve des Arbres dans les vallées & fur
ïa cîme des montagnes. Mais il paroît que le
froid qu’on éprouve fur les montagnes élevées,
détermine pour chaque pays la hauteur où ces
Arbres ceffent de croître ; comme la température
des lieux détermine les efpèces d’Arbres qui peuvent
végéter en dlfférens pays. Leurs fruits varient
par leur nature & leurs ufages. Leurs
bois diffèrent par la couleur, la dureté, la ténacité.
Chaque efpèce a fes propriétés & fon fol
particuliers.
Il eft intuile de rappeller ici le deffein anatomique
des Arbres, ou <fen offrir le fquelette.
Je viens d’en fournir une légère idée dans le mot
A natomie des Végétaux. Mais je ferai conn
o t a toutes leurs parties en détail, lorfqu’il
s’agira de chacune d’elles en particulier; & peut-
être préfenferai-je le tableau de nos connoiffances
fur cette matière au mot Plan te s .
ARBRISSEAU, ARBUSTE. Je place ces deux
mets enfemble , parce que je les crois fyno-
nymes. *
L ’Arbriffeau,comme dit M. de la Marck , approche
de l’arbre par fa durée & fa confiftance-
mais il s’élève moins que lui & cependant plus <■.
■ que les herbes.
11 eft bien difficile de déterminer avec exaéli- [j
tude les limites où une plante ceffe d’être arbrer '
pour devenir un Arbufte ou un Arbriffeau. Mais
de tous les caraélères le moins équivoque c’eil
celui qu’on tire de la tige. Lès arbres proprement
dit n’en ont qu’une feule, droite, forte. LesArbuf-
tes, au contraire, ont plulieurs tiges fortant de
la.même racine. Cependant ce caraérèren’eftpas
tranché: divers arbres deviennent des Arbrifllaux
<quand on les taille fouvent ,. comme le buis • :
certaines plantes forment des arbres- dans les climats
chauds , quoiqu’elles foient des Arhufies
dans les nôtres, comme le Ricin & l’Arboufier.
L ’Aibufte fe diRingue de la plante herbacée
parce que fa tige ne meurt pas jufqu’à la racine j
•en Automne, comme la tige des plantes vivaces
qui pouffent au Prie teins des feuilles & des fleurs
Il y a dans les Alpes des efpèces des faules qui
ne s’élèvent pas à la hauteur de deux pouces & :
qui font pourtant des véritables Arbufles ou du
moins des .Sous-Arbriffeatix.
Le Sous-Arbriffeau ne diffère de l’Arbriffeau
-que parafa grandeur , car il vit affez iong-tems
fes tiges font ligneufes , mais il ne s’élève pas
plus haut que les herbes.
AUBIER. C’eff cette partie d’u n ’ arbre qui eft *
placée entre l’écorce & le bois, & qui n’ert ni
Tune ni l’autre-: on lui a fans doute donné ce
nom à caufe de fa couleur , qui tire communé-
anent fur le blanc. Aubier eft fûrement un. de-
aavë du mot latin album.
SJ Aubier diffère de l’écorce parce qu’il eft '
A TJ B
toujours plus blanc qu’elle, quoique la couleur
foit plus ou moins vive dans le plus grand nombre
des arbres ; il eft plus denfe & plus dur que
1 écorce ; on y trouve les vaiffeaux lymphatiques,
du tiffu cellulaire, les vaiffeaux propres,
les utricules ; cependant toutes ces parties y font
beaucoup moins fonfibles que dans l’écorce. L ’Aubier
offre vraiment le fpeélacle de l’écorce qui
r s évanouit & du bois qui la remplace. Néanmoins
fi l’on coupe la'tige d’un arbre vieux, dans
le tems de la fève , on voit les vaiffeaux de l’Au •
hier remplis des fluides , qui contribuent à la vie
de la plante, s’écouler par la plaie qu'on leur a
faite. Voyt\ E corce.
L Aubier diffère du bois par fa denfité qui eft
moindre, par fa couleur qui eft moins brune,
par fa réfine qui eft en plus petite quantité, par
1 eau & les fluides qu’il contient avec plus d'abondance.
Mais l’Aubier reffemble au bois, par fon
organifation qui eft la même , avec cette différence
pourtant, que les vaiffeaux de l’écorce y
font plus prononcés que dans le bois, tandis que
les trachées y font moins fenfibles. Voye\ Bois.
Pour étudier l’Aubier avec fruit, il nefuffit
pas d’en enlever quelques lambeaux à une branche
d’un arbre quelconque, &de l’obfervef avec
attention , ou bien d’en expofer à l’oeil fous un
microfcope une feélion mince dans toutes les fai-
fons-, on. ne diftinguq alors que quelques ouvertures
ovales au^ milieu d’une matière blanchâtre;
mais il vaut mieux (épater l’Aubier de la branche
par la macération ; il faut choifir le faule
commun dont le tiffu eft moins ferré | & faire
fes observations fur de jeunes tiges au printems,
pendant lequel tous les vaiffeaux font gonflés par
une fève abondante ; mais il faut encore que le
morceau obfervé foit coupé avec foin ; s’il avo.it
été rompu, les vaiffeaux déchirés & vuidés ne fe
diffingueroient plus & ne fè préfenteroient plus
à 1 obfervateur feus leur forme tubulaire : alors,
avec des verres affez forts, on croitappercevoir
les ouvertures des vaiffeaux logés dans une fub-
ffance fleconneufe , blanche & fans formé : les
vaiffeaux, comme Hill le c roit, font faits par une
fubftance femblable, mais pins compaéle ; on y
apperçoit , fuivant cet Aratomifte, des efpèces
de boutons-comme ceux qui font fçinés fur les
jeunes branches ; mais chacune de ces protubérances
paroît avoir une ouverture dans fa Iqn-
gueur ; ces ouvertures & ces protubérances, qui
font innombrables fur ces vaiffeaux, fervent peut-
être à entretenir- l’humidité néceffaire à l’écorcè
pour la végétation. On obfene tous ces effets
d’une manière plus fenfible dans le poirier ; car
quoiqu’d foit pins compaéb , les vaiffeaux font
plus remarquables ; parce qu’ils font plus bruns
que la matière qui les environne , & qu’ils font
moins fujets à être tiraillés ; parce qu’ils font
plus fermes lorfqu’on les obferve dans litig e fraîche
& fans préparation ; ces vaiffeaux fe fron- ‘
A U B
sent moins par fèvaporation que la matière floconneufe
où ils fe trouvent placés. L ofier feroit
de tous les arbres celui qui feroit le plus propre
à ces obfervations fi on pouvoit facilement préparer
ces branches pour elles.
L ’Aubier eft une produéhon de 1 écorce , le
bois eft une produdion de l’Aubier, voilà deux
propofitions qui font les réfultats naturels de
tout ce que j’ai dit.
Les connoiffances qu’on a fur les procédés de
la nature, ne permettent pas de croire que 1 Aubier
, cette fubftance fi différente de l’éeorce,
foit une nouvelle création de la Nature ; mais
elles font préfumer que l’Aubier eft le dévelop’-
peinent d’une partie de la plante qui s opère
avec celui de la plante elle-même. Ce n’efl point j
l'écorce proprement dite qui fournit 1 Aubier ; ..
car les couches corticales les plus extérieures à
l’Aubier, ne fe changent jamais en bois : fi l’on
enlève quelques * unes de ces couches'corticales,
on les voit fe réparer par de nouvelles couches
corticales, comme M. Duhamel la obfervé.
AufliM. Bonnet croit que l’Aubier eft le développement
des fibres ligneufes qui exiftent réellement
dans la plante, quoiqu elles ne paruffent
point encore fous cette forme ,& 'q u elles fuffent
mafquées par une forme mucilagineufedans les
■ couches corticales. Mais ces fibres ligneufes def-
•îinées déjà à devenir bois dans la graine, s acheminent
peu-à peu à former 1 Aubier , &. elles
fie changent enluite en bois, parles loix du même
-développement. Auffi comme j’aime à le croire,
I& comme on le, démontrera peut-être une fois ,
le liber ou cette couche la p&s intérieure de
l ’écorce,, ell une fubftance compofée de germes,
propres à former l’écorce & à prodifire lé bois ;
en forte que la partie extérieure de ce liber ,
renferme toujours la matière de l’écorce qui doit
la développer pendant la durée de l’arbre , ’
tandis que la partie intérieure renferme toujours •
la matière du bois, Voye% L iber , Couches
CORTICALES.
L ’Aubier fechange en bois lentement, il paffe ;
par toutes les nuances qui l’approchent du dernier
terme de perfection où il doit arriver, de
forte qu’il a paffé dans tous les états qu on peut
imaginer entre une gelée & un corps très-coin-
paét. Mais cela doit être,.car toutes les parties
de la couche de l’Aubier , ne font pas fem-
blables à elles-mêmes. Les parties les plus voifines:
du bois font plus dures, plus ligneufes^. Il fetn-
ble que les vaiffeaux qui offroient une iffue’libre
aux fluides nourriciers dé la plante s’obftruent,
parce que les fluides qui y circukms’épaiflfflent ;
que les utricules fe rempliffent par"les dépôts
q u’ils reçoivent. D’ailleurs on voit clairement
que la quantité & la qualité des matières contenues
dans l’Aubier , font feules la différence
qu’on obfervé entre l’Aubier & le b o is , car la
pefanteur fjUcifique de l’Aubier eft moindre que'
A U B ty
celle du bois ; il eft encore moins réfineux ,
ce qui prouve que la réfine dont le bois fe pénètre
, change la nature de l’Aubier , d’où l’on >
pourroit foupçonner que ce changement eft fur-
tout opéré par les vaiffeaux propres. Enfin ,
cette opinion fe confirme encore par la découverte
utile que MM.de Buffon & Duhamel ont
faite pour donner à T Aubier la dureté du bois :
ils ont trouvé qu’en écorçant un arbre un an
avant de le couper , l’Aubier de cet arbre fe
changeoit en b o is , ce qui apprend que la fubftance
deftinée à former la nouvelle écorce &Te
nouvel Aubier, fe fixe dans les mailles de l’Au*r
bier déjà formé , & lui donne ainfi plus promptement
la confiftance & la folidité qu il n a—
voit pas.
Cet Aubier, qui eft bien fenfible dans le plus
grand nombre des arbres, eft très-peu remarquable
dans quelques-uns, tels que le peuplier,
le tilleul , l’aune , le bouleau. On douteroit
même que ces arbres aient de l’Aubier. Mais
ceci feroit tout au plus une exception à la
règle générale. Il fembleroit plutôt que l’Aubier
paffe d’abord dans ces arbres, de l’état l’Aubier
à celui de bois, & qu’on peut moins remarquer
la nuance de ce paffage obfervée dans les autres
arbres, parce que le . paffage entre ces deux états
eft beaucoup plus prompt , dans ces arbres que
dans d’autres.
Quel eft le tems néceffaire.pour changer l ’Aubier
en bois ? il eft clair qu’il doit -être ,d iffé rent
pour les différentes efpèces d’arbres. Mais
on a trouvé qu’il étoit impolïible de répondre
à cette queflion pour les arbres d’-une même
efpèce , parce que leurs individus n’ont pas dans
le même tems, le même nombre de couches
Aubier ;. que les arbres des plus vigoureux ont
leur Aubier plus épais que les arbres .languiffans,
quoique le nombre des couches d’Aubier oblèrvées
dans ceux-ci foit plus grand que celui des couches
obfervé dans les autres.
Enfin:, MM. de Buffon & Duhamel ont remarqué
que le n mb're' & l’épaiffèur des couches de
l’Aubier varioient dans les différens côtés, de l’arbre
/ & dans les différentes parties. Ces illuftres
Phyficiens ont même découvert dans les racines &
dans-lés branches la caufe de cesdifférences ; ils ont
reconnu queles couchesligne-ufes étoient plus épaif-
ffes & moins nombreufes du côté de l’arbre où fe
• trouvôit- une forte racine, ou du côté de l’arbre qui
donnoit naiffince à une forte branche , ce qui
preuve que i’abondance de la sève fournie parla
racine , ou tirée par la branche , étoit la caufe
de ce phénomène. L ’abondance de la nourriture,
comme je l’ai d it, précipite la converfion de
l’Aubie.r en Bois , en reinpliffant plus vke fes
mailles-: on-ôbferve encore cela plus fonfiblè-
ment dans' Ies bons terreins, où l ’on trouve fou-
- jours que l’Aubier des- Arbres qui y font plantés