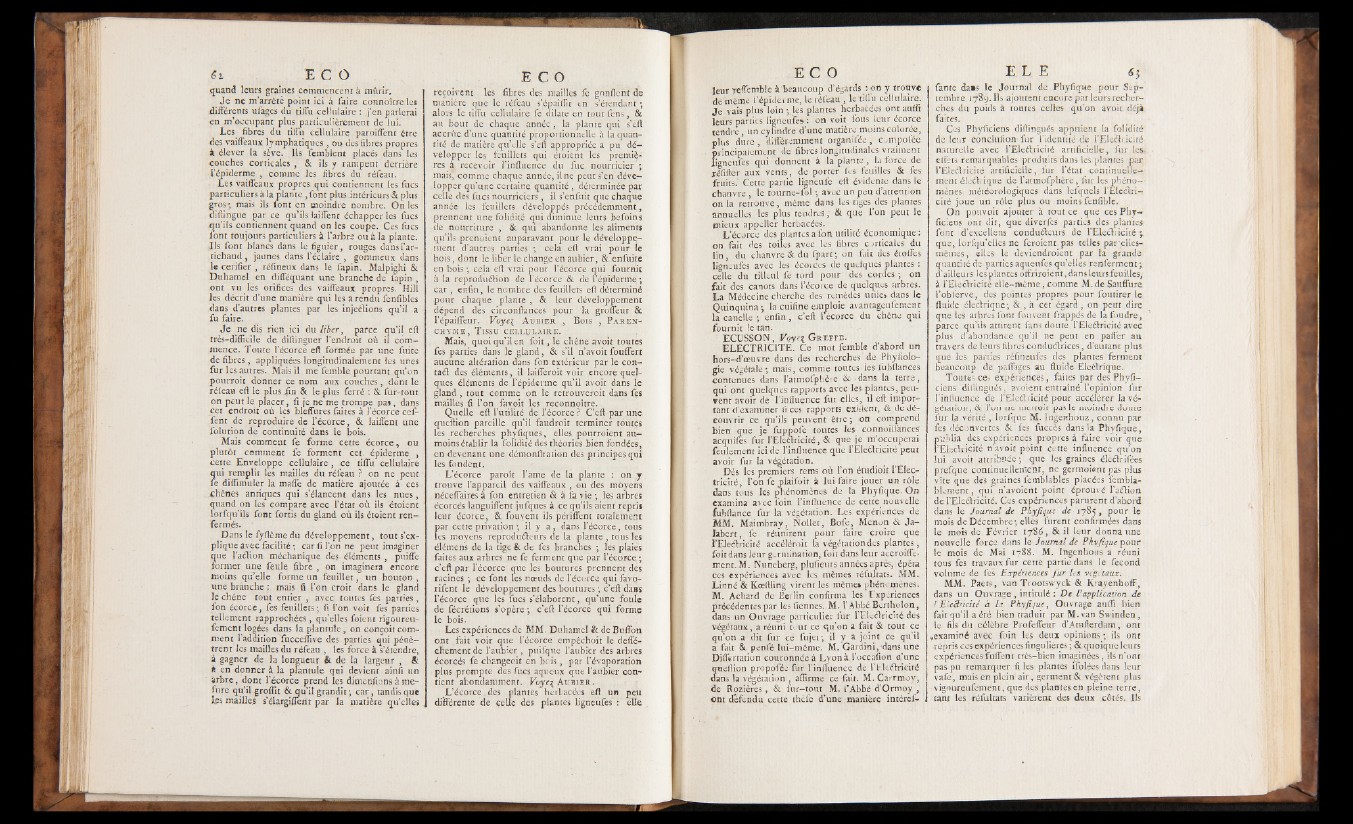
quand leurs graines commencent à mûrir.
Je ne m’arrête point ici à faire connoître les
différents ufages du tiffu cellulaire : j’en parlerai
en m’occupant plus particulièrement de lui.
Les fibres du tiffu cellulaire paroiffent être
des vaiffeaux lymphatiques , ou des fibres propres
à élever la sève. Ils fembient placés dans les
couches corticales , & ils y rampent derrière
l ’épiderme , comme les fibres du réfeau.
Les vaiffeaux propres qui contiennent les fucs
particuliers à la plante , font plus intérieurs & plus
gros- mais ils font en moindre nombre. On les
oiftingue par ce qu’ils laiffent échapper les fucs
qu’ils contiennent quand on les coupe. Ces fucs
font toujours particuliers à l’arbre ou à la plante.
Ils font blancs dans le figuier, rouges dansl’ar-
tichaud , jaunes dans l’éclaire , gommeux dans
le cerifier, réfineux dans le fapin. Malpighi &
Duhamel en difféquant une branche de fapin ,
ont vu les orifices des vaiffeaux propres. Hill
les décrit d’une manière qui les a rendu fenfibles
dans d’autres plantes par les injeétions qu’il a
fu faire.
Je ne dis rien ici du liber f parce qu’il eft
très-difficile de diftinguer l’endroit où il commence.
Toute l’écorce eft formée par une fuite
de fibres , appliquées longitudinalement les unes
fur les autres. Mais il me femble pourtant qu’on
pourroit donner ce nom aux couches, dont le
réleau eft le plus^in & le plus ferré : & fur-tout
on peut le placer, fi je ne me trompe pas, dans
cet endroit où les bleffures faites à l’écorce cef-
lent de reproduire de l’écorce, & laiffent une
folution de continuité dans le bois.
Mais comment fe forme cette écorce, ou
plutôt comment fe forment cet, épiderme ,
cette Enveloppe cellulaire, ce tiffu cellulaire
qui remplit les mailles du réfeau ? on ne peut
le diffimuler la maffe de matière ajoutée à ces
chênes antiques qui s’élancent dans les nues,
quand on les compare avec l’état où ils étoient
lorfqu’ils font fortis du gland où ils étoient renfermés.
Dans le fyftême du développement, tout s’explique
avec facilité ; car fi l’on ne peut imaginer
?ue l’aétion méchanique des éléments , puiffe
ormer une feule fibre , on imaginera encore
moins qu’elle forme un feuillet, un bouton ,
une branche : mais fi l’on croit dans le gland
le chêne tout entier , avec toutes fes parties,
fon écorce, fes feuillets-, fi l’on voit fes parties
tellement rapprochées , qu’elles foîent rigoureu-
fement logées dans la plantule, on conçoit comment
l’addition fucceflive des parties qui pénètrent
les mailles du réfeau , les force à s’étendre,
à gagner de la longueur & de la largeur , Sc
à en donner à la plantule qui devient ainfi un
arbre, dont l’écorce prend les dimenfions à me-
fure qu’il ^roffit & qu’il grandit ; ca r , tandis que
l£$ mailles s’élargiffeüt par la matière qu’elles
reçoivent les fibres des mailles fe gonflent de
manière que le réfeau s’épaiffit en s’étendant;
alors- le tiffu cellulaire fc dilate en tout fens, &
au bout de chaque année, la plante qui s’éft
accrue d’une quantité proportionnelle à la quantité
de matière qu’elle s’eft appropriée a pu développer
les feuillets q u i. étoient les premières
à recevoir l’influence du fuc nourricier ;
mais, comme chaque année, il ne peut s’en développer
qu’une certaine quantité , déterminée pay
celle des fucs nourriciers, il s’enfuit que chaque
année les feuillets développés précédemment.,
prennent une folidité qui diminue leurs befoins
de nourriture , & qui abandonne les aliments
qu’ils prenoient auparavant pour le développement
d’autres parties ; cela, eft vrai pour le
bois, dont le liber le change en aubier, & enfuite
en bois ; cela eft vrai pour l’écorce qui fournit
à la reproduction de l’écorce & de l’épiderme ;
car , enfin, le nombre des feuillets eft déterminé
pour chaque plante , & leur développement
dépend des circonftances pour la groffeur &
l’épaiffeur. Voye[ A ubier , Bois , Par en chyme
, Tissu c ellu la ir e.
Mais, quoi qu’il en fo i t , le chêne avoit toutes
fes parties dans le gland, & s’il n’avoit fouffert
aucune altération dans fon extérieur par le con-
ta<51 des éléments, il laifferoit voir encore quelques
éléments de l’épiderme qu’il avoit dans le
gland, tout comme on le retrouveroit dans fes
mailles fi l’on favoit les reconnoître.
Quelle eft l’utilité de l’écorce ? C’eft par une
queftion pareille qu’il faudroit terminer toutes
les recherches phyfiques, elles pourroient au-
moinsétablir la folidité des théories bien fondées,
en devenant une démonflration des principes qui
les fondent,
L ’écôrcé paroît Tame de la plante : on y
trouve l’appareil des vaiffeaux , ou dés moyens
néceffaires à fon entretien & à fa vie ; les arbres
écorcés languiffent jufques à ce qu’ils aient repris
leur écorce, & fouyent ils périffent totalement
par cette privation ; il y a , dans l’écorce, tous
les moyens reproduéfeurs de la plante , tous les
élémens de la tige & de fes branches ; les plaies
faites aux arbres ne fe ferment que par l’écorce ;
c’eft par l’écorce que les boutures prennent des
racines ; ce font fes noeuds de l’écorce qui favo-
rifent le développement des boutures ; c’eft dans
l’écorce que les fucs s’élaborent, qu’une foule
de fécrétions s’opère ; c’eft l’écorce qui forme
le bois.
Les expériences de MM. Duhamel & de BufFon
ont fait voir que l’écorce empêchoit le deffé-
etiement de l’aubier , puifque l’aubier des arbres
écorcés fe cbangeoit en h e is , par l’évaporation
plus prompte des fucs aqueux que l’aubier contient
abondamment. Voyey Au b ie r .
L ’écorce.des plantes herbacées eft un peu
différente de celle des plantes ligneufes : elle
leur reffemble à beaucoup d’égards : on y trouve
dé même l’épiderme, le réfeau , le tiffu cellulaire.
Je vais plus loin ; les plantes herbacées ont aulfi
leurs parties ligneufes : on voit foûs leur écorce
tendre, un cylindre d’une matière moins colorée,
plus dure, différemment organifée, Coinpofée
principalement de fibres longitudinales vraiment
ligneufes qui donnent à la plante, la force de
réfifter aux vents, de porter les feuilles & fes
fruits." Cette partie ligneufe eft évidente dans le
chanvre , le tourne-fol ; avec un peu d’attention
on la retrouve, même dans les tiges des plantes
annuelles les plus tendres, & que l’on peut le
mieux appeller herbacées.
L ’écorce des plantes a fon utilité économique:
on, fait des toiles avec les fibres corticales du
lin , du chanvre & du fpart ; on fait des étoffes
ligneufes avec les écorces de quelques plantes :
celle du tilleul fe tord pour des cordes ; on
fait des canots dans l’écorce de quelques arbres.
La Médecine cherche des remèdes utile» dans le
Quinquina ; la cuifine emploie avanrageufement
la canelle ; enfin, c’eft l’écorce du chêne qui
fournit le tan.
ECUSSON, Voyei Greffe. ,
ELECTRICITE. Ce mot femble d’abord un
hors-d’oeuvre dans des recherches de Phyliolo-
gie végétale; mais, comme toutes les fubftances
contenues dans l’atmofphèfe &-dans la terre,
qui ont quelques rapports avec les plantes, peuvent
avoir de l’influence fur elles, il eft important
d’examiner li ces rapports exiftent, & de découvrir
ce qu’ils peuvent être; oh comprend
bien que je fuppofe toutes les connoiffances
acquifes fur i’Eleélriciré, & que je m’occuperai
feulement ici de l’influence que l’Eleélricité peut
avoir fur la végétation.
Dès les premiers tems où l’on étudioit l’Electricité,
l’on fe plaifoit à lui faire jouer un rôle
dans tous lés phénomènes de la Phyfique. On
examina avec foin l’influence de cette nouvelle
îubftance fur la végétation. Les expériences de
MM. Maimbray, Nollet, Bofe, Menon & Ja-
labert, fe réunirent pour faire croire que
l’Eleélricité accéléroit la végétation des plantes,
foit dans leur germination, foit dans leur accroiffe-
ment.M. Nuneberg, plulieurs années après,:épéta
ces expériences avec les mêmes réfujtats. MM.
Linné & Koeftling virent les mêmes phénomènes.
M. Achard de Berlin confirma les Expériences
précédentes par les fiennes. M. l’Abbé Bertholon,
dans un Ouvrage particulier fur l'Elcétiicité des
végétaux, a réuni tout ce qu’on a fait & tout ce
qu’on a dit fur ce fujet; il y a joint ce qu’il
a fait & penfé lui-même. M. Gardini/dans une
Diff«rtation couronnée à Lyonà.l’occafion a’une
queftion propofée fur l'influence de l’ tileélricité
dans la végétation , affirme ce fait. M. Carrmoy,
de Rozières, & fur-tout M. i’Abbé d’Ormoy ,
ont défendu cette thèfe d’une manière intéreffante
da*s le Journal de Phyfique pour Septembre
1789.IIS ajoutent encore par leurs recherches
du poids à toutes celles qu’on avoit déjà
faites.
Ces Physiciens diftingués appuient la folidité
de leur conclufion fur l’identité de l’Eleétiicité
naturelle avec l’Eleéti-icité artificielle, fur les
effets remarquables produits dans les plantes par
l’Eleélricité artificielle, fur l’état continuellement
élcélrique de i’atmofphère, fur les phénomènes
météorologiques dans lefquels rÊlcélri-
cité joue un rôle plus ou moins fenfible.
On pouvoit ajouter à tout ce que ces Phy—
ficieus ont dit, que diverfes parties des plantes
font d’excellens conducteurs de l’Elediicité ^
que, lorfqu’elles ne feroient pas telles par elles-
mêmes, elles le deviendraient par la grande
quantité de parties aqueufes qu’elles renferment ;
d’ailleurs les plantes offriroient, dans leurs feuilles,
à l’Eleélricité elle-même, comme M. de Sauffure
l’obferve., des pointes propres pour foutirer le
fluide électrique; & , à cet égard, on peut dire
que les arbres font fou vent frappés de la foudre,
parce qu’ils attirent fans doute l’EleCtricité avec
plus d’abondance qu’il ne peut en paffer au
travers de leurs fibres conductrices, d’autant plus
que les parties réfineufes des plantes ferment
beaucoup de paffages au fluide EleCtrique.
Toutes ces expériences, faites par des Phyfi-
ciens diftingués, avoient entraîné l’opinion lur
l’influence de l’EleCtricité pour accélérer la végétation,
& l’on ne mettoit pas le moindre doute
fur la vérité ,. lorfque M. Ingenhouz , connu par
fes découvertes & fes fuccès dans la Phyfique,
publia des expériences propres à faire voir que
l’EbCtridté n’avoit point cette influence qu’on
lui avoit attribuée ; que les graines élèCtrifées
prefque continuellement, ne germoient pas plus
vite que dès graines femblabîes placées fembla-
blcment, qui n’avoient point éprouvé l’aCtion
de l’EleCtricité. Ges expériences parurent d’abord
dans le Journal de Phyfique de 1785, pour le
mois de Décembre; elles furent confirmées dans
le mois de Février 1786, & il leur donna une
nouvelle force dans le Journal de Phyfique pour
le mois de Mai 1788. M. Ingenbous a réuni
tous fes travaux fur cette partie dans le fécond
volume de fes Expériences fur Us végétaux.
MM. Paets, van Trootswyck & Krayenhoff,
dans un Ouvrage , intitulé : De Vapplication de
f Electricité à la Phyfîjut, Ouvrage auffi bien
fait qu’il a été bien traduit par M. van Swinden,
le fils du célèbre Profeffeur d’Amfterdam, ont
»»examiné avec foin les deux opinions ; ils ont
repris ces expériences fingulières ; & quoique leurs
expériencesfuffent très-bien imaginées, ils n’ont
pas pu remarquer fi les plantes ifoléesdans leur
vafe, mais en plein air, germent & végètent plus
• vigoureufement, que des plantes en pleine terre,
tant les réfultats varièrent des deux côtés. Ils