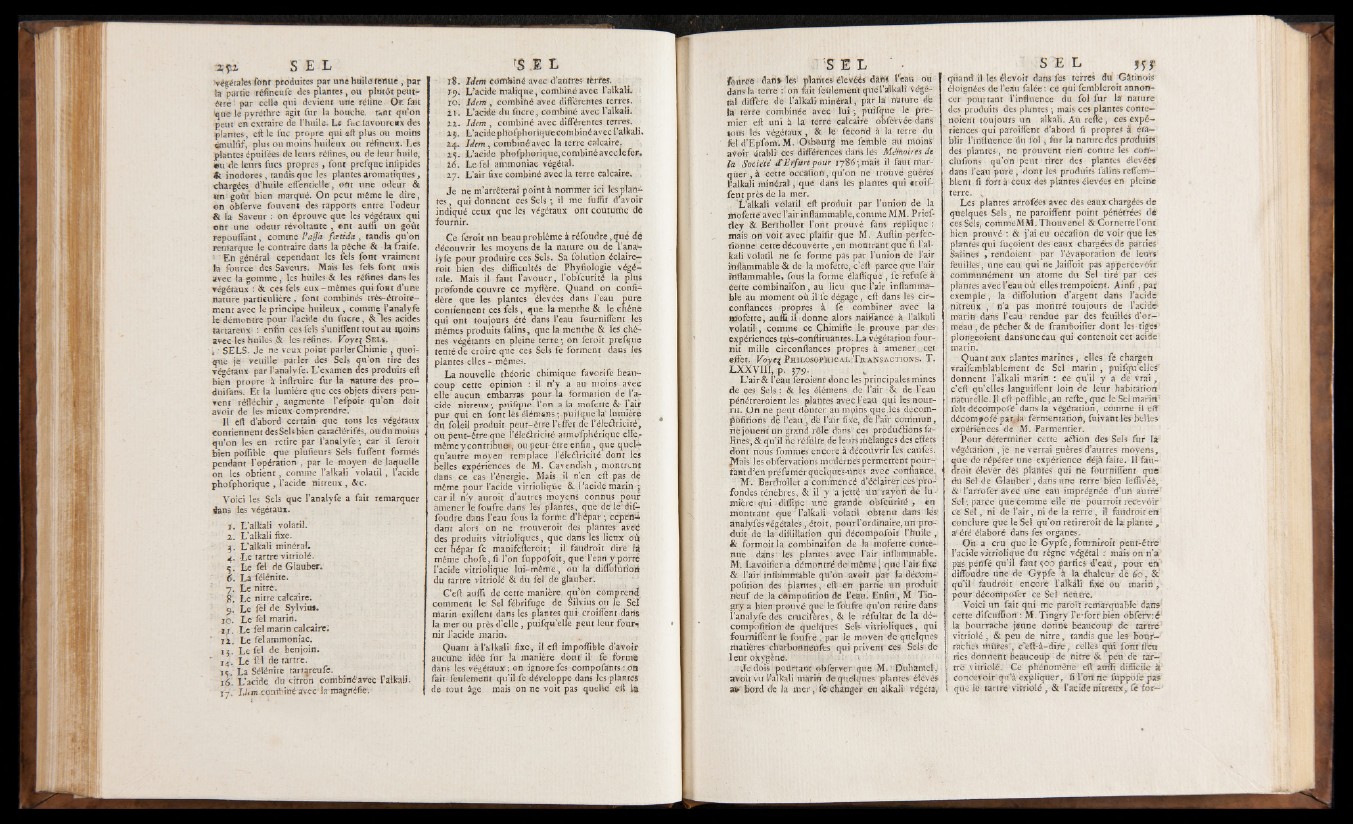
S E L
végétalesfont produites par une huile tenue, par
h partie réfine ufe des plantes, ou plutôt peut-
être par celle qui devient une Féline Or. fait
•que Je pyréthre agit fur la bouche, tant qu’on
peut en extraire de l’huile- L« fue lavoure*x des
plantes, eft le fuc propre qui eh plus ou moins
émulfif, plus ou moins huileux ou réfineux. Les
plantes épuifées de leurs Félines, ou de leur huile,
«u de leurs fucs propres , font prefque inlipides
& inodores, tandis que les plantes aromatiques,
chargées d’huile effentielle, ont une odfeur &
un goût bien marqué. On peut même le dire,
©n obferve fouvent des rapports entre l’odeur
& la Saveur : on éprouve que les végétaux qui
ont une odeur révoltante , ent aufli un goût
repouflânt, comme l’aÿ'a feetida , tandis qu’on
remarque le contraire dans la pêche & la fraife.
- En général cependant les tels font vraiment
la fource des Saveurs. Mais les fête font unis
avec la gomme, les huiles & les rétines dans les
végétaux : & ces fels eux-mêmes qui font d’une
nature particulière , font combinés très-étroitement
avec le principe huileux , comme l’analyfe
le démontre pour l’acide du fucre, & les acides
tartareux : enfin ces fels s’unifient tout au moins
avec les huiles les réfines. Voyt\ Sels.
« • SELS. Je ne veux point parler Chimie , quoique
je veuille' parler des Sels qu’on tire des
végétaux par l’analy-fe. L ’examen des produits eh
bien propre à inflruire fur la nature des pro-
duifans. Et la lumière que ces objets divers peuvent
réfléchir, augmente l’efpoir qu’on doit
avoir de les mieux comprendre.
Il eft d’abord certain que tous les végétaux
contiennent des Sels bien caraétërifés, ou-du moins
qu’on les en retire par l’analyfe ; car il feroit
bien poflible que plufieurs Sels fuffent formés
pendant l’opération , par le moyen de laquelle
on les obtient, comme l’alkali vola til, l’acide
phofphorique , l’acide nitreux, &c.
Voici les Sels que l’analÿfe a fait remarquer
dans les végétaux.
i . L ’alkali volatil.
i . L ’alkali fixe.
a. L ’aikali minéral.
а. -Le tartre vitriolé.
5. Le fel de Glauber.
б . La félénite.
? 7. Le nitre.
S'. Le nitre calcaire;
9. Le fel de Sylvius.
10. L e fel marin.
1 1 . Le fel marin calcaire;
' i i . Le fel ammoniac.
13. Le fel de benjoin.
" I4 . Le AJ de tartre.
je . La Sélénire tart|reufe.
16. L’acide du citron combîtféâveC Falkali.
j-j. IJtm .contbméàvcc1 la- magnéfié.
ts E L
18. Idem combiné avec d’autres tèrfes.
J9. L ’acide malique, combiné avec l’alkali.
10. Idem , combiné avec différentes terres.
21. L ’acide du fucré, combiné avec l’alkali.
22. Idem , combiné avec différentes terres.
13. L ’acide phofphorique combiné avec l’aikali.
24. Idem, combiné avec la terre calcaire,
25. L ’acide phofphorique,combinéaveclefer.
16 . Le fel ammoniac végétal.
27. L ’air fixe combiné avec la terre calcaire.
Je ne m’arrêterai point à nommer ici les pîaft^
tes, qui donnent ces Sels ; il me fuffit d’avoir
indiqué ceux que les végétaux ont coutume dû
fournir.
Ce feroit un beau problème à réfoudre ,qué de
découvrir les moyens de la nature ou de l’anal
lyfe pour produire ces Sels. Sa folution éclaire—
roit bien des difficultés de Phyfiologie végétale.
Mais il faut l’avouer, l’obfcuritô la plus
profonde couvre ce myftère. Quand on cqnfi-
dère que les plantes élevées dans l’eau pure
contiennent ces fels, que la menthe & le chêne
qui ont toujours été dans l’eau fourniffent les
mêmes produits falins, que la menthe & letf chênes
végétants en pleine terre ; on feroit prefque
tenté de croire que ces Sels fe forment dans ies
plantes-elles- mêmes.
Lanouvelle théorie chimique favorife beaucoup
cette opinion : il n’y a au moins aVee
elle aucun embarras pour la formation de l’acide
nitreux -, puifque l’on a la mofette & l’air
pur qui en font lès élémens ; puifque la lumière
du foleil produit peut-être l’effet de Fëlfeélricité,
ou peut-être que réleâricité atmosphérique elle-
même y contribua, oupeut-éfre enfin, que quel-
qu’autre moyen remplace l’éleèlricité dont lès
belles expériences de M. Cavendish , montrent
dans ce cas l’énergie. Mais il n’en eft pas dé
même pour l’acide virrioliqûc &.1 ’acide marin j
car il n'y auroit d’autres moyens connus pour
amener le foufre dans les1 planrés, que de le dif-
foudre dans l’eau fous la forme d’hépar ; cepërtû
dant alors on ne rrotiveroit des plantes avé’d
des produits vitrioliquës, que dans les Iietrx" ou
cet hépar fe manifefteroit; il fâtidroît dire là
même chofe,fi l’on fuppôfqit, queTeàrty porté
l’acide vitrioliqiie liii-mêrtie, pu' là difiohitiori
du tartre vitriolé & dû fel dé glauber.
G’eft aufli de cette manière qu’on comprend
comment le Sel fébrifuge de Silvius ou le Sef
marin exiftent dans les plantes qui çroiffent daris
la mer ou près d’elle , puifqu’elle peut leur four«
nir F acide marin.
Quant à l ’&lkali fixe, il eft impoffible d’avoir
aucune idée fur la manière dbntf il; fe formé
dans les végétaux ; on ignore fes compofàms : dû
fait- feulement qu’il fe développe dans les-plantes
de tout âge mais on ne voit pas quelle eft la
S E L ' ;
‘fource dans* les plafites- éleVé'és dâfiï F «au ou
dans fa terYe on fait feûlement quél’aflka'l'i Végétal
diffère de Falkali minéral, par la nature db
là terre combinée avec lui -, puifque le premier
eft uni à la terré calcaire obférvéé dans
10US lés végétaux, & lé fécond à la terre du
fel d’Epfom. M. OfoOurg me feûible au moins
avoir établi' ces' différences1 dans lés Méfhoirés de
ta Société d'Effürt pour 1786 -, mais il faut marquer
, à cette occafioti , qu’on ne trouvé guères
falkali minéral, que dans les plantes qui «roif-
fent près de la mer. ‘
L ’alkali volatil éft produit par l’union de la
mofette avec l’air inflammable, comme MM. Priéf- fley & Berthollet Font prouvé fans réplique:
mais on voit avec ptaifir que M. Auftin perfectionne
cette découverte , en montrant que fi l’al-
kali volatil ne fe forme pas par l’union de l’air
inflammable & de: la mofette, c’eft parce que l’air
inflammable, fouS la forme élaftiqüé, fe refufe à
éefte combinaifon, au lieu que l’air inflammable
au moment où il le dégage, eft dans les cir-
conftances propres à fe combiner avec la
japfofétte, aufli il donne alors naiffancé à l’alkali
volatil , comme ce ChimîfteJe prouve par dés ,
expériences tçès-conflituaores. Lavégétation fournit
mille circonflances propres à amener.. cet
effet. Voyei Philosophical.Transäctions. T.
L x x y m , p. 379.
L ’air & l’eau fer oient donc les principales mines
de ces Sels : & les élémens de l’àir & de l’eau
pénétreroient les plantes avec Feaü qtiifei nourrit.
Qn ne peut douter au mpins que.les décorn-
pofirioris- dé l’e’aù !, dé l’dir fîke, dé Pair conimun,
nè jouent un grand rôle dhris1' ces productions fa-
Knes, & qu’il n ê réfülte dé leurs mélanges des effets
dont nous fourmes encore à décoüvrir l'es caüfesl.
JVTais les obfervations mctlërnes permettent pour-
îbnt d?en préfumer quelques-unes avec corifiaiice,
M. Berthollet a commencé d’édairericèé profondes
ténèbres, Si il y a jettë ün'Taÿbû de lu mière
qui ^ diliîpe une grande ôbfcürité , en
montrant que I’alkali volatil obtenu dans lés:
ahalyfés végétales ,-éfoit, pour l’ordinaire, un produit
de la‘ difiiliàtion qui décompofoit l’huile ,
&. formoitla combinaifon de la mofette contenue
dans- les plantes avec l’air inflammable.
M. Lavdifier a démontré de;même ] que l’air fixe
& Pair inflammable qu’on avoit par la déeom-
pofitibn des ' plantes, eft' en partie un produit
nèuf de la cômpôfirion de Peàtri Enfin, M Tin-
gry a bien prouvé que le foufre qu’on retire dans*1
l’anal y fe dés crticirères, & le réfultat de la dé-
compofirion de quelques Sels vitrioliqueS, qui
fourniffent le foufre , par le moyen de quelques
matières charbontiéùfes qui privent ce§ Sels dé
leur okygèné.
. : J e dois pourtant obfervet que M .1 Dubàmeî,
avoit vu' Falkali marié de quelques plan tés* élevé§
ali»' bord dé la mer, ife-changer en alkali végérây
s e l m
quand il les élevoir dans fes terrés du Gâtinote
éloignées de l’eau falée : ce qui fembleroit annoncer
pourtant l’influence du fol fur là nature
des produits des plantes ; mais ces plantes conte-
norent toujours un alkali. Àù rené, ces expériences
qui patoiflênt d’abord fi propres à établir
l’influence "du foi , fur la nature des produits
des plantés-, ne prouvent rien contre les Coû'~
clufiotts qu’on peut tirer des plantes élevées
dans l’eau pure , dont les produits falins reffem-
blent fi fort à ceux des plantes élevées en pleine
terre, âjj
Les plantes arrofées avec des eaux chargées de
quelques Sels, ne paroiffent point pénétrées dé
ces Sels, comméMM.Thouvenel & Cornette l’ont
bien prouvé : & j’ai eu oCcafion de voir que les
plantés qui fuçoient des eaux chargées d'ô parties
Salines' , rendoiént par l’évaporation dé leurs
feuilles , une eau qui ne.laiffoit pas apperéevoir
communément un atome du Sel tiré par ces
plantes avec l’eau où elles rrempoiem. Ainfi , par
exemple, la diffolution d’argent dans l’acide
nitreux , n’a pas montré toujours dé l’acidè
marin dans l’eau rendue par des feuilles d’or—1
méaü, de pêcher & de framfeoifier -dont les tiges
, plongeoiént dansùnêeau qui contenôitcet acide
j marin.
\ Quant aux plantes marines, elles fe chaigen
vraifemblablefnent de Sel marin , puiftpi’éllcs7
donnent l’àlkali marin : Ce qu’il y a de v ra i,
c’éft qu’elles languiffént loin de leur habitation
| nâturélle. 11 eft poffible, au refle, que le Sel mafiti'
1 foit décbnrpofé dans la végétation, comme il feff
, décompofé par^a- fermentation, fuivant lés belles
expériences de M. Parmentier.
Pour déterminer cette aéHon des Sels fur là:
; végétation , je ne verrai guères d’autres moyens,
que de répéter une expérience déjà faite. 11 fau-
droit éleVer dés plantes qui ne fourniffenr que
dit Sel de Glauber', dans une terre bien reffivcè,
& l’arrofer ave-c une eau imprégnée cpuh aûtré:
Sêl- parce que comme elle ne pourroit recevoir
ce S e l, ni âè l’air, ni de la terré, il faùdrpiten
conclure que le Sel qu’on retireroît de la plante ,
ac été élaboré dans fes organes.
On a cru que le Gypfe, fotrrniroit peut-être
j l’acide vjtriôlique du règne végétal : mais on n’a
J pas pé-rifé qu’il fant 500 parties d’eau, pour en
| diffoùdre une de Gypfe à la Chaleur dë 60, &
qu il •' faudrait encore l alkalî fixe ou marin ,
J pour dëcompofer ce Sel tienfre.
Voici un fait qui me paroît remarquable dans
cette dîfcufliori : M. Tingry Peforr bien obfefv:é j la bourrache jeune donne beaucoup de tartre'
{ v i t r io l é & peu de nitre, tandis que les bour—
! racbë's mutes', c’eft-à-dire 7 celles qüi font fléu
; ries donnent beaucoup de nirre & peu dé tàr—
. tre vitriolé. Ce phénomène eft atrffi difficile k
Concevoir qirà expliqnerr fi rori ne fup-pofe pas
l que lé t-artre vitriolé y & Faeide nitreux, fe for—J